
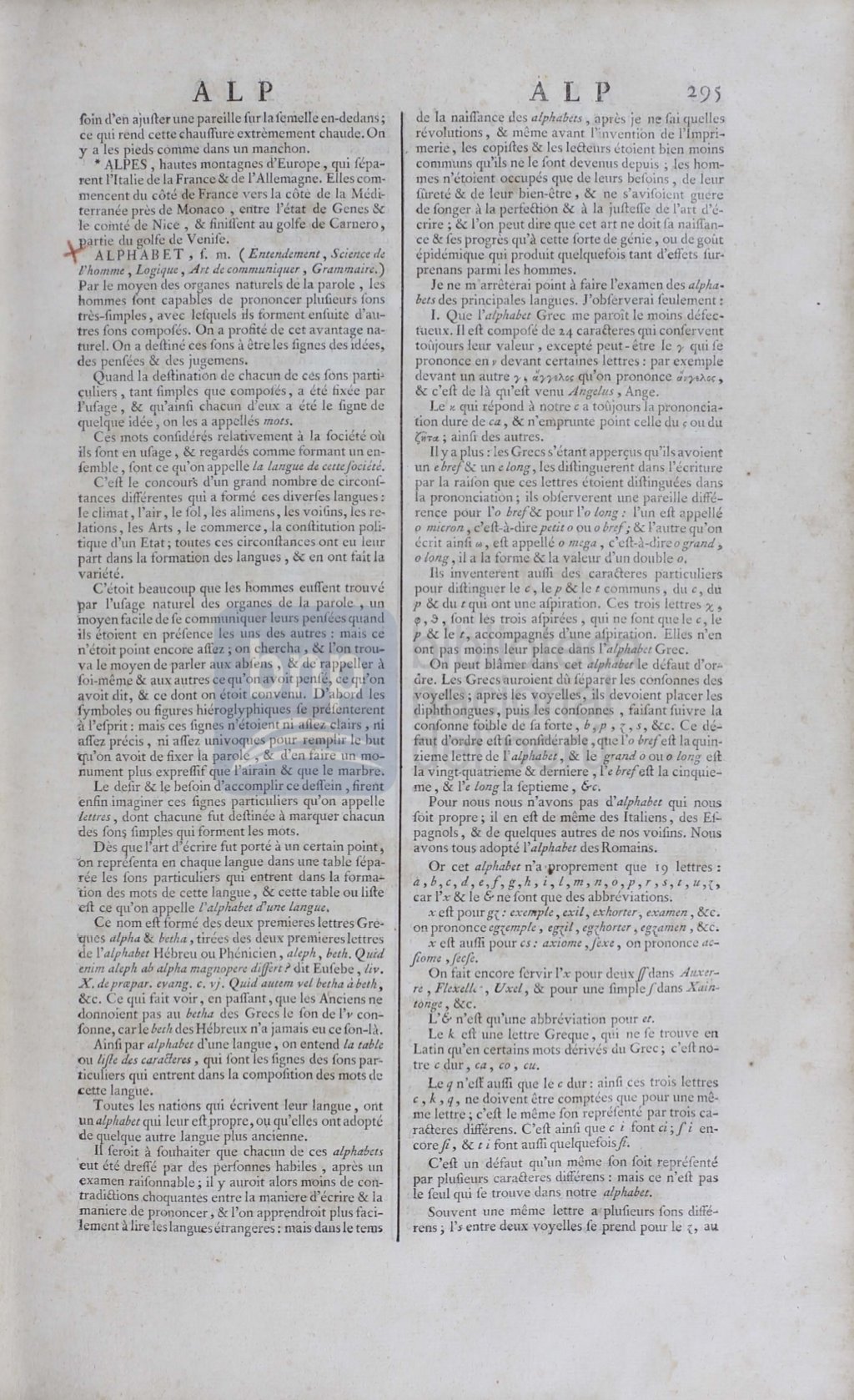
ALP
roin d'en ajufterune pareille fUT la lemelle en-dedans;
ce qui rend cette chauffure extremement chaude. On
ya
les pieds comme elans un manchon.
.. ALPES, hautes montagnes el'Europe , c¡ui fépa–
rent l'[talie de la France
&
ele l'Allemagne. Elles com–
mencent elu coté de France vers la cote de la Médi–
rerranée prt!S de Monaco , entre I'érat de Genes &
le comté ele Nice ,
&
finií[ent au golfe de Camero,
artie du golfe de Venife.
ALPHABET, f. m.
(Enteru1ement ,Seierll;ed~
l'hOl/lf/lt
,
Logir¡ue
,
Art de eomnumir¡uer , Grammairt. )
Par le moyen des organes naturels de la parole , les
hommes (onr capables de prononcer pluúeurs 10ns
tres-limpies, avec lefquels ils forment enfuite d'au–
tres fons compofés. On a prolité de cet avantage na–
turel. On a dell:iné ces fons
a
etre les fignes des idées,
des penfées
&
des jugemens.
Quand la defunation de chacun de ces fons parti'
culiers , tant fimples que compoíes , a eté lixée par
l'ufage, & qu'ainli chacun d'ellX a été le figne de
quelqne idée, onles a appellés
mots.
Ces mots confidérés relativement
a
la fociété oü
ils font en lúage
j
& regardés comme formant un en–
{emble, iont ce c¡u'on appelle
La Langlle de emeJoeiüé.
C'eíl: le concours d'un grand nombre de circonf–
tances différentes qui a formé ces diverCes langues :
le climat, I'air, le fol, les alimens, les voiGns, les re–
lations, les Arts , le commerce, la coníl:itution poli–
tique d'un Etat; tontes ces circoníl:ances Ont eu leur
pan dans la formation des langues , & en om fah la
variéré.
C'éroit beaucoup que les nommes eu{fent tr.ouvé
l>ar l'uCage naturel des organes de la parole , un
moyen facüe de fe communiquer leurs penfécs c¡uilnd
ils étoient en préfence les uns
de~
autres : mais ce
n'éroit point encore a[ez; on chercha , & l'on
trou~
va le moyen de parler anx abfens ,
&
de rappeller
a
{oi-men¡e
&
aux aurres ce 'fu'on avoitpenCé, ce c¡u'on
avoit dit,
&
ce dont on éroit convenu. D'abord les
fymboles ou
~glll'es hiérogl:>:"p~iques.
fe
préCen.teren~
a
l'eCprit : malS ces lignes n'etOlent m affez clalrs ,
ItI
alfez précis ,
ni
affez univoques pour remplir le but
tlu'on avoit de fixer la parole ,
&
d'en faire un mo–
nument plns expreílif que I'airain & que le marbre.
Le de/u· & le befoin d'accomplir ce deffein , lirent
enfin imag1ner ces lignes particllliers qU'OJ1 appelle
tutres ,
dont chacune fut deíl:inée a marque!" chacllJ1
des fons limpies qui forment les mots.
D es 'r;le l'art d'écrire fut porté
a
un certain point
~
"bn
reprefenta en chaque langue dans une table fépa–
rée les fons particuliers qui entrent dans la forma–
tion des mots de cette langue, & cette table ouliíl:e
cil:
ce qu'on appelle
talplzaba ¿'une langae.
Ce nom
ea
formé des deux premieres lettres Gre–
t¡ues
alplza
&
betha,
tirées des delIX premieres lenres
de l'
alplzabu
Hébreu ou Phénicien ,
aLeplz , bedz. Qéd
tnim aLeplt
ah
alp/za magnopere diffirt?
dit EüCebe,
liv.
X.
deprrepar. evang. e. vj. Qaid afuun veLbethaabedz,
&c. Ce qui fait voir, en paffant
j
que les Anciens ne
donnoient pas au
balta
des Grecs le fon de
1'1/
con–
{onnc, car
lebetlz
des Héureux n'a jamais en cefon-Ia.
Ainli par
alplzabet
d'une languc , on entend
la tabLe
'Ou
Lifle des earaéleres
,
'fui font les fignes des fons par–
riculiers quí entrent dans la compofition des mots de
cette langue.
Toutes les nations qui écrivent leur langue, ortt
un
alp/¡abet
'fui leur eíl: propre,
0\1
qu'elles ont adopté
de quelque autre langue plus ancienne.
II feroit a fouhaiter que chaclln de ces
aLphabets
'Cut
été dreífé par des perfonnes habiles , aprcs nn
examen raifonnable ; il Y auroit alors ffi'oins de COI1-
tradi.él:ions choquantes entre la n1aniere d'écrire
&
la
mamere
~e
prononcer;
&
l'on apprendroit plus faci–
lemcnt
a
hre les langues éo·angeres :
mais
daus le
tem~
ALP
295
ele
la nailla nce des
alpllabets
,
apres je ne f..i quelles
révolutions,
&
meme avant 1':Jlvention de l'Impri–
merie, les copiíl:es
&
les leél:enrs étoiem bien moins
COOlmuns c¡u'ils nc le font devenus depuis ; les hom–
J)les n'étoient occupés que ele leurs befoins, de ¡eur
(fu·eté
&
de lcur bien-etre, & ne s'avifoicnt gucre
de fonger
a
la perfe&on & á la íuíl:eífe de l'art d'é–
crire; & l'on peut dire que cet art ne doit fa naiífan–
ce
&
fes progres qll'a cette forte de génie , ou de gOllt
épidémique qui produit quelquefois tant d'effets fur–
prenans parmi les hommes.
Je ne
m
alTeterai point
a
faire I'examen des
aLpiza–
betsdes
principales langues. J'obferverai feulement:
1. Que
l'alphabu
Grec me parolt le moins défec–
theux. Il eíl: compofé de 2.4 caraél:eres qui confervent
toi'¡jours lenr valenr , excepté peut- etre le '>' qui fe
prononce en
v
devan;
certaine~
lettres: par e;emple
devant un autre
l'
\
"I'I',A.~
Cfll on prononce
'tI'l',A.~,
& c'eíl: de lá qll'e11: venu
AlIgeLus ,
Ange.
Le " qui répond
a
notre
e
a tOlljOurS la prononcia–
tion dure de
ea,
&
n'empmnte point celle du {ou du
~"'Ta.;
ainli des autres.
II
y a plus: les Grecs s'étant
apper~us
'fu'ils avoient
un
ebref&
un
e long,
les diílinguerent dans l'écriture
par la railon que ces lemes étoient diíl:ingu':es dans
la prononciation; ils obferverent une pareille diffé–
rence pour
1'0
brel&
pour
1'0
Long:
I'un eíl: appellé
o micron,
c'eíl:-a-dire
pelie o
ou
obrel;
& l'autre qu'on
écrit ainfi
{jJ,
eíl: appellé
o mega,
c'eíl-a-direo
grand
p
o Long,
il a la forme
&
la valellr d'un donble
o.
lis
inventerent auffi des caracreres particuliers
pour diíl:inguer le
e,
le
p
& le
e
communs, du
e,
du
p
& dll tqui ont une af¡)iration. Ces nois lettres
X
~
cp,"
,
Cont les rrois afpirées , c¡ui oe font que le
e,
le
p
& le
t,
accompagnés d'une afpiration. Elles n'en
ont pas moins leur place dans
l'aLphabctGrec.
On peut blamer dans cet
alplzabet
le défaut d'or..
áre. Les Grecs auroiem dtl féparer les confonnes des
voyelles; apres les voyeUes, ils devoient placer les
diphthongues, puis les confonnes , faifant fuivre la
confonne foíble de fa forte ,
b,
p
, \. ,
s,
&c. Ce dé–
faut d'ordre eíl:
{i
confidérable , que
1'0
brel
eíl: la CflLÍn–
zieme lettre de l'
aLphabet,
&
le
grand o
ou
o Long
eíl:
la vingt.quatrieme
&
derniere ,
I'e bre/eft
la cinquie–
me,
&
I'e
long
la feptieme,
&e.
Pour nous nous n'avons pas
d'alphabu
qui nOllS
{óit propre; il en eíl de meme des Italiens, des Ei:'
pagnols,
&
de 'fuelc¡ues auu·es de nOs voiíins. Nons
avons tous adopté l'
aLplzabet
des Romains.
Or cet
aLplzabet
n'a
~roprement
que
19
lettres :
a,
b,
e,
d,
e
,1,
g,
Iz,
i,
L,
m, n, o,
p,
r, s,
l, II
,{,
car
I'x
& le
&
ne font c¡ue des abbréviations.
x
dI:
pour
g{: exenrple, exiL, exhorur, examen,
&c.
on prononce
eg{empLe, egiJL, eg{lzorter
,
eg{afrun,
&c.
x
eíl: auffi pour
es: a:'Ciome ,fixe,
on prononce
tlC–
jiome ,fecfi.
On fait encore férvir
I'x
pom deuxffdans
Afl.wr–
re, FLexdl. -, UxeL,
&
pOllr une fimpleJdans
Xain–
torzge,&c.
L'& n'eíl: qu'une abbréviatioll pour
el.
Le
k
cll: une lettre Greque, qui ne fe trouve en
Latin c¡u'en certains mots dérives du Grec; c'eíl: no–
tre
e
dur ,
ea, eo, ell.
Le
'1
n 'eff auíli que le
e
dur : ainli ,ces trois leto·es
e,
k,
q,
ne doivent etre comptées que pour ulle me–
me lettre ; c'eíl: le m@me fon repréfenté par trois ca–
ralleres différens. C'eíl: ainli que
e
i
font
eL;J
i
eJ1-
coreji, &
t
¡
font auffi qtlelquefoisji.
C'eíl: un défaut c¡u'un meme fon foit repréfenté
par pllllieurs caraél:eres différens : mais ce n'eíl: pas
le fenl qui fe trouve dans notre
aLpltabet.
SOllvent ulle meme lettre a plulicurs fons cliffé–
rens;
1's
entre dellx voyelles
re
prend pOLU· le \., au.
















