
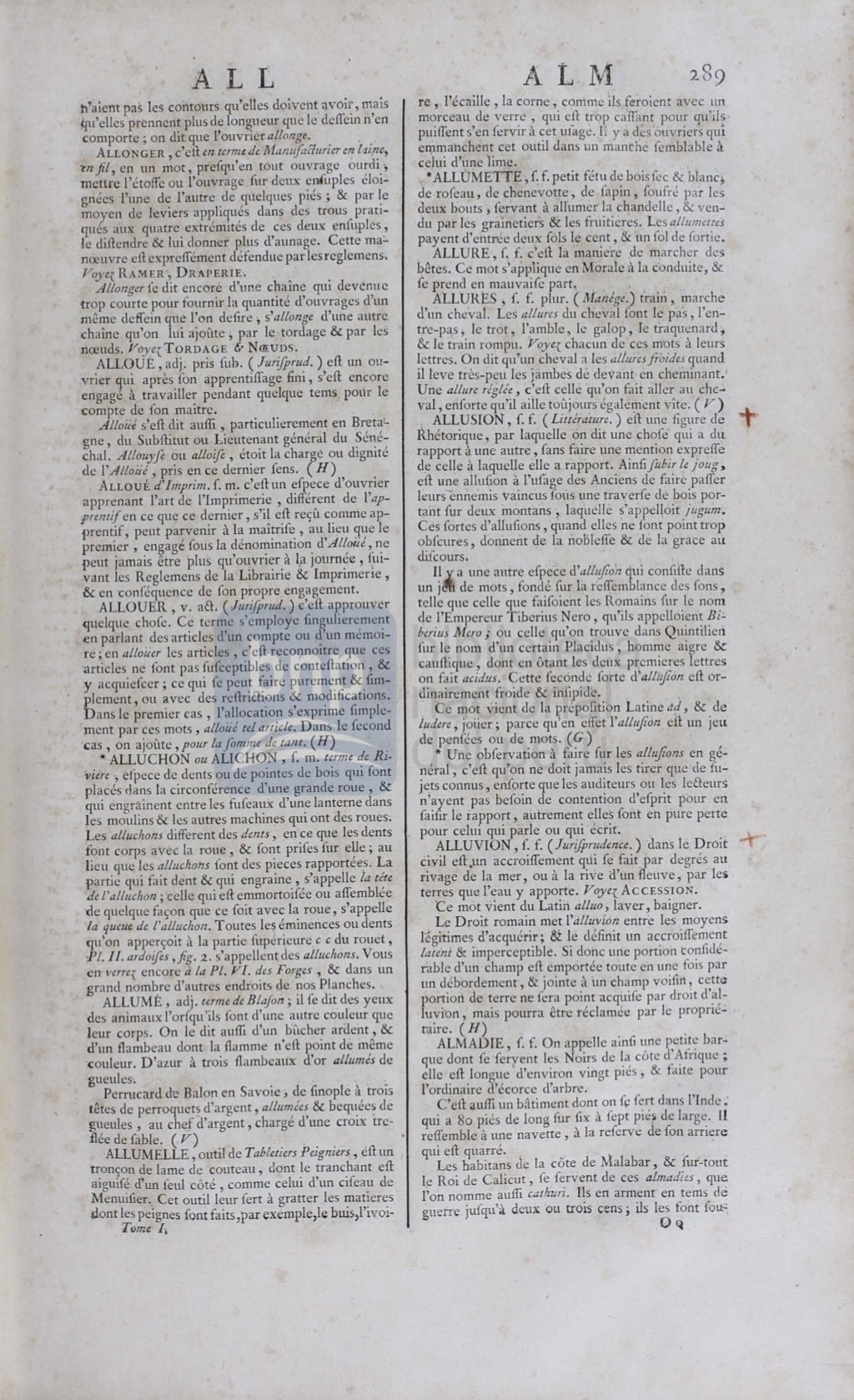
ALL
h'aient pas les contours qtl'elles doi'vel1t avoit, mais
qtl'elles prennent plus de longueur que le deífein n'en
comporte; on dit que l'ouvrier
allonge.
ALLONGER, c'eíl:en
terme de Manufaélurieren l",i,ne}
'en
jil,
en un mot, prefqu'en tout ouvrage ourdi;
mettre l'étoffe Ol! l'ollvrage fm deux en(uples éloi–
gnées l'une de l'autre de qtlelques piés ;
&
par le
moyen de leviers appliqués dans des trous prati–
'lues aux quatre exh'émités de ces deux enfuples,
le dil!endre & lai donner plus d'aunage. Cette ma–
noouvre eíl:expreífément défendue parlesreglemens.
Yoye{
RAMER, DRlI.PERIE.
Allonger
fe dit encore d'une chalne qui devenuc
trop COlLrte pour fournir la qtlanrité d'ouvrages d'tm
meme deffein cIue 1'on defue, s'
allonge
d'une atltre
'charnc qtl'on lui ajoftte , par le tordage & par les
noouds.
Yoye{TORDAGE
(/
NmuDs.
ALLOUÉ, adj. pris fub.
(Jurifprud.
)
eíl: un Ol!–
vrier
~ui
apres fon apprentiífage nni, s'eíl: encorc
engage
a
travailler pendant quclque tems ponr le
compte de fon maltre.
AlloiiJ
s'el! dit auffi , particulierement en Breta'–
gne, du Subilitllt ou bieutenant général du Séné–
chal.
Allouyfl
ou
alloije
,
étoit la
char~e
ou dignité
de
l'Allolié,
pris en ce dernier fens.
(H)
ALLOUÉ
d'Imprim.
f.
m. c'eíl:un e(pece d'ouvrier
apprenant l'art de l'Imprimerie , difFérent de
l'ap–
prentif
en ce c¡ue ce derruer
,s'il
el! reS:ll comme ap–
prentif, peut parvenir
a
la maitri(e , all lieu qtle le
premier ,
en~agé
fous la dénóminarion
d'Alloii';,
ne
peut jamais etre plus c¡u'ouvrier
a
la journée , (ui–
vant les Reglemens de la Librairie & Imprimerie ,
&
en con(équence de (on propre engagement.
ALLOUER ,
V.
aél:.
(Jurifpru.d.
)
e::'ell approuver
quelque chofe. Ce terme s'employe íingulierement
en parlant des artieles d'un compte ou d'un mémoi–
re; en
allolier
les artieles , c'eíl: reconnoltre que ces
arrieles ne (ont pas (ufceptibles de conteíl:arion , &
Y acqtlÍefcer; ce qtli (e peut faire purement & íim–
plement, ou avec des refuiéüons & modifications.
D ans le premier eas , l'allocation s'exprime íimple–
ment par ces mots,
allolié tel article.
Dans le fecond
cas , on ajOllte ,
pour lajomme de tanto
(H)
*
ALLUCHON
Olt
ALICHON ,
f.
m.
terme de Ri–
viere
.,
elpece de dents ou de pointes de bois qlli font
placés-dans la circonférence d'tme grande roue , &
c¡ui engrainent entre les nlfeaux d'une lanterne elans
les moulins& les autres machines qui ont eles roues.
Les
alluc/LOns
elifferent eles
dents,
en ce qtle les elents
font corps aVec la roue, & font prifes fur eUe; au
lieu que les
alluchutts
font eles pieces rapportées. La
parric qui fait dent & qtlÍ engraine, s'appeUe
la
téte
de l'alluchon;
celle qui efr emmortoi(ée ou aífemblée
de c¡uelqtle fas:on qtte ce {oit avec la roue, s'appelle
la 'lueue de l'aLLuchon.
Toutes les éminences ou dents
qu'on appers:oit
a
la partie fupérieure c
e
du rouet,
.pl.
JI.
ardoifes ,jig.
2.
s'appellenteles
alluchons.
Vous
en
verre{
encore
ti
la
Pl.
VI. des Forges
,
& elans un
granel nombre d'autres enclroits de nos Planches.
ALLUMÉ, adj.
eermedeBlaJoll;
i1 (e elit eles yeux
des animauxI'orfc¡u'ils font d'une autre couleur qtle
letu corps. On le dit auíIi el'un b'i'tcher araent, &
d'un flambeau dont la flamme n'efr point de meme
coulem. D 'azur
a
trois flambeaux d'or
allumés
de
p~~
.
Perrucarel de Balon en Savoie, de finople
a
troís
tetes de perroquets d'argent,
aLlltmées
& beqtlées de
glleules, au chef el'argent, chargé d'tme croix tre–
flée de (able.
(V)
ALLUMELLE, ouril de
Tabletiers Peigniers
,
éfr un
tron<;on ele lame ele couteau, dont le tranchant eíl:
aigui[é d'un (eul coté, comme celui el'un ci{eau de
Menuiúer. Cet outil lem (ert
a
gratter les matieres
dont les peignes
{Ont
faits ,par exemple,le buis,l'ivoi-
Tome
l.
ALM
re, l'écaille, la come, comme ils feroient avec un
m~rceau,
ele
ver~e
, qui efl troJ.>
canan~ 'p0u~· qu'il~
plll/Tent s en ferV1r
a
cet ulage. L ya eles ouvners ql1l
e~mal1che~t
cet outil dans un manche (emblable
a
celui el'une lime.
,*
ALLUMETTE,
f.
f. perit fétu ele bois(ec
&
blanc~
de ro(eau, de chenevotte, ele (apin, [oufré par les
deux bouts ; fervant
a
alltmlcr la chanelelle , & ven–
du par les grainetiers
&
les fmitieres.
Lesallulllettes
payent el'entrée de'ux (óls le cent,
&:
un fol ele (ortie.
ALLURE, (. f. c'efr la maniere de marcher eles
betes. Ce mot s'applic¡ue en Morale
a
la c'oneluite,
&
fe prend e\l mauvaife parto
AtLURES ;
r.
f.
plur. (
MaiuIge.)
tram, marche
d'un cheval. Les
~llures
clu cheval font le pas, I'en–
tre-pas, le trot, 1amble, le galop, le traqtlenard,
&
le train rompu.
Voye{
chacun ele ces m'Ots
a
lems
lettres. bn elit qu'un cheval
'1
les
al/uresftiJides
quand
illeve tres-peu les jambes de devant-en cheminant.
Une
allure réglée,
c'ea
celle qtl'on fait aller au che–
val, en(orte qu'il aille tOlljours égalemcnt vlte.
(V)
.
~LL.USION,
f.
f.
(Liuératu:e.)
eh: une figure ele
t
Rhetonque, par laquelle on ela une chofe qui a dll
rapport
a
une autre, fans faire une mention expreífe
de celle
~
laquelle elle a rapport. Ainli
¡ubir le joug,
efr
u~e al1.u~on ~
l'ufáge eles Anciens ele fairé paífer
lcmrs ennemlS vamcus fous une traveT(e dé bois por-
tant (ur eleux montans , lac¡uelle s'appelloit
jUO'Ufn.
Ces (ortes d'alIuíions, quand elles ne (ont point"trop
obrcures, elonneñt ele la noBleue & de la grace au
difcours.
,
Il Ya une autre erpece d'
all'ffion
qui conliíl:e elans
un jt!ft ele mots, fondé (ur la reífemblance eles (ons ,
telle que celle qtle faifoient les Romains (ur le nom
de l'Emperem Tiberius Nero , c¡u'ils appelloient
Bi–
berius Mero;
ou celle qu'on trouve dans Quintilieri
(ur le nom d'un certain Placidus, homme aigre &
caufric¡ue, elont en otant les deux prcmieres lettres
on fait
acidus.
Cette fecónclé (ohe
d'alllifion
efr or–
elin¡¡irement froide & ini'ipicle.
. te mot vient de la prépoútion Latine
Ú,
& de
lfldere,
joiier; parce qu'en effet
l'
allufion
eh un jelL
ele pen(ées ou de mots.
(G)
.. Une ob(ervarion
a
faire (ur les
alüifions
en gé–
néral, c'efr qu'on ne eloit jamais les tircr que ele fu–
jc::ts connus, en(orte qtle les aucliteurs ou les leél:eurS
n'ayent pas befoin de contenrion el'e(prit pour en
[ailir le rapport, aüttement elles font eh pure perte
pour celui c¡ui parle ou qui écrit.
ALLUVION, f. f.
(Jurifpntdence.)
dans le Droit
civil
efr.unaccroi1fement qtli fe fait par degrés au
rivage ele la mer, ou
a
la rive il'un fleuve, par les
terres que l'eau
y
apporte.
Voye{
ACCESSION.
Ce mot vient elu Latin
aLLuo,
laver , baigner.
Le Droit TOmain met
I'dlluviolÍ
entre les moyens
legitimes el'acc¡uérir;
&;
le définit un accroiífement
lateni
&
imperceptible. Si elonc une portion tonlielé–
rabIe el'un champ efr emportée toute en une fois par
un eléborelement,
&:
jointe
a
lm champ voiíin, cette
portion de terre ne (era point acc¡iúfe par clroit d'al–
luvion, mais pourra etre réclamée par le proprié–
raire.
(H)
ALMADIE, (.
f.
On appelle ainíi une petite bar–
que dont (e fervent les Noirs ele la cote d'Afric¡ue;
elle eíl: longue d'environ vingt piés ,
&
faite pom
l'orelinaire d'écorce el'arbre.
C'efr auffi un bíltiment dont on f¡: (ert elans
l'Inele~'
qtli a 80 piés de long (ur íix
a
(ept piés de large. I1
reífemble
a
une navette ,
a
la referve de fon arriere
qlli efr quarré.
Les habitans de la cote de Malabar,
&
fur-tollt
le Roi de Calicut, (e (ervent de ces
almadies,
que
l'on nornme auffi
cathuri.
Ils en arment en tems de
gllerre jufqtl'a dellx ou trois cens; ils les font (oU"
Oq
















