
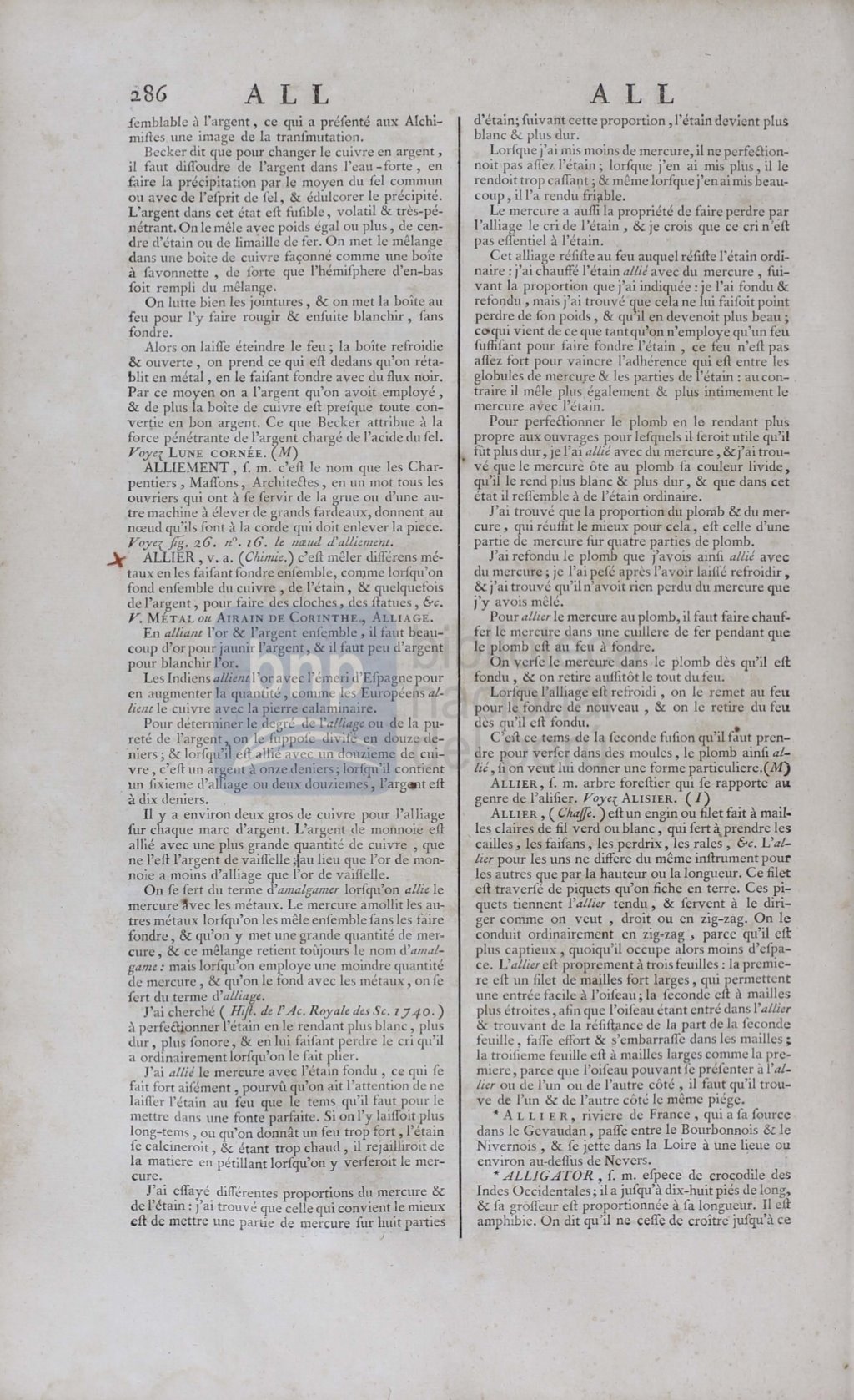
286
ALL
femblable
a
l'argent, ce qui a préfenté aux Alcru–
mifl:es tme image de la tranfmutation.
Becker dit que pour changer le cuivre en argent>
il faut dilfoudre de l'argent dans l'eau -forte, en
faire la précipitation par le moyen du [el commun
on avec de l'e[prit de [el,
&
édulcorer le précipité.
L'argent dans cet état efl: fulible, volatil
&
tres-pé–
nétrant. On le mele avec poids égal ou plns, de cen–
dre d'étain ou de limaille de fer. On met le melange
dans une bOlte de cuivre fas:onné comme une bOlte
.a
[avonnette , de [orte que l'hémifphere d'en-bas
{oit rempli du melange.
On lutte bien les jOl11tures,
&
on met la boite an
feu pour l'y faire rougir
&
enCuite blanchir, fans
fondre.
Alors
on laiíl'e éteindre le fen; la bOlte refroidie
&
ouverte, on prend ce qui efl: dedans qu'on réta–
bEt en métal, en le faifant fonch'e avee du flux noir.
Par ce moyen on a l'argent qu'on avoit employé,
&
de plus la bOlte de cuivre eíl: prefc¡ue toute con–
vertie en bon argentoCe que Becker attribue
a
la
force pénétrante de l'arl}ent chargé de l'acide du [el.
Voye{
LUNE CORNÉE.
(M)
ALLIEMENT,
r.
m. c'efl: le nom que les Char–
pentiers >Malfons, Architeél:es, en un mot tous les
ouvriers qui ont
11.
[e fervir de la grue ou d'une au–
tre machine
a
élever de grands fardeaux, donnent au
nreud qu'ils font
a
la corde qui doit enlever la piece.
Voye{
Jii.
26.
nO. z6.
le
lU1llld d'alliement.
X
ALLIER,
V.
a.
(Chimie.)
c'eíl: meler diJférens mé–
taux en les fai[ant fondre enfemble, COTl)me lorfqu'on
fond enfemble du cuivre , de l'étain,
&
quelquefois
de l'argent, pour faire des c1oches> des ilatues ,
&c.
r.
MÉTAL
Olt
AIRAIN DE CORINTHE., ALLIAGE.
En
altiam
l'or
&
l'argent enfemble, il faut beau–
coup d'orpour jaunir I'argent,
& iI
fatit peu d'argent
pour blanchir I'or.
Les Indiens
allient.\
'or avee l'émeri d'Efpagne pour
en augmenter la quantité, comme les Européens
al–
tiem
le cuivre avec la pierre calaminaire.
Ponr déterminer le degré de
l'alliage
ou de la pu–
reté de l'argent on le fuppofe divifé en douze de–
niers; & 10rfqu'U eil allié avec un donzieme de cni–
vre, c'eíl: tm argent a onze deniers; lor(qu'il contient
un lixieme d'allíage ou deux donziemes , l'arget1t eíl:
a
dix deniers.
n
y a environ deux gros de cuivre pour l'alliage
{ur chaque marc d'argent. L'argent de monnoie eil
allié avee une plus grande quantité de cuivre , que
ne l'eíl: l'argent de vailfelle
;~aulieu
que I'or de mon–
noie a moins d'alliage que 1'or de vaiírelle.
On fe fert du terme
d'amalgamer
lorfqu'on
altie
le
mercure lIvec les métaux. Le mercure amollit les au–
tres métaux lorfqu'on les mele en{emble fans les faire
fondre, & qu'on y met une grande quantité de mer–
cure, & ce melange retient toújours le nom
d'amal–
game,'
mais lorfqu'on employe une moindre quantité
de mercure , & qu'on le fond avec les métaux, on fe
fert du terme d'
aLliage.
J'ai cherché
(Hifl.
de l'Ac.RoyaledesSc.
Z.740')
a
perfeél:ionner I'étain en le rendant plus blanc, plus
<lur, plus {onore,
&
en lui fai{ant perdre le cri qu'il
a ordinairementlorfqu'on le fait plier.
J'ai
allié
le mercure avec l'étain fondn, ce qui fe
fait fort ai{ément , ponrvll qn'on ait l'attention de ne
laiífer l'étain au fen que le tems qn'il faut pour le
mettre dans une fonte parfaite. Si on l'y laiíl'oit plus
long-tems, ou qu'on donnat un fen trop fort , l'étain
{e
calc~eroit,
&
étant trop chaud ,
iI
reja.illiroit de
la matJere en pétillant lorfqu'on y ver{erOlt le mer–
cure.
J'ai
~ífay'é
différentes proportions du mercure &
de l'étam ; ¡'ai trouvé que celle qui convient le mieux
eil de mettre une partie de mercure (Ul' huit pa11ies
)
ALL
d'étain; fuivant cette proportion, l'étain devient plus
blanc & plus duro
Lor{que j'ai mis moins de mercure, il ne perfeél:ion–
noit
p.asalfez l'étain; lorfque j'en ai mis plus, il le
rendOlt trop calfant;
&
meme 100{que j'en ai mis beau–
coup, il l'a rendu fri¡lble.
Le mercure a aníli la propriété de faire perdre par
l'alliage le cri de l'étain >& je crois que ce cri n'eíl:
pas eíI'entiel a l'étain.
Cet alliage réfiíl:e au feu allquel réfille l'étain ordi–
naire; j'ai chauffé l'étain
allié
avec du mercure, fui–
vant la proportion que j'ai indiquée ; je I'ai fondu
&
refondu >mais j'ai trouvé que cela ne lui fai{oit point
perdr.e
~e
ron poids,
&
qu'i1 en devenoit plus beau ;
ce>qm vlent de ce que tantqu'on n'employe qu'un feu
[uf!i{ant pour faire fondre 1'étain , ce feu n'eil pas
alfez fort pour vaincre l'adhérence qui eíl: entre les
globules de mercuJe
&
les parties de l'étain; aucon–
traire il m&le plus.également
&
plus intimement le
mercure avec l'étain.
Pour perfeél:ionner le plomb en le rendant plus
propre aux ouvrages pour le{quels il {eroit utile qu'il
fUt plus dur, je l'ai
alli¿
avec du mercure, &j'ai trou–
vé que le merclll'e ate au plomb {a couleur livid e ,
qu'il le rend plus blanc
&
plus dur,
&
que dans cet
état il reífemble
a
de l'étain ordinaire.
J'ai trouvé que la proportion du plomb & du mer–
cure> qui réuffit le mieux pour cela, eíl: ceHe d'une
partie de merCtue fur quatre parties de plomb.
J'ai refondu le plomb que j'avois ainli
allié
avec
dUl1lercure; je l'ai pe{é apres l'avoir lailfé refroidir,
&
j'ai trouvé qu'il n'avoit rien perdu dn mercure que
j'y avois melé.
Pour
allier
le mercure au plomb, il faut faire chauf–
fer le mercure dans une cuillere de fer pendant que
le plomb eíl: al! feu
a
fondre.
On yer{e le mercure dans le plomb des qu'il eft
fondu , & on retire auffitot le tout du feu.
Lorfque l'alliage eil refroidi , on le remet au feu
pour le fondre de nouveau ,
&
on le retire du feu
des qu'il eíl: fondu.
C'eíl: ce tems de
la
(econde fulion qu'il f:ut pren–
dre pour verfer dans des moules, le plomb ainfi
al–
lié,
Ii
on veut lui donner une forme particuliere.(M)
ALLIER, {. m. arbre foreíl:ier qui (e rapporte au.
genre de l'ali{ler.
Voye{
ALISIER.
( 1 )
ALLIER, (
ChaJ!e.
)
eillID engin ou filet fait a mail.
les claires de
fil
verd ou blanc, qui {ert
a
prendre les
cailles, les faifans, les perdrix, les rales,
&c.
L'
al–
lier
pour les uns ne diifere du meme inilrument pour
les autres
~ue
par la hauteur oula longueur. Ce
filet
eíl: ttaverfe de piquets qu'on fiche en terreo Ces pi–
quets tiennent
j'allier
tendu,
&
{ervent
a
le diri–
ger comme on veut , droit Ol! en zig-zag. On le
conduit ordinairement en zig-zag, parce qu'il eft
plus captieux, quoiqu'il occupe alors moins d'e{pa–
ce.
L'aLliereíl:
proprement
a
troisfeuilles; la premie–
re eíl: un filet de mailles fort larges , qui permettent
une entrée facile a l'oueau; la {econde eil a mailles
plus étroites, afin que l'oifeau étant entré dans ['
allier
&
trouvant de la réftll:ance de la part de la feconde
feuille, [aiJ'e eflort
&
s'embarralfe dans les maiHes ;
la troilieme feuille eíl:
a
mailles larges cornme la pre–
miere, paree que l'oifeau pouvant fe préfenter
a
l'
al–
lier
Ol! de l'un ou de l'autre coté, il faut qu'il troll–
ve de l'nn
&
de I'autre coté le meme piége.
*
A L L
1
E R, riviere de France , qni a fa fource
dans le Gevaudan , paíl'e entre le Bourbonnois
&
le
Nivernois ,
&
{e jette dans la Loire a une liene ou
environ au-cleífus de Nevers.
*
ALLIGATOR
, {.
m. e{pece de crocodile des
Indes Occidentales; il a ju{c¡u'a dix-huit piés de long,
&
{a
~roilelu'
eíl: proportionnée a fa longueur. 11 en:
amphibie. On dit qu'il ne celfe de croitre ju{qu'a ce
















