
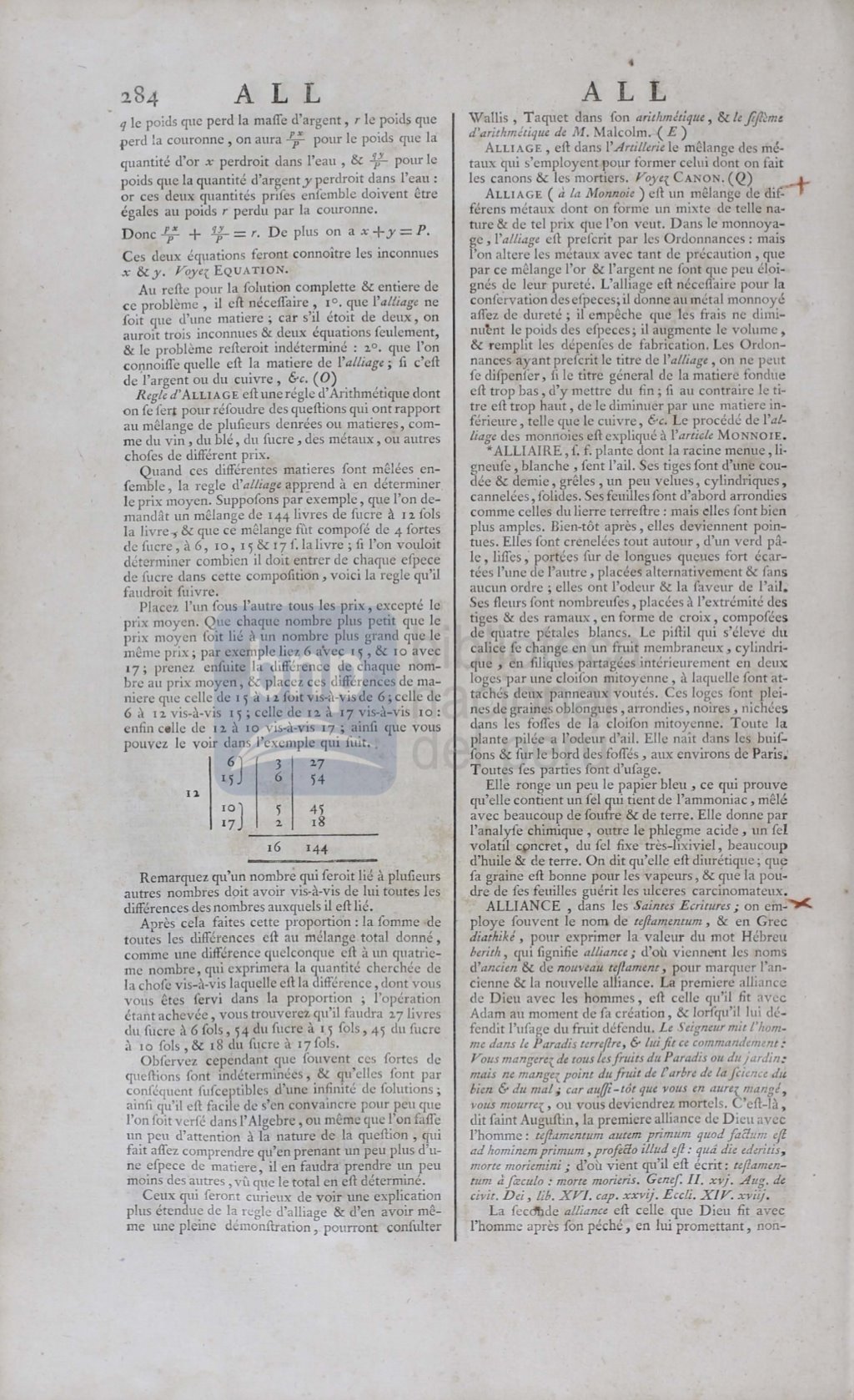
ALL
q
le poids que perd la maire d'argent,
r
le poids que
perd la couronne, on aura
P;
pour le poids que la
quantité d'or
x
perdroit dans l'eau ,
&
V
pour le
poids que la quantité d'argenty perdroit dans l'eau :
or ces deux quantités pri{es en{emble doivent &tre
égales au poids
r
perdu par la couronne.
Done
j,'"
+
9;
=
r.
De plus on a
x
+
y
==
P.
Ces deux équations feront connoltre les inconnues
.x
&y. Voye{
EQUATION.
Au reíl:e pOtIr la {olution eomplette
&
entiere de
ee probleme , il eíl: néeeiraire, JO. que
l'alliage
ne
{oit que d'une matiere ; ear s'il étoit de deux, on
auroit trois ineonnues
&
deux équations (eulement,
&
le probleme reíl:eroit indéterminé : 2.0. que l'on
connoiífe quelle eíl: la matiere de
I'altiage;
ú e'eíl:
de 'l'argent ou du cuivre,
&c.
(O )
Regle
d'ALLIAGE eíl: unerégle d'Arithmétique dont
on referí pour ré{oudre des queíl:ions qui onrrapport
an m&lange de pluíieurs denrées on matieres, eom–
me dn vin, du blé, du {ucre, des métaux, ou auU'es
chofes de différent prix.
Quand ces différentes matieres font m&lées en–
{emble, la regle
d'alliage
apP!end
a
en déterminer
le prix moyen. Suppofons par exemple, que l'on de–
mandilt un melange de 144 livres de fucre <l 12. fols
la livre.,.
&
que ce m&lange
[¡'it
compo{é de 4 forres
de {ucre, <l
6,
JO,
15
&
17
f.lalivre; íi l'on vonloit
déterminer combien il doit eno'er de chaque e{rece
de fucre dans cette eompoútion, voici la regle qu'il
falldroit fuivre.
Placez l'un fous l'autre tous les prix, excepté le
prix moyen. Que chaque nombre plus petit que le
prix moyen foit lié
a
un nombre plus grand que le
m&me prix; par exemple
liez
6
avec 15 ,
&
JO
avec
J7; prenez enfuite la différence de chaque nom–
bre au prix moyen,
&
placez ces différences de ma–
niere que eelle de 15
a
12. foit vis-a-vis de
6;
celle de
6 a J2. vis-a-vis 15; celle de 12. a 17 vis-<l-vis 10:
enfin celle de 12. <l 10 vis-<l-vis 17 ; ainú que vous
pouvez le voir dans l'exemple qui. fi.tit. ,
6J
3
2.7
15
6
54
1 :1
Remarquez qu'un nombre
qui.
feroit lié
a
plufieurs
autres nombres doit avoir vis-<l-vis de lui toutes les
différences des nombres auxquels il eíl: lié.
Aures cela faites cette proportion : la fomme de
tout~s
les différences eíl: au mélange total donné,
comme une différence quelconqlle eíl:
a
un quatrie–
me nombre, qui exprirnera la quantité cherchée de
la chofe vis-a-vis laquelle eíl: la différence ,dont vous
vous &tes fervi dans la proportion ; l'opération
étant achevée, vous trouverez qu'il faudra 2.7 livres
dn fuere <l6 fols,
54
du fucre
a
15 fols, 45 du fucre
a
10 fols
,&
18 du fucre <l J7 fols.
Obfervez cependant que fouvent ces fortes de
queilions font indéterminées,
&
qu'elles font par
conféquent fufceptibles d'une infilúté de folutions ;
ainíi qu'i1 eíl: facile de s'en convaincre pour peu que
I'on {oit verfé dans l'AIgebre, ou meme que 1'0n faire
u~
peu d'attenrion <l la naÜlre de la queilion , qui
falt airez comprendre qu'en prenant un peu plus d'u–
ne
~{pece
de mariere, il en faudra prendre LID peu
m01l1s des
a~lt!'es
, Vll que le total en eíl: déterminé.
Ceux qm {eront curieux de voir une explication
plus étendu? de la, regle d'alliage
&
d'en avoir me–
me une pleme d moníl:ration, pourront confuIter
ALL
Walli.s, Taquet dans (on
arit/¡mJtíque,
&
le
ftjl~mt
d'arit/¡métique de M.
Malcolm.
(E)
ALLlAGE, eíl: dans
l'Artilüriele
melanae des mé–
taux qui s'employent pour former cellli dgnt on fait
les canons
&
les
mortiers.
Voye{
CANON.
(Q)
ALLlAGE (
ti
la Monnoie
)
eíl: un melange de diE–
férens métaux dont on forme un
mixte
de telle na–
hlre
&
de tel
prix
que I'on veut. Dans le monnoya–
ge , l'
alliage
eíl: prefcrit par les Ol'donnances : mais
I'on altere l s métaux avec tant de précaution, que
par ce melange I'or
&
I'argent ne [ont que peu éloi–
gnés de leur pureté. L'alliage eíl: nécelraire pour la
confervarion des efpeces; il donne au métal monnoyé
airez de dureté ; il emp&che que les Erais nc dimi–
nut:nt le poids des e[peces; il augmente le volume ,
&
remplit les dépen{es de fabrication. Les Ordon–
nances ayant pre{crit le ritre de
I'alliage,
on ne pcut
{e di[pen{er, ú le titre géneral de la matiere fonclue
eíl: trop bas , d'y mettre du fin; íi au contraire le ti–
tre eíl: trop haut, de le dirninuer par une matiere in–
Eérieme, telle que le cuivre,
&c.
Le procédé de l'
al–
liage
des monnoies eíl: expliqué <l l'
article
MONNOJE.
..ALLIAIRE , f.
E.
plante dont la racine menue ,
li–
gneufe, blanche , fent l'ail. Ses riges font d'une cou–
dée
&
deI1Úe , greles ,lill peu velues, cylindl'iques,
cannelées, folides. Ses feuilles {ont d'abord arrondies
comme celles du
lierre
terreíl:re : mais elles font bien
plus amples. Bien-tot apres, elles deviennent poin–
tues. Elles [ont creneIées tout autour , d'un verd pa–
le, lures, portées fur de longues queues fort écar–
tées I'une de I'autre, placées alternativement
&
fans
aucun ordre ; elles ont l'odeur
&
la faveur de I'ail.
Ses fleurs font nombrelúes, placées
a
I'extrémité des
tiges
&
des ramaux, en forme de croix, compofées
de quatre pétales blancs. Le piíl:i1 qui s'éleve dn
calice fe change en lID fruit membraneux, cylindri–
que; en fúiques partagées intérieurement en deuJe
loges par une cIoi{on mitoyenne,
a
laqllelle [ont at–
tachés deux panneallx voutés. Ces loges font plei–
nes de graines oblongues , arrondies, noires, Ilichées
dans les foires de la cIollon mitoyenne. Toute la
plante pilée a l'odeur d'ai\. Elle nait dans les buif–
fons
&
fur le bord des
foffés,
ame environs de Paris.
Toutes fes parties font d'ufage.
Elle ronge un peule papier bleu , ce qui prouve
CJu'elle contient un [el
qtti
tient de l'ammoniac, melé
avec beaucoup de foufre
&
de terreo Elle donne par
l'analyfe chiI1Úqtle , outre le
phle~me
acide, un fel
volatil concret, du fel fixe tres-lIxiviel, beaucoup
d'huile
&
de terreo On dit qtl'elle eíl: diurérique ; que
{a graine eíl: bonne pour les vapems ,
&
que la pOlí–
dre de fes feuilles guérir les ulceres carcinomateux.
ALLIANCE , dans les
Sainm Ecritures;
on em--.,.c
ploye (ouvent le nom de
tejlamemum,
&
en Gree
diat/¡iM,
pour exprimer la valeur du mot Hébreu
heril/¡,
qtli úgnine
alliance;
d'o~1
viennent les noms
d'
ancÍen
&
de
nouyeau reflament,
pour marqtler I'an–
eienne
&
la nouvelle alfiance. La premiere alliance
de Dieu avec les hommes, eíl: celle qu'il fit avee
Adam au moment de fa création,
&
lor{qu'il lui dé–
fendit l'ufage du
fmit
défendu.
Le Seigneur mie l'''om-
me dans
le
Paradis terrejlre,
&
lui jit ce commandemem :
Vous mangere{ de touS les¡mies du Paradis ou du jardín:
mais ne mange{ poim du fruit de
L'
arlm de la fcienct du
hien
&
du mal; car alflfi-tót que vous en aure{ mangé,
VOu.s mourre{,
ou vous deviendrez mortels. C'eíl:-la,
dit faint Augullin, la premiere alliance de D iell avee
I'homme:
tejltlmemum autem primulTl
qu.odfoaulIl ejl
ad /¡ominem primum, profiao illud ejl
:
qua. die weritis,
mOTee moriemini ;
d'ou vient qtl'il eíl: écrit:
tejlamen–
mm afaculo: morte morieris. Genef.
11.
XV).
Aug. de
cÍyic. D ei, lih. XVI. cap. xxvi}. Eccli. XlV. xvii}.
La {ecdbde
allíanee
eíl: celle qtle Dieu fit avec
I'homme apres {on p 'ché, en hti promettant, nOI1-
















