
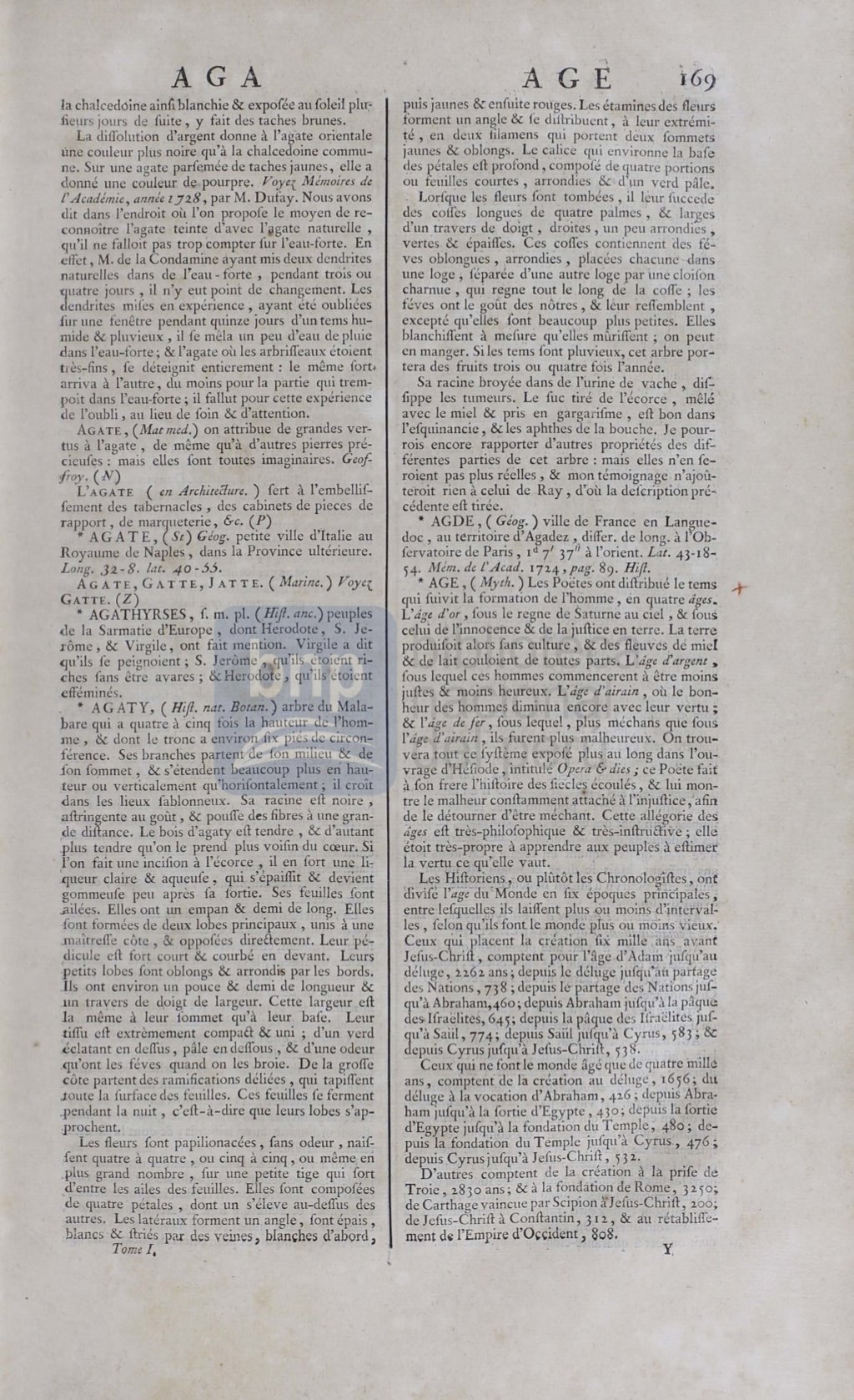
AGA
la chalcedoine ainhblanchie
&
expo{ée an foleil pIu;
fieurs jours de {uite, y
fait
des taches brunes.
La dilfolution d'argent donne a l'agate orientale
úne couleur plus noire qu'a la chalcedoine commu–
ne, Sur une aaate par{emée de taches jaunes, elle a
donné une
co~t!eur
de pourpre.
Voye{ Mémoires de
l'Académie, annJe
z.728,
par M. Dufay. Nous avons
dit
dans l'endroit oll l'on propo{e le moyen de re–
COnFlOltre I'agate teinte d'avec l'¡¡gate naturelle ,
qu'il ne falloit pas trop compter
[Uf
I'eau-forte. En
effet, M. de la Condamine ayant mis deux dendrites
naturettes dans de l'eau - forte, pendant trois
Ol!
'<juao'e jours , il n'y eut point de changement. Les
c:lendrites miíes en expérience, ayant été onbliées
:lilr une fenetre pendant quinze jours d'un tems hu–
mide & pluvieux , il [e mela un peu d'eau de pluie
¿ans l'eau-forte;
&
l'agate oh les arbrilfeaux étoient
u'es-fins, {e déteignit entierement : le meme {ort,
arriva
a
l'autre, du moins pour la partie qui trem–
l)oit dans l'eau-forte; il fallut pour cettt': expérience
de l'oubli, au lieu de [oin & d'attention.
AG~
TE,
(Mal
med)
on
a~~rib~le
de grandes
ve~tus a l agate, de meme qu a d autres plerres pre–
cieufes: mais elles font toutes imaginaires.
Geof
froy. (N)
l'
AGATE
(en Architeélure.
)
[ert a l'embellif–
fement des tabernacles, des cabinets de pieces de
rapport, de marqueterie,
&c.
(P)
*
AG ATE, (
St)
Géog.
perite vilte d'Italie an
Royaume de Naples, dans la Province ultérieure.
Long.
32-8.
lato
40-.5.5.
AG ATE, GA T TE, J AT
T
E.
(Marine.) Voye{
GATTE.
(Z)
*
AGATHYRSES, [. m. pI.
(Hijl.anc.)peuples
de la Sarmatie d'Europe, dont Herodote, S. Je–
rome , & Viraile, ont fait mention. Virgile a dit
qu'ils fe
peia~oient;
S. Jerome , qu'ils étoient
ri–
ches fans etre avares; & Herodote, qu'ils étoient
efféminés.
*
AG ATY,
(Hifl. nato Botan.)
arbre du Mala–
bare qui a quatre
a
cinq
foi~
la
haut~~r
de I.'hom–
me, & dont le trenc a envlron íix ples de clrcon–
férence. Ses branches partent de ion milieu & de
Jon fommet, & s'étendent beaucoup plus en hau–
teur ou verticalement qu'horifontalement; il croit
dans les lieux fablonneux. Sa racine eíl: noire ,
aíl:ringentt': au gout, & pouífe des libres
~
une gran–
de diÜance. Le bois d'agaty eÜ tendre , & d'aurant
plus tendre qu'on le prend plus voiíin du cceur. Si
1'on fait une inciíion a l'écorce , il en fort une
li–
L]ueur claire
&
aqueufe, qui s'épaiffit
&
devient
gommeufe peu apres fa íbrtie. Ses feuilles {ont
.;tilées. Elles ont lm empan
&
demi de long. Elles
[ont formées de deux lobes principaux , unis a une
,maitreífe cote,
&
oppofées direél:ement. Leur pé–
dicule eÜ fort court & courbé en devant. Leurs
petits lobes font oblongs & arrondis par les bords.
l1s ont environ un pouce & demi de longuem &
un travers de d,oigt de largem. Cette largeur eíl:
la meme
a
leur lommet qu'a leur bafeo Leur
tiíI'l! eÜ extremement compaél: & uní ; d'un verd
éc1atant en deífus, p¡Ue en deífous ,
&
d'une odeur
qu'ont les féves quand 011 les broie. De la groíI'e
cote partent des ramifications déliées , qui tapiífent
ioute la fmface des feuilles.
Ces
feuilles [e ferment
,pendant la nuit, c'eü-a-dire que leurs lobes s'ap–
prochent.
Les flems {ont papilionacées , fans odeur, naif–
fem quatre a quatre , Ol! cinq
a
cinq, ou meme en
plus grand nombre, [ur une petite tige qui fort
d'entre les ailes des feuilles. Elles [ont compofées
de quatre pétales , dont un s'éleve au-deífus des
alltres. Les latérallX forment un angle, font épais ,
blancs & fu;és par des veines, blanches d'abord,
Tome!.
AGE
puis jaunes & enfuite roúges. Les étamines des fleurs
forment un
an~le
& fe dillribuent, a leur extrémi–
~é
, en deux filamens qui portent 'deux [ommets
jaunes & oblongs. Le calice qui environne la hafe
~es
pétales eíl: profond, comporé de quatre portions
ou feuilles courtes , arrondies & d\ll1 verd pateo
, Lor{que les flenrs [ont tombées , il leur fuccede
des coífes longues de quatre palmes, & lar,ges
d'un,travers de doigt, droites, un peu arrondies,
yenes & épaiífes. Ces coífes contiennent eles fé–
ves oblongues , arrondies, placées chacune dans
une loge, féparée d'une auo"e loge par une cloifon
charnue , qui regne tout le long de la coífe ; les
féves ont le golit des notres,
&
léur reífemblent ,
excepté qu'elles (ont beaucoup plus petites. Elles
blanchiífent a mefu)"e qu'elles mUriífent; on peut
en manger. Si les tems font pluvieux, cet arbre por–
tera des fmits trois ou quatre fois l'année.
Sa racine broyée dans de l'i.lrine de vache, dif–
fippe les tumeurs. Le fuc tiré de l'écorce , melé
avec le miel & pris en gargarifme, eíl: bon dans
l'efquinancie, &les aphthes de la bouche. Je pour–
rois encore rapporter d'autres propriétés des dif–
férentes parties de cet arbre: mais elles n'en fe–
roient pas plus réelles,
&
mon témoignage n'ajoli–
teroit rien a celui de Ray , d'oll la de{criptlon pré–
cédente eíl: tirée.
.,. AGDE, (
G/og.
)
ville de France en Lanaue–
doc, au territoire d'Agadez" differ. de long. a lí'Ob_
fervatoire de París, 1
d
7'
3i'
a l'orient.
Lat. 43'18-
í4-
Mim. de tAcad. 1724,pag.
89.
Hijl.
*
AGE , (
Myth.
)
Les Poetes ont diíl:ribué le tems
-1"<
qui [uivit la formation de l'h?mme , én quatre
dges.
L'dge d'or,
fous le regne de Saturne au ciel,
&
fous
celui de l'innocence
&
de la juíl:ice en terreo La terre
produifoit alors fans culture, & des fleuves dé miel
& de lait couloient de toutes parts.
L'dge d'argent,
fous lequel ces hommes commencerent
a
etre moins
juües
&
moins heureux.
1'dge d'airain ,
ou le bon-
henr des hommes diminua encore avec leur vertu ;
& l'
dge de fer
,
fous lequel , plus méchans qué fous
l'dge d'airain,
ils furent plus malheureux. On trou-
vera tout ce fyíl:eme expofé plus au long dans 1'011-
vrage d'Héíiode, intitulé
Opera
&
dies;
ce Poete fait
¡¡
ton frere l'hiíl:oire des íiccles écoulés,
&
lui mon-
tre le malheur coníl:amment aúaché a l'injuilice, afin
de le détourner d'etre méchant. Cette aJlégorie des,
ages
eÜ tres-philofophique & tres-iníl:ruB'ive; elle
étoit tres-propre
a
apprendre aux peuples
a
eíl:imer"
la vertu ce qu'el1e vant,
Les Hiíl:orieqs, ou pllltot les ChronologiÜes,
opt
([ivifé
l'age
du 'M'onde en flX époc¡ues pdñclpales,
entre lefquelles ils laiífent plus
OU
moins
d'~ntetval
les, fel<;ll1 qu'ils fontle monde Efus ou
moil'!~
yiellX,'
Ceux qui placent la création fIX mille ,
áils'
avant
Je[us-Chriü, comptent pour I'fige d'Adaln jufqu'all
déluge, 12.(h ans; depuis te déluge jUfqli"áu parfage
des Nations, 73'8 ; depuis lé'pariage des Nations
juf–
qll'a Abraham,460; depuis Abraham ju{qn'a la
p~que
des Ifraelites, 645; depuis la paque des I[raelites ju[–
qu'a Saiil, 774; depuis Saiil Ju[qll'a Cyrus, í83;
&
depuis Cyrus jufc¡u'a Jefus-ChriÜ,
í3
8.
,
Ceux qui ne font le monde agé que de quatre millé
ans, comptent de la creation au délllge, 1
~
í6; du
délllge a la vocation d'Abraham, 42.6; del;)llls
Abr~ham ju[qu'a la fortie d'Egypte, 430; depUls la fOrtH;!
d'Egypte jufqll'a la fondation
~u
Temple; 480; de–
pllis la fondation dll Temple J,lúqn'a Cyrus, 476;
depuis Cyrusjufqu'¡\ Jefus-Chníl:, í 32·
D'alltres comptent de la
cr~ation
a
la pri[e de
Troie, 2.830
a~s;
&
a
la
fO,n~atl~.n
de
Rom~,
32.íO;
de Carthage va1l1cue par SClplOn aJefus-Chníl:, 2.00;
de Jeflls-Chrift a Coníl:antin, 312.,
&
a\l rétabli1I'e–
ment dI: l'Empire d'O,,;ident , 808.
y.
















