
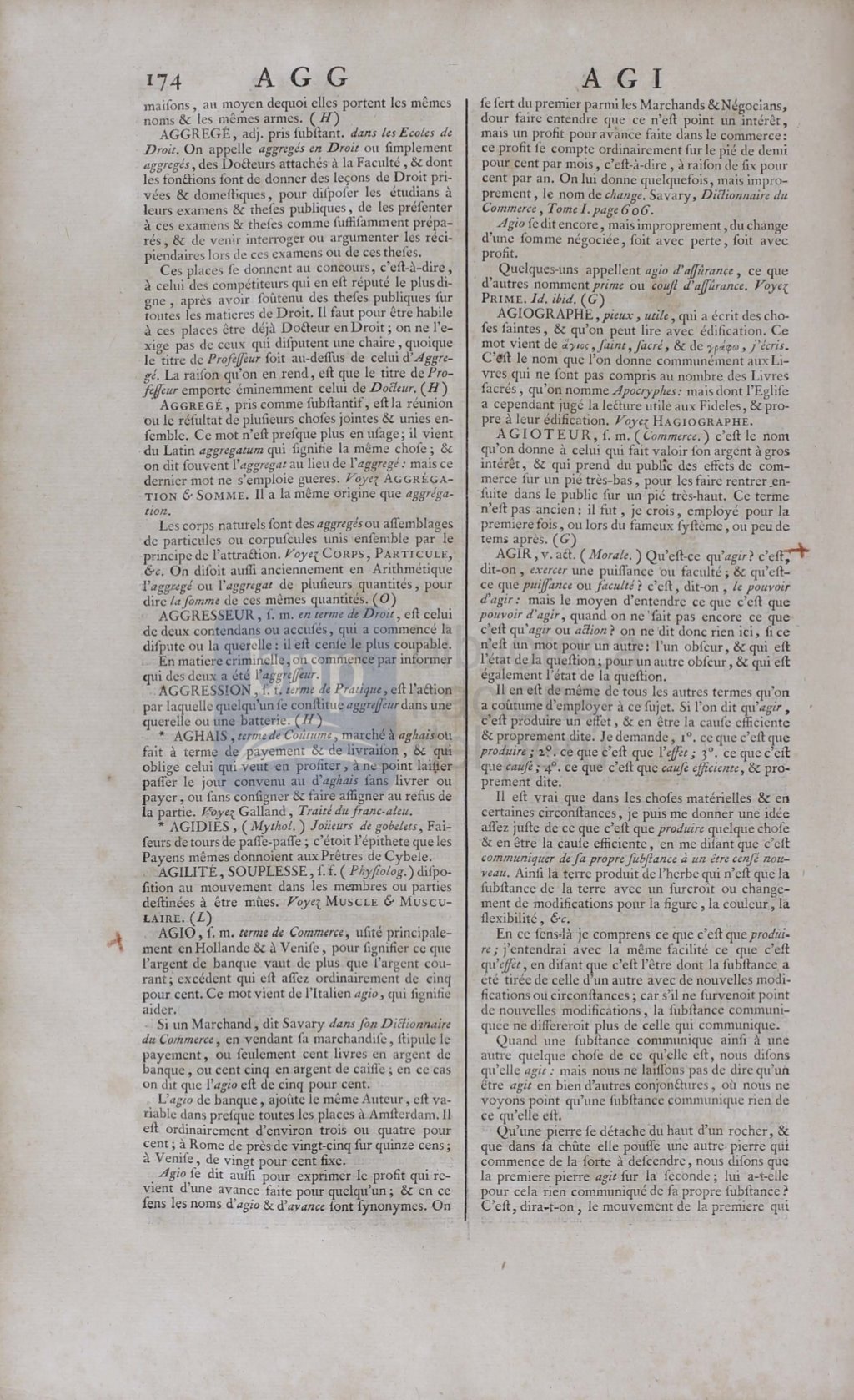
174
AGG
maifons au moyen dequoi elles portent les memes
noms &'Ies memes armes.
(H)
AGGREGÉ, adj. pris fubaant.
dans les Ecoles de
Droit.
On appelle
aggregés en Droit
Ol! íimplement
aggregés,
des DoD:eurs attachés
a
la Faculté ,
~ do~t
les fonD:ions font de donner des lec;ons de DroIt pn–
vées & domeiliques, pour difpofer les
étu~ans
a
leurs examens & thefes publiques, de les prefenter
a ces examens
&
thefes comme fuffifamment prépa–
rés ,
&
de venir interrogel' ou argumenter les réci–
piendaires lors de ces examens ou de ces tf efes ..
Ces places fe donnent
at~ concou~s,
c,ea-a-dire.,
a celui des compétiteurs qUl en eíl: repute le plus dI–
gne, apres avoir folttenu. des thefes
pu~/¡ques ~ur
toures les matieres de DrOlt. Il faut pour etre hablle
a ces places etre déj.a poD:eur en
Droi~;
on neo I'e–
xige pas de ceux qlll difputent une charre" C{uOlque
le titre de
Prof1Jeur
fOlt au-de{fus de
cel.tud
Aggre–
gJ.
La raifon qu'on en rend,
ea
que le tltre de
Pro–
fiJ!eur
emporte émínemment celui de
Do8eur.
(H )
AGGREGÉ, pris comme
fubaan~f,
eíl:la
r~union
on le réfultat de pluíietll's chofes )omtes & umes en–
femble. Ce mot n'ea prefc¡ne plus en ufage; íI vient
du Latin
aggregatum
qui íignitie la meme chofe; &
on dit fonvent
l'aggregat
au lieu de
l'aggregé,'
mais ce
demier mot ne s'emploie gneres.
Voye{
AGGRÉGA–
TION
&
SOMME. Il a la meme origine que
aggréga–
liorl.
Les corps natUl'eLs font des
agg~egés
ou alfemblages
de parcicules on corpnfcules ums enfembIe par le
principe de l'attraD:ion..Voye{ CORPS, P
~RTI ~ULE,
&c.
On difoit aníIi anclennement en Anthmetlque
l'
aggugé
Ol!
l'
aggregat
~e pln/ieu~s
,quancités, pour
dire
la flmme
de ces memes quantltes.
(O)
AGGRESSEUR, f. m.
en
tmne de Droie,
ea celuí
<le deux contendans ou accnfés, qui a commencé la
difpute ou la querelle: íl eíl: cenlé le plus coupable.
En matiere criminelle, on commence par mformer
'luí des deux a été
I'aggre./fillr.
AGGRESS!ON,
f.
f.
terme de Pratiqlle,
eal'aétion
par laquelle quelqu'un fe conftitue
aggr1Jeur
dans une
querelle ou une batterie.
(H)
*
AGHAIS,
terme de Coutume,
marché a
aghais
oh
fait a terme de payement & de livraifon , & qui
oblige celui quí veut en profiter,
a
ne point laitler
palfer le jour convenu au
d'aghais
fans livrer ou
payer, ou fans coníigner & faire aíIigner au refus de
la partie.
M>ye{
Galland,
Traieé dIe ¡;anc-aleu.
*
AGIDIES,
(Mytltol. ) Joiiellrs degobelets,
Fai–
feurs de tours de palfe-pa{fe ; c'étoit l'épithete que les
Payens memes donnoient auxPretres de Cybele.
AGlLITÉ, SOUPLESSE,
f.
f. (
Pltyjiolog.)
difpo–
fttion au mouvement dans les membres ou parties
dellinées
a
etre mlles.
Voye{
MUSCLE
&
Muscu–
LAlRE.
(L)
AGIO, f. m.
terme de Commerce,
uíité principale–
ment en Hollande
&
a
Venife, pour íignifier ce que
l'argent de banqne Vallt de plus que l'argent cou–
rant; excédent qui
ea
alfez ordinairement de cinq
pour cent. Ce mot vient de l'Italien
agio,
qui íignifie
aider.
Si un Marchand, dit Savary
dans fln D i8ionnaire
du Commerce,
en vendant fa marchandife, aipule le
payement, ou feulement cent livres en argent de
banque , ou cent cinq en argent de cailfe ; en ce cas
on dit que
l'agio ea
de cinq pour cent.
L'
agio
de banque, ajollte le meme Auteur ,
ea
va–
riable dans prefque toutes les places
a
Amíl:erdam. Il
eíl: ordinairement d'environ trois ou quatre pour
cent;
a
Rome de pres de vingt-cinq fur quinze cens;
a Veru{e, de vingt pour cent me.
. Agio
fe dit auffi pour exprimer le profit qui re–
vlent d'une avance faite pour quelqu'un; & en ce
fens les noms
d'agio
&
d'ayance
íont fynonymes. On
A G 1
fe fert
d~l
premier parmi les Marchands & Négocians,
do~r
falre entendre que ce n'ea point un intéret,
malS un profit pour avance faite dans le commcrce:
ce profit fe compte ordinairement fur le pié de demi
pour cent par mois , c'eíl:-a-dire ,
a
raifon de flx pour
cent par ano On lui donne que1quefois, mais impro–
prcment, le nom de
change.
Savary,
Di8ionnaire dIe
Comlnerce, Tome
l.
page
606.
Agio
fe dit encore, mais improprement, du change
d'une fomme négociée, foit avec perte, foit avec
profit.
Quclques-uns appellent
agio d'a1!úrance,
ce que
d'autres
nommentprime
ou
coufi d'affurance. Voye{
PRIME.
Id. ibid. (G)
AGIOGRAPHE,
pieux
,
utile,
qui
a écrit des cho–
fes fa111tes, & qu'on peut lire avec édification. Ce
mot vient de
';''YJO~
,faint ,facré,
&
de
-yp';''P'"
,
j'Jcris_
C'eíl: le nom que l'on donne communément auxLi–
vres qui ne font pas compris au nombre des Livres
facrés, '1u'on nomme
Apocrypltes,'
mais dont l'Eglife
a cependant jugé la leD:ure utile aux Fideles, & pro–
pre
a
leur édification.
Voye{
HAGIOGRAPHE.
AGIOTEUR,f.m.(Commem.) c'cale nom
ql1'on donne a celui qui fait valoir fon argent
a
gros
intéret, & qui prend du pubLic des effets de com–
~eree
fm un pié tres-bas, pour les faire rentrer _en–
hute dans le public fur un pié tl·es-hatlt. Ce terme
n'e11: pas aneien: il fut , je erois, employé pom la
premlere fois , ou lors du fameux fyíl:eme , ou peu de
tem5 apreso
(G)
AGIR, V. aD:.
(Morale.)
Qu'ea-ce
qu'agir?
c'err;+
dit-on,
exer"r
une puilfance ou faculté; & qu'eíl:-
ce que
puif[ance
ou
foculté? c'ea,
dit-en
le
pouyoir
d'agir,'
mais le moyen d'entendre ce CJl1'e c'eíl: que
pOllVoir d'agir,
quand on ne '[ait pas encore ce que
c'eíl:
qu'agtr
ou
a8ion?
on ne 'dit donc rien íci, íi ce
n'efl: un mot pour tUl autre: l'tUl obfcur,
&
qui efr
l'état de la que11:ion; pour un autre obfcur, & quí
d!:
également l'état de la quef1:ion.
Il en
ea
de meme de tous les autres termes qu'on
a colttume d'employer a ce {ujet. Si I'on dit qu'
agir ,
c'ea
produire un effet,
&
en etre la caufe efficiente
& proprement dite.
J
e demande,
¡O.
ce que
c'ea
que
produire;
:z.?
ce que
c'ea
que
l'e.ffit;
3°. ce quec'eíl:
que
callfl;
4°. ce que c'eíl: que
caufl efficiente,
& pro–
prement dite.
l!
ea
vrai que dans les chofes matérielles
&
en
certaines circonaances, je puís me donner une ídée
allá juae de ce que
c'ea
que
prodltire
ql1e1que chofe
&
en etre la caute efficiente, en me di¡¡mt 'JUe c'eíl:
communiqUe7 de fa proprefubJlance
ti
un ¿tre cenfl nou–
yeau.
Ainíi la terre produit de I'herbe ,{ui n'eíl: que la
fubíl:ance de la terre avec un {nTcrolt ou change–
ment de modifications pour la figure, la couleur , la
flexibilité,
&c.
En ce fens-La je comprens ce que c'ea que
produi–
re;
j'entendrai avec la meme facilité ce que c'efr
Cfu'effit, en difant que
c'ea
l'etre dont la fubíl:ance a
été tirée de celle d'un autre avec de nouvelles modi–
fications ou circonaances; car s'i! ne furvenoit point
de nouvelles rnodifications, la fubaance communi–
'luce ne differeroit plus de celle qui communique.
Quand une fubíl:ance comml1nique ainíi
a
une
autre quelque chofe de ce qu'elle eíl:, nous difons
'1l1'elle
agit
"
mais nous ne lai{fons pas de dire qu'tm
etre
agit
en bien d'autres conjonétures, oh nous ne
voyons point qu'une fubaance comml1niCfue rien de
ce qu'elle
ea.
Qu'une pierre fe détache du
h~ut
d'un rocher,
&
que dans fa chllte elle pou{fe une autre píerre qui
commence de la forte
a
defcendre, nous difons que
la premiere píeITe
agit
fur la {econde; lui a-t-elle
pour cela rien eommuniqué de fa propre [ubaance?
C'ea,
dira-t-on, le mOl1vement de la premiere 'luí
















