
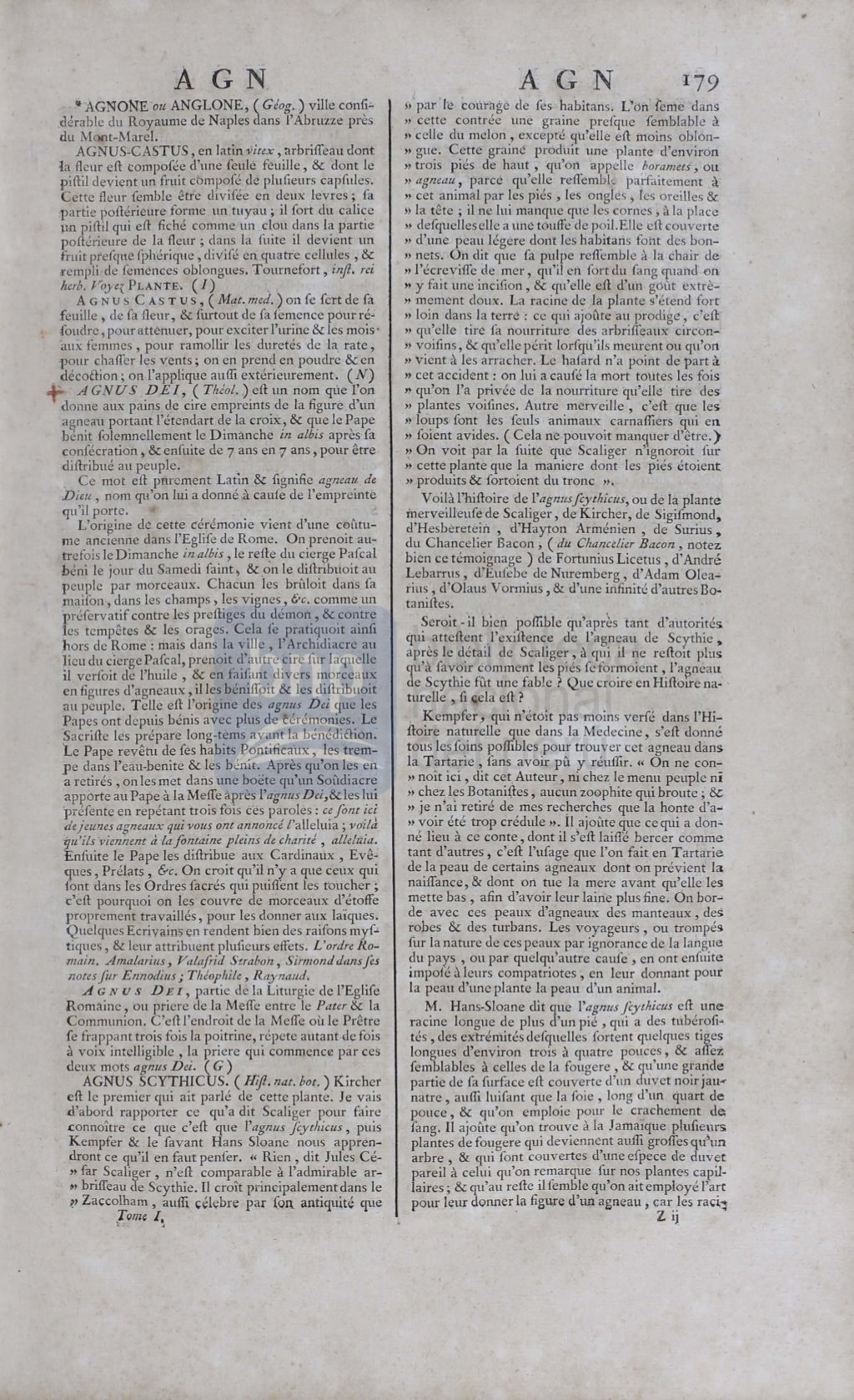
AGN
'" AGNONE
Ol¿
ANGLONE,
(Géog.
)
vme confi–
dérable du Royaume de Naples dans l'Abruzze pres
du Moot-Marel.
AGNUS-CASTUS, en latin
yitex,
arbriffeau dont
la fleur eft compofée d'une {eule fcuille, & dont le
pifiil devient un fruit cbmpofé de plufleurs capfules.
Cette fleur femble erre divifée en deux levres; (a
parcie poftérieure forme un tuyau ; JI fort du
cali~e
un
pifiil qui eí!: fiché comme un clou dans la partle
poftérieure de la flcur ; dans la fuite il devient un
fruit prefque fphérique ,divifé en quatre cellules , &
rempli de feménces oblonglles. Toumefort,
inflo
ni
herb.
ro)'t{
PLANTE,
(1)
A
G N U S
C
AS T U S , (
Mat. medo
)
on fe feTt de fa
feuille , de fa fleur, & turtout de fa femence pourré–
foudre, pouratténuer, pour exciter I'mine & les mois·
aux femmes , pour ramollir les dllretés de la rate,
ponr chalfcr les vents; on en prend en poudre & en
¿écoaion; on l'applique auffi extérieurement.
(N)
A
GNUS
DE
1,
(
Tkéol. )
eft un nom qúe ¡'on
donne aux paias de cire empreints de la figure d'un
a~neal1
portant l'éteadart de la croix, & que le Pape
benit folernnellement le Dimanche
in albis
apres fa
confécration, & enCuite de 7 ans en 7 ans, pour &tre
dií!:ribué au peuple.
Ce mot eft pnrcment Latin & íignifie
agneau de
Dietl,
nom qu'on lui a donné ,a caufe de I'empreinte
qu'iI porte.
L'origine de cette cérémonie vient d'une cOlltu–
me ancienne dans l'Eg!ife de Rome. On prenoit au–
trefois leDimanche
in albis,
le reft.e du
cier.gePa{cal
béni le jom du Samedi faint} &.on le difiribuoit au
peuple par morceaux. Chacun les brúloit dans fa
maiCon , dans les champs , les vignes,
&e.
comme un
préfervatifcontre les preiliges du démon, & contre
les temp&tes & les orages. Cela fe pratiquoit ainíi
hors de Rome : mais dans la ville , l'Arcrudiacre au
lieu du c·ierge Pa{cal, prenoit d'autre cire fur laquelle
il verfoit de I'hujle , & en fai{ant divers morceaux
en figures d'agneaux, illes bénilfoit & les difiribuoit
au peuple. Telle eí!: l'origine des
agnrtS Dei
que les
Papes ont depuis bénis avec plus de éérémonies. Le
Sacrille les prépare long-tems avant la bénédiaion:
Le Pape revetu de fes habits Pontificaux, les trem–
pe dans l'eau-benite & les bénit. Apres qu'on les en
a retirés , on lesmet dans une boete qu'un SOlldiacre
a,p~orte
au Pape
a
la MefTe apres l'
agnusDei,
& les lui
prefente en repétant trois fois ces paroles :
ceJont íeí
dejeunes agneaux qui vous ont annoizcé
l'alleluia ;
voilJ
7Ju'íls viennertt
ti
la fomaine pleins de cllaríd
,
aLLelnia.
En{uite le Pape les difuibue aux Cardinaux , Ev&–
<{ues, Prélats,
&c.
On croit qu'il n'y a que ceux qui
font uans les Ordres facrés qui puiílent les tbucher ;
c'eí!: pourquoi on les couvre de morceaux d'étoffe
proprement travaillés, pour les donner aux laiques.
Quelques Ecrivains en rendent bien des raifons my{"
tiques, & leur attribuent plufieurs effets.
L'ordre Ro–
main. Amalari/lS, Valafrid Strabon, SirmonddansJes
notesJitr Ennodius; TlLéophíle
,
Ra)'1Zaud.
.A
G N U S DEI,
parcie de la Liturgie de l'Egli{e
Romaine , ou priere de la Melfe entre le
Pater
& la
COmmllnlOn. C'eí!: I'endroit de la Melfe ollle Pretre
fe frappant trois fois la poitrine, répete autant de fois
a voix intelügible , la priere qui commenc€ par ces
deux mots
agnus Dei. (G)
AGNUS SCYTHICUS.
(Hift. nato boto
)
Kirchet
eíl: le premier c¡ui ait parlé de cette plante. Je vais
J:i'abord rapporter ce qu'a dit Scaliger pour faire
connoltre ce c¡ue c'eí!: que
l'agn/lS flythicus,
puís
Kempfer
&
le {avant Hans Sloanc nous appren–
dront ce qu'il en faut pen{er.
«
Rien , dit Jules Cé.–
»
faz: Scaliger, n'eíl: comparable
a
l'admirable ar–
., brilfeau de Scythie.
Il
crolt principalementdans le
~I
Za,colham , auffi célebre pa.
[01\
antiquité que
!',¡me
¡~
AGN
179
f,
par ·I'e colirhge de {es habitans. L'on teme dans
" cette contrée une graine prefqlle (emblable
a
,. celle du melon, excepté qu'elle eíl: moins oblon–
"gue. Cette graine prodilÍt une plante d'environ
"trois piés de haut, qu'on IIppelle
boramets,
ou
"
agneau,
parce c¡u'elle relfembk parfaitement a
" cet animal par les piés , les ongles, les oreilles
&
)) la t&te ; il ne hlÍ manque que les comes ,
~
la place
" de{quelleselle a une touffe de poil.Elle eíl: couverte
" d'une peau légere dont les habitans foht des bon–
" nets. On dit que {a pulpe relfemble a la chair de
" I'écrevilfe ele mer, qu'il en (ort du {ang c¡uand en
»
y fait une inciíion , & c¡u'elle eí!: d'un góüt cxtre–
" mement doux. La racine de la plante g'étend fort
" loin dans la terre : ce c¡ui ajoíite au prodige, c'eí!:
"qll'elte tire {a nOllrritme des arbrilfeaux circon–
" vowns, & qu'elle périt lor{qu'ils
menre.ntou qu'on
" vient a les arracher. Le ha{ard n'a point de part
a
" cet accident : on luí a cau{é la mort toutes les fois
" qu'on I'a privée de la nourriture qu'elle rire des
" plantes voifines. Autre merveille, c'eí!: que les
>}
loups {ont les feuls animaux carnaffiers qlli en
" {oient avides. ( Cela ne pouvoit manquer d'&tre.)
" On voit par la fuite que Scaliger n'ignoroit {ur
" cette plante que la maniere dont les piés étoient
" produits & {ortoient du tronc ".
Voila l'hiftoire de l'
agmtSfl)'thieus,
ou de la plante
inerveilleufe de Scaliger, de Kircher, de Sigi{mond,
cl
'Hesberete.in, d'Hayton Arménien , de Surius,
du Chanceher Bacon, (
du Clzancelier Baeon
>
notez
bien ce témoignage ) de FortunillS Licetus , d'André
Lebarrus, d'Eufebe de Nuremberg, d'Adam Olea–
rius, d'Olaus Vormius
,&
-d'une infinité d'autres Bo–
tanií!:es,
Serolt -il bien poffible
qu'apr~s
tant d'autorités.
qlli atteíl:ent I'exií!:ence de l'agneau de Scytrue,
apres le détail de Scaljger, a c¡ui il ne reí!:Olt plus
cjU'a (avoir comment les piés fe fOlmoient ,1'agneau
de Scytrue
ñlt
une fable
?
Que croire en Hiftorre na- .
trlrelle , íi ¡:ela eí!:
?
. Kempfer) qui n'étóit pas moins verfé dans I'Hí–
ftoire naturelle que dans la Medecine, s'eí!: donné
tous les foins poffibles pour trouver cet aaneau dans
la Tartarie , fans avoir pu y réuffir.
«
On ne con–
"nott ici, dit
c~t. Auteur,
ni
chez le menu peuple ni
" chez
l~s
Botam(les, aucun zoophite qui brome;
&
" je n'ai retiré de mes
rec~erches
que la honte d'a–
"voir été trop crédule ".
Il
ajoüte que ce qtlÍ a don–
né lieu
a
ce conte , dont il s'eí!: lailfé bercer comme
tant d'autres, c'eí!: l'nfage que I'on fait en Tartarie
de la peau de certains agneaux dont on previent la
naifTance,
&
dont on trie la mere avant qu'elle les
mette bas , afin d'avoir leur laine plusfine. On bor–
de
avec ces peaux d'agneaux des manteaux, des
robes
&
des tUl·bans. Les voyageurs , ou trompés
{ur la nature de ces peaux par ignorance de la langue
du pays , ou par qtlelqtl)autre cau{e, en ont enCuite
impolé a leurs compatriotes , en lem donnant pour
la pean d'une plante la peau d'un animal.
M. Hans-Sloane dit qtle
I'agnus fl)'thieus
eí!: une
racine longue de plus d'un pié, qui a des tubérofi.
tés, des extrémitésde{quelles {ortent qtlelqtles
tig.eslongues d'environ trois
a
qtlatre pouces, & aílei
{emblables a celles de la fougere , & qu'une grande
partie de {a {urface eí!: couverte d'un duvet noir jau'–
natre, auffi húfant que la foie , long d'un quart de
pouce, & qu'on emploie pour le cr.achement de;
fango
Il
ajollte qu'on ?"otn,:e
a
la Jamalque
plufie~m¡,
plantes de fougere
'1m
devlennent auffi grolfes
qu
un
arbre ,
&
qtli {ont couvertes d'une efpece de duvet
pareil
a
celui qu'on remarque {ur nos plantes capil–
laires;
&
qu'au reí!:e il femb,le qu'on aitemployé l'art
pour leur donner la figure
d
un agneau , car les
rac~~
.
Zij
















