
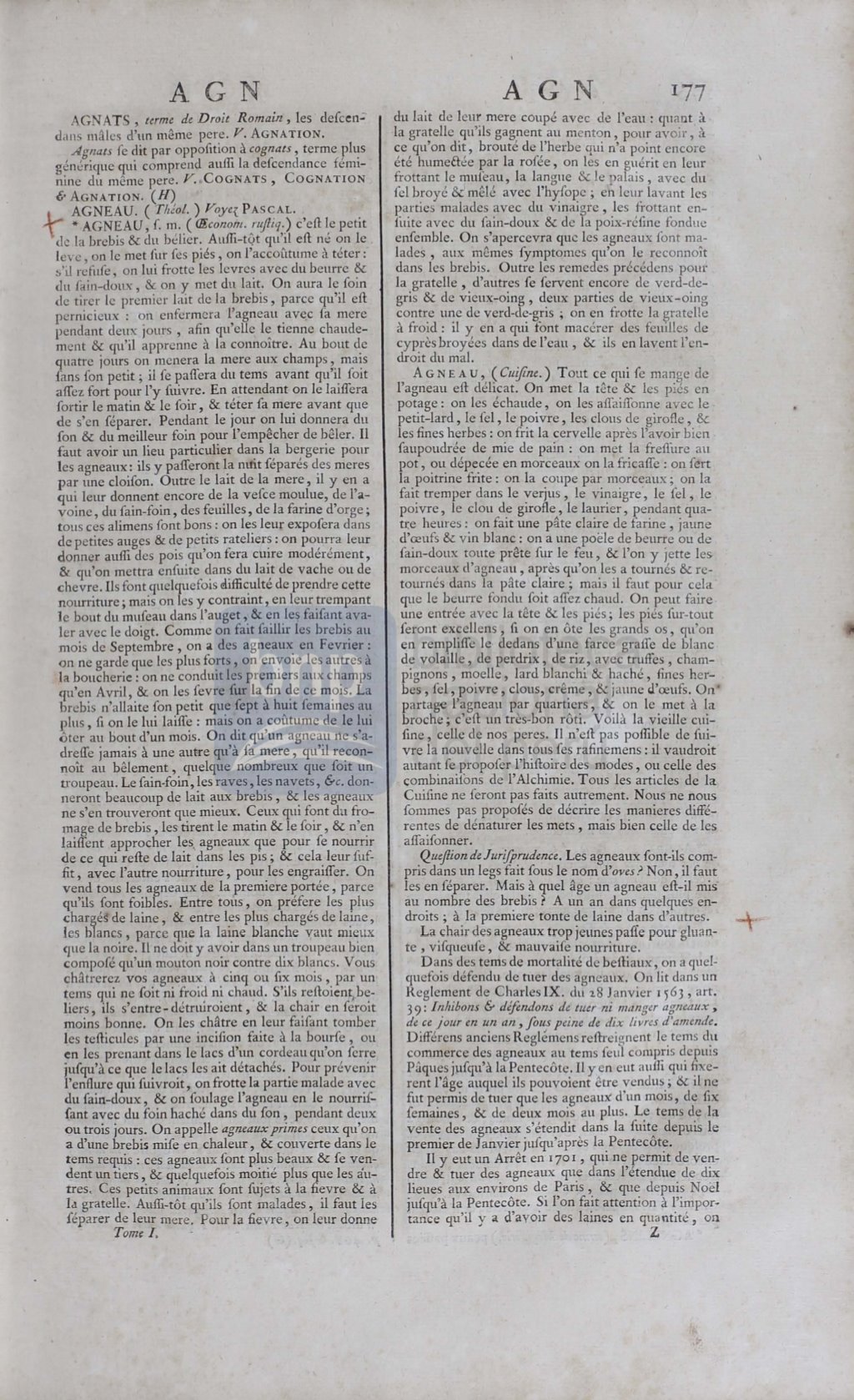
AGN
AGNATS ,
mme de Droit Romain,
les de(cen':–
d,1Il5
m¡He~
d'un meme pere.
r.
AGNATION.
A gllats
re
dit par oppoíition
a
cognats
,
terme plus
génerique qui comprend au1Ii la defcendance fémi–
nine du mcme pere. V. ,COGNATS, COGNATION
fr
AGNATION.
(H)
AGNEAU.
(TMol.
)
roye{
PASCAL.
t
*
AGNEAU,
f.
m. (
(jf.cMom. rujli'l')
c'ell: le petit
de la brebis & du belier. Auffi-tqt qu'il ell: ne on le
leve, on le met fuI' fes piés , on l'accoftülme
a
téter :
:,'il
refufe, on lui /Totte les levres avec du beurre &
du faill-doux,
&
on y met du lart. On aura le (oin
de tirer le premier lait de la brebis, parce qu'il eíl:
pernicieux : on enfermera l'agneau avec fa mere
pendant deux jours , afin c¡u'eUe le tienne chaude–
ment & c¡u'il apprenne
a
la connoltre. Au bout de
quatre jours on menera la mere aux champs, mais
úms (on petit; il fe palfera du tems avant c¡u'il foit
alfez fort pour l'y fuivre. En attendant on le lailfera
fortir le roatin
&
le foir,
&
téter fa mere avant que
de s'en (éparer. Pendant le jour on lui donnera du
(on & du meilleur foin pour l'empecher de beler. Il
faut avoir un lieu particulier dans la bergerie pour
les agneaux: ils y palferont la nuit (éparés des meres
par une cloi(on. Outre le lait de la mere, il Y en a
qui leur donnent encore de la vefce moulue, de l'a–
voine, du (ain-foin, des feuilles, de la farine d'orge;
tous ces alimens (ont bons : on les leur expo(era dans
de petites auges
&
de petits rateliers :on poun'a leur
donner auffi des pois qu'on fera c\lire modérément,
&
qu'on mettra enCuite dans du lait de vache ou de
chevre. Ils font c¡uelquefois clifficulté de prendre cerre
nourrimre; mais on les y contraint, en lem trempant
le bout du mufeau dans l'auget,
&
en les faifant ava–
ler avec le doigt. Comme on fait faillir les brebis au
mois de Septembre , on a des agneaux en Fevrier :
on ne garde que les plus fo:rs , on enyoie les alltres
a
la boucherie : on ne condlllt les premlers aux champs
qu'en Avril,
&
on les fevre fur la fin de ce mois. La
brebis n'allaite (on petit que fept
a
huit femaines au
plus, íi on le lui lai1Te : mais on a coumme de le lui
oter au bout d'un mois. On dit qu'un agneau ne s'a–
drelfe jamais a une autre qu'a (a mere, qu'il recon–
nou au belement, c¡uelque nombreux que (oit un
troupeau. Le fain-foin, les raves, les navets,
&c.
don–
neront beaucoup de lait aux brebís, & les agneaux
ne s'en trouveront que mieux. Ceux c¡ui font du fro–
mage de brebis , les tirent le matin & le (oir , & n'en
lailfent approcher les, agneaux que pour fe nourrir
de ce qui reíl:e de lait dans les piS; & cela leur (uf–
Jit,
avec l'autre nourriülre, pour les engrai1Ter. On
vend tous les agneaux de la premiere portée, parce
qu'ils font foibres. Entre tous, oa préfere les plus
chargég de laine,
&
entre les plus chargés de laine,
les blancs, parce que la laine blanche vaut míeux
que la noire. Il ne doity avoir dans un troupeau bien
compofé qu'un mouton noir contre
dix
blancs. Vous
chatrerez vos agneaux
a
cinq ou íix mois , par un
tems qui ne (oit ni /Toid ni chaud. S'ils
reíl:oien~
be–
liers, ils s'entre- détruiroient,
&
la chair en (eroit
moins bonne. On les chatre en leur faifant tomber
les tell:icules par une inciíion faite a la bourfe, ou
en les prenant dans le lacs d'tm cordeauqu'on ferre
jufqu'a ce que le lacs les ait détachés. Pour prévenir
l'enflure qui fuivroit, on /Torre la partie malade avec
du fain-doux, & on foulage l'agneau en le nourrif–
fant avec du foin haché dans du fon, pendant deux
ou trois jours. On appelle
agneaux primes
ceux qu'on
a d'une brebis roife en chaleur, & couverte dans le
tems requis : ces agneaux font plus beaux & fe ven–
dent un tiers , & quelqllefois moitié plus que les áu–
tres, Ces petits animaux (ont fujets a la nevre & a
Id
gratelle. Auffi-tot qu'ils font malades, il fam les
féparer de lem mere. Pour la nevre, on lem donne
Tome l .
AGN
177
du lait de lcm mere coupé avec de l'eal! : c¡uaot
a
la gra;elle .qu'ils gag,nent ,au menton, pour avoir , a
~e,
C¡ll
on
dl~,
brome de.! herbe qui n'a point encore
ete humeétee par la rolee , on les en guérit en leur
/Torrant le muleau, la langue
&
le nalais, avec dl!
fel broyé &'melé avec l'hyfope; eñ lcm lavant les
parries malades avec elu vinaigre, les rrottant en–
íi.tite avec du fain-doux & de la poix-réíine fondue
enfemble. On s'apercevra que les agneaux font ma–
lades , allX memes fymptomes qu'on le reconnolt
dans les brebis. Outre les remedes précédens pour
la gratelle , d'autres fe fervent encore de verd-de–
gris & de vieux-oing, d.eux parties de vieux-oing
contre une de verd-de-gns ; on en frorre la gl'atelle
a froid: il y en a c¡ui font macérer des feuilles de
cypres broyées dans del'eau, & ils en lavent l'en–
droit du mal.
AGN
E A
u,
(Cuifine.)
Tout ce qlli fe mangc de
l'agneau ell: délicat. On met la tete & les piés en
potage: on les échaude, on les alfai1Tonne avec le
petit-lard, le fel , le poivre, les clons de girofle, &
les fines herbes : on frit la cervelle apres l'avoir bien
faupouelrée de mie de pain : on met la freírure au
pot, ou dépecée en morceaux on la /Ticalfe : on fen
la poitrine frite: on la coupe par morceaux; on la
faie tremper dans le verjus, le vinaigre, le (el, le
poivre, le clou de girofle, le laurier, pendant qua–
tJ;e heures: on fait une pite claire de farine , jaune
d'reufs & vin blanc : on a une poele de beurre ou de
fain-doux t?ute prete
fll~
le
~eu,
& l'on y Í,erre les
morceatlX el agneall , apres qu on les a toumes & re–
toumés dans la pate claire; maio il faut pour cela
que le beulTe fondu foit alfez chaud. On peut faire
une entrée avec la tete & les piés; les piés fur-tout
feron! excellens , íi
00
en ote les grands os, qu'on
en remplilfe le· dedans d'une farce gra1Te de blanc
de yolaille, de perdrix, de riz, avec truffes , cham–
pignons , moelle, lard blanchi
&
haché, fines her–
bes, fel , poivre , clous, creme, & jaune d.'reufs. On'
partage l'agneau par quartiers, & on le met a la
broche; c'eíl: un tres-hon roti. Voila la vieille cui–
fine, celle de nos peres.
n
n'eíl pas poffible de fui–
vre la nouvelle dans tous fes ra/lnemens : il vaudroit
autant fe propofer l'hiíl:oire des modes, ou celle des
<;ombinailons de l'A1chimie. Tous les articles de la
Cuiíine ne feront pas faits autrement. Nous ne
OOllS
fommes pas propofés de décrire les manieres diffé–
rentes de dénaturer les mets , mais bien celle de les
a1Taifonner.
Queflion.deJurifpruden.ce.
Les agneaux font-ils com–
pris dans un legs fait fous le nom d'
oves?
Non, il faut
les en féparer. Mais aquel age un agneau ell:-il mis
au nombre des brebis? A un an dans quelques en–
droits;
a
la premiere tonte de laine dans d'autres.
La chair des agneaux trop jeunes paí'fe pour gluan–
te , vifqueufe, & mauvai[e nou.rrinrre.
Dans des tems de mortalité ele beíl:iaux,
011
a qlleJ–
qllefois défendu de nter des agneaux. On lit dans un
Reglement de Charles
IX.
dU1.8 Janvier
1563 ,
arto
39: lnlzibom
&
difCndons de t/ler ni manger agneaux,
de
ce
jour
en.
un. an., fous peine de
dix
livre5 d'amende.
Différens anciens Reglémens rell:reignent le tems du
commerce des agneaux au tems feul compris depuis
Páques jp[qll'a la Pentecote. Il yen eut auffi qui /lxe–
rent l'age auquel ils pouvoient erre vendus ; & il ne
fut pennis de üler que les agneaux d'lln mois, de íix
[emaines, & de deux mois au plus. Le tems de la
vente des agneaux s'étendit dans la [uite depuis le
premier de Janvier jufqu'apres la Pentecote.
Il y eut un Arret en
1701 ,
c¡ui ne pennit de ven–
dre
&
üler des agneaux que daos l'étendue de dix
lieues aux environs de Paris, & que depuis NoeI
jufc¡u'a la Pentecote. Si l'on fait attention
a
l'impor–
tance qu'il
y
a d'ayoir des laines en quantité , on
Z
















