
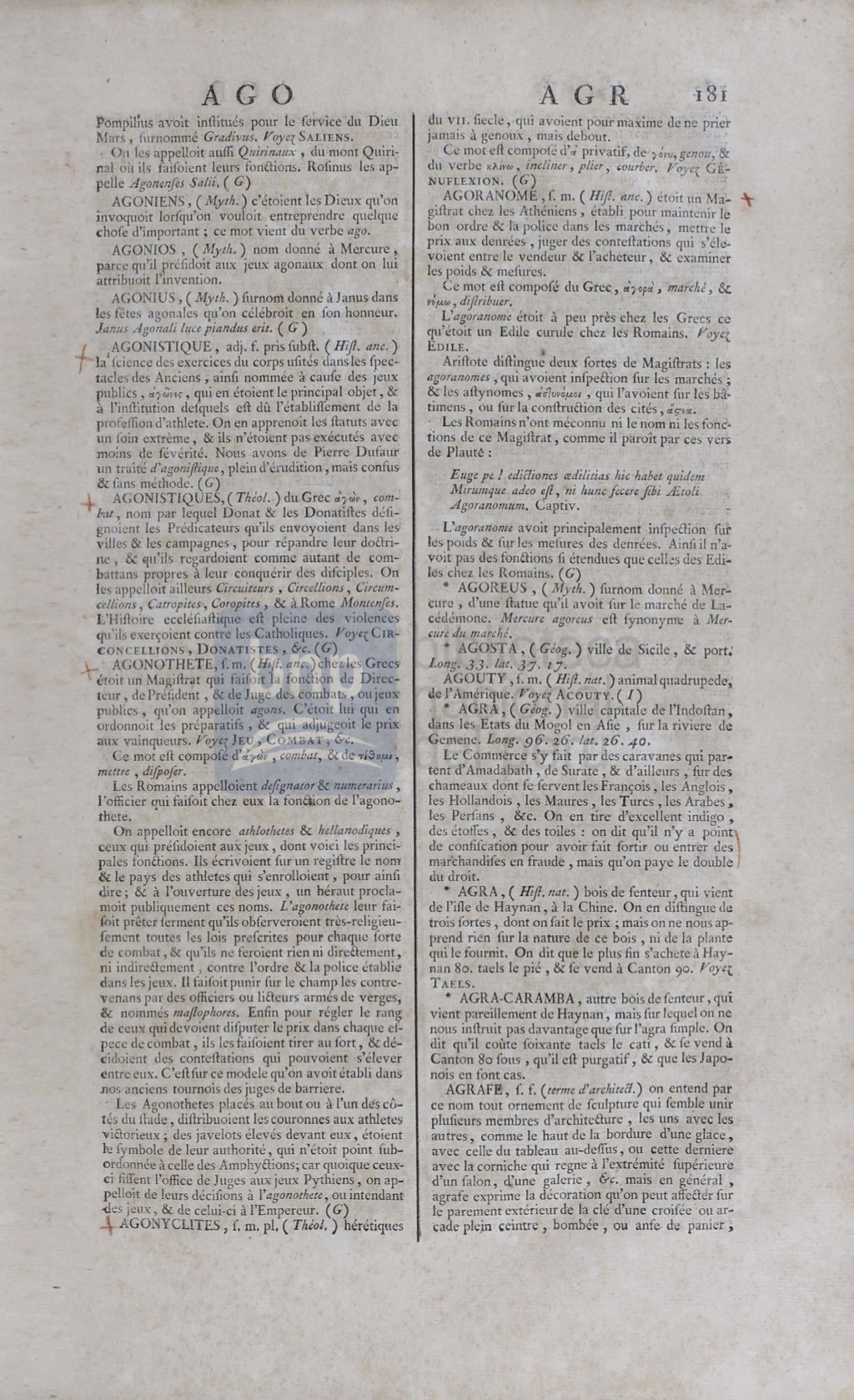
AGO
Pompilhls avoit inílitllés pour le férvke du Dietl
Mars, {urnommé
Gradivlls. Yoye{
SALIENS.
On les appelloit al1ffi
Qu¡,.intlllX
,
du mont Quiri–
nal
011
ils fai{oient leurs fonétions. Roíimts les ap–
pelle
Agonenfes Satii.
(
G)
AGONIENS, (
M,ytlL.)
c'étoient les Úienx qll'on
invoquoit lorfqu'on vouloit entreprendre quelque
chofe d'important ; ce mot vient du verbe
ago.
AGONIOS ,
(Mytlt.)
nom donné
a
Mercure ,
paree ql.l'iJ préíidoit aux jeux agonaux dont on lui
attribuoit l'invention.
AGONIUS,
(Mytlt.
)
[urnom donné
a
Janus dans
les fetes agonales qu'on célébroit en ron honneur.
Jan/M Agonali luce piandllJ erit.
(
G)
f
AGONISTIQUE, adj. f. pris {ubíl.
(HijI. aue.)
la' feience des exercices du corps ufités dansles {pec-
I tacles des Anciens , ainíi nommée
a
caufe des jeux
fublics ,
,h;;;,,~
,
qui en étoient le lJ1;ncipa1objet,
&
a l'inílitlltion defquels eíl: dí'l l'établiífement de la
profeffion d'athlete.
011
en apprenoit les íl:atuts avec
un (oin extreme,
&
ils n'étoient pas exécutés avec
moins de (évérité. Nous avons de Pierre Dufaur
un t:rait'é
d'agonijliqlle,
plein d'éruditioll , mais confus
&
fans méthode.
(G)
AGONISTIQUES, (
Théol.
)
du Gréc
d"r.J.,
com–
ba!,
nom par lequel Donat
&
les Donatiftes déíi–
gnoient les Prédicateurs qn'ils envoyoient dans les'
vjlles
&
les campagnes , pour répandre lenr dofui–
ne,
&
'Iu'iJs regardoient comme autant de com–
battans propres
a
leUT conquérir des difciples. On
les appeUoit ailleurs
Circuiteurs
,
Circellions, Cirellm–
ceUions, Cacropitc,5.", Coropites
,
&
aRome
MontenJes.
L'Hiíloire eccléíiaílique eíl plcine des violences
Cjl.l'ils exersoient contre les Catholiques.
Yoye{
CIR–
CON CELLJONS , DONATISTES,
&e.
(G)
.>-
AGONOTHETE, [. m.
(Hift.
ane.)
chez les Grecs
étoit un Magifuat qui faifoit la fonfrion de Direc–
tcur, de Préíident ,
&
de Jllge des combats , ou jellx
publics, qu'on appelloit
agonJ.
C'étoit lui (fUi en
ordonnoit les préparatifs ,
&
qui adjngeoit le prix
allx vainqueurs.
Yoye{
JEU, COMEAT,
&e.
Ce mot eíl compo(é d'.;",,;. ,
eombat,
&de
TI.$-II~I,
mettre
,
d;¡poJer.
Les Romains appelloient
difignator
&
numerarius ,
l'officier (fui faifoit chez eux la fonaion de l'agono-
thete.
.
On appelloit encore
athlotltetes
&
Itellanodiqlles ,
ceux qui préCtdoient aux jeme, dont
voici
les princi–
pales fonétions.
Ils
écrivoient (ur un regifue le nom
&
le pays des athletes qui s'enrolloient, pour ainíi
dire;
&
a
I'ouverture des jeux, un héraut procla–
moit publiquement ces noms.
L'agonot!tete
leur fai–
foit preter ferment qu'ils ob(erveroient tres-religieu–
femcnt tomes les lois pre(crites pour chaque (orte
de combat ,
&
qu'ils ne feroient rien ni direaement,
ni indireaement , contre I'ordre
&
la police établie
dans les jeux.
II
faifoit punir (ur le cham,P les contre–
venans par des officiers ou liaeul's armes de verges,
&
nommés
majlophores.
Enfin pour régler le
ran~
de ceux qui devoient di(puter le prix dans chaqtle
ef–
pece de combat , iJs les fai(oient tirer au fort,
&
dé–
édoient des conteílations cp.ú pouvoient s'élever
entre eux. C'eíl(ur ce modele qu'on avoit établi dans
nos anciens tournois des juges de barriere.
Les Agonothetes placés an bout
011
a l'un des
co–
tés dn ílade , diftribuoient les couronnes aux athletes
viaorieux ; des javelots élevés devant eux, étoient
le
fymbole de leur authorité, 'lui n'étoit point (ub–
ordonnée
a
celle des Amphyfrions; car quoique cenx–
ci fiífent l'office de Juges aux jeux Pytruens, on ap–
pelloit de leurs déciíions
a
l'
agonothete,
ou intendant
-<fes jeux,
&
de celui-ci a l'Empereur.
(G)
AGONYCLITES , (.
~1.
pi. (
TMol.
)
hérétiques
AGR
181
du VII. íieele, qui avoient pour maxime de ne prier
jamais a genoux , mais debour.
Ce mot
e~ con~po(é
d'
el
p~ivatif,
de
,,~vu,
genOll,
&
du verbe
"A"''',
lIlelcner, püer, ,ollrber. Voye{
GÉ:..
NUFLEXION.
(G)
AGORANOME ,f. m.
(HijI. IlIle.)
étoit un Ma–
giíl:rat chez les Athéniens, établi pour 111aintenir le
bon ordre
&
la police dans les marchés, mettre le
prix
allx denrées ,juger des conteíl:ations C¡lIi s'éle–
voient entre le VendeLU"
&
l'acheteur,
&
exarrunet
les poids
&
mefures.
Ce mot eíl: compo(é du Grec,
d"opd,
marché
J
&
p:'p.{,) ,
dijlribuer.
L'agoranome
étoit
a
pen pres chez les Grecs ce
qu'étoit tm Edile cumle chez les Romains.
Yoye{
EDILE.
Ariílote
cliíl:ingu~
deux fortes de Magiftrats : les
agoranomes
,
qui avoient infpeaion (ur les marchés;
&
les afrynomes ,
,l.¡¡
7u.óp.ol,
qlli I'avoient fúr les bil–
timens, ou (ur la conftruaion des cités,
.J" ....
" Les Romajns n'ont méconnu
ni
le nom ni les fonc–
tions de ce Magiíl:rat, comme il parOlt par ces
ver~
de Plaute:
Elige pe
!
ediéliones tedilitias ¡,ie habet qllidem
Mirumque adeo
ejl,
ni !lIme fieere jrJ,i Aitol¿
Agoranolllllm.
Captiv.
L'agoranome
avoit principalement infpeaion fuI"
les poids
&
fm les me{üres des denrées. Ainíi il n'a–
voit pas des fonétions
Ú
étendues que
cell.esdes Edi–
les chez les Romains.
(G)
*
AGOREUS , (
Mytlt.
)
(urnom donné
a
Mer–
cure, d'tme íl:atue qu'il avoit (ur le marché de La–
cédémone.
Mercllre agoreus
el!:
(ynonyme
a
Met–
,ure da marché.
... AGOSTA, (
Géog.
)
ville de Sicile,
&
porto'
Long.
33.
lat·3J· lJ.
AGOUTY , f. 111. (
Hij'l.
nato
)
animal quadrllpede;
del'Amérique.
I/oye{
Acoul'Y.
(1)
. *
AGRA
2 (
G¿og.
)
ville capitale de l'Indoíl:an,
dans les Etats du Mogol en Afie,
[tU"
la riviere ele
Gemene.
Long.
96.26.
lato
26.4°.
Le Commerce s'y fait par des caravanes qlú par–
tent d'Amadabath , de Surate ,
&
d'ailleurs ,
[Uf
des
chameaux dont [e (ervent les Fran<;ois, les Anglois ,
les Hollandois , les Maures, les Turcs , les Arabes ,
les Perfans, &c. On en tire d'excellent indigo ,
des étoffes,
&
des toiles : on dit qu'il n'y a point\
de confi{cation pour avoir fait (ortÍr ou entrer des
fll:.lTchandifes en fraude, mais qu'on paye le double •
du elroit.
*
AGRA, (
Hrjl.
nato
)
bois de (enteur, qui
vicnt
de l'ille de Haynan,
a
la Chine. On en di1l:.ingue de
trois (ortes , dont on Cait le prix ; mais on ne nous ap–
prend rien fur la nature de ce bojs , ni de la plante
qui le fournit. On dit que le plus fin s'achete
a
Hay–
nan 80. taels le pié,
&
(e vend
a
Canton 90.
Yoye{
TAELS.
*
AGRA-CARAMBA, autre bais de fenteur , qui
vient pareillement de Haynan, maÍs(m lequel on ne
nous infimit pas davantage que [ur I'agra íimple. On
dit ql1'il coute {oixante taels le cati,
&
[e vend
a
Canton 80 (OIlS , qll'il eíl: pnrgatif,
&
que les Japo–
nois en font caso
AGRAFE,
f.
f.
(teTme d'arehiteél.)
on entend par
ce nom tout ornement de feulptme cp.ú (emble unir
plllíieurs membres d'arcrutefrure , les nns avec les
autres comme le haut de la bordure d'une glace,
avec
~elle
du tablean
au~deíftls,
on cette derniere
avec la corniche cp.ü regne
a
I'e?,trémité (upérieure
d'un falon cl'une galerie
I
&e.
mais en général ,
agrafe
exp~"ime
la décoration cp.l'on peut affefrer [ur
le parement extérieur de la cié d'une croifée
011
ar–
cade plejn ,eintre , bombée , 'ou anfe- d'e panier;
















