
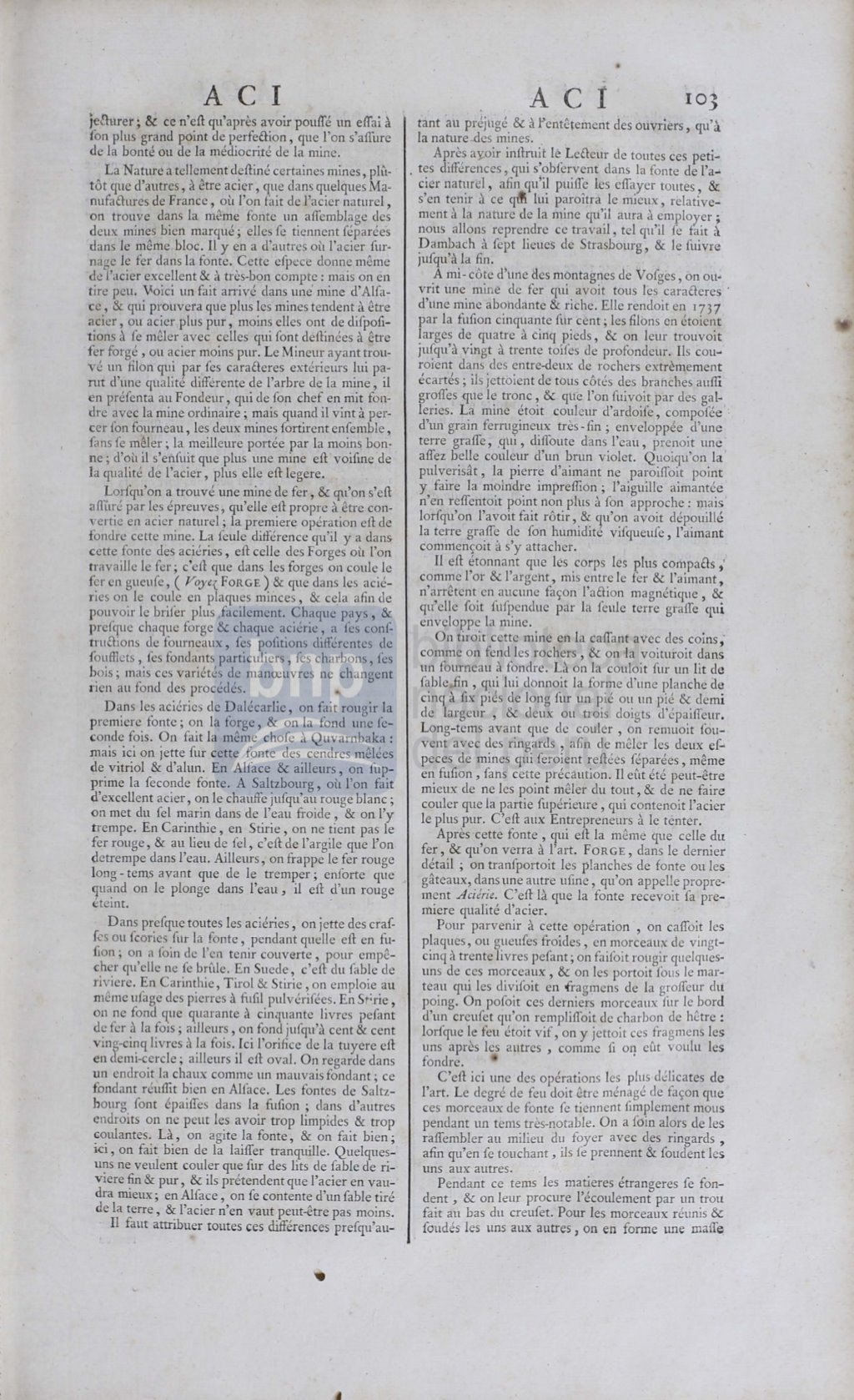
A
e
1
jefulrer;
&
ce n'ea qu'apres avoir pouiTé 1m elfai
~
ron plus grand point de perfeétion , eple I'on s'aKure
de la bonté ou de la médiocrité de la mine.
La Natme a tellement deiliné certaines mines, pllt–
tot que d'autres,
a
etre acier , que dans eplelques Ma–
nufaétures de France, 011 l'on tilit de l'acier naturel ,
on trouve dans la meme fonte un alfemblage des
deux mines bien marqué; elles fe tiennent féparées
dans le meme bloc. II y en a d'autres 011 l'acier fur–
na"'c
le
fer dans la fontc. Cette efpece donne meme
deI\,cier excellent
&
a
tres-bon compte : mais on en
tire peu. Voici un fait an;vé dans une' mine d'Alfa–
ce,
&
qui prouvera que plus
les
mines tendent
11
eU'e
acier, ou acier plus pur, moins elles ont de difpoíi–
tions a fe meler avec celles qui font dell:inées
a
etre
fer forgé, ou acier moins pUl'. Le Mineur ayanttrou–
vé un filon eplÍ par fes caraéteres extériems lui pa–
mt d'une ep,alité différente de l'arbre de la mine, ü
en préfenta au Fondeur, qui de fon chef en mit fon–
dre avec la mine ordinaire ; mais quand il vint
a
per–
cer fon fourneau, les deux mines fortirent enfemble,
fans fe meJer ; la meilleure portée par la moins bon–
ne; d'Oll
il
s'enfuit que plus une mine
ea
voifme de
la qualité de I'acier, plus elle ea legere.
Lorlqu'on a trouvé une mine de fer,
&
epl'on s'eíl:
aílllr¿ par les épreuves, qu'elle
ea
propre a etre con–
vel tic en acier naturel ; la premiere opération
ea
de
fondre celte mine. La feule ditférence qu'il ya dans
cette fonte des aciéries , ea celle des Forges 011 l'on
travaille le fer; c'eíl: que dans les forges on cOllle le
fer en gueufe, (
Voye{
FORGE)
&
eple dans les acié–
ries on le coule en plaep,es minces ,
&
ceJa afin de
pouvoil' le brj{er plus Jacilement. Chaque pays,
&
prefep,e chaque forge
&
chaque aciérie, a fes conf–
truétions de fourneaux, fes poíitions différentes de
foufflets , fes fondants particuliers , fes charbons, (es
bois; mais ces variétes de manreuvres ne changent
nen au fond des procédés.
Dans les aciéries de D alécarlie, on fait rougir la
premiere fonte; on la forge,
&
on la fond une fe–
conde fois. On fait la meme chofe
11
Qllvambaka :
mais ici on ¡elte fur cette fonte des cendres melées
de vilriol
&
d'alun. En Alface
&
ailleurs, on fup–
prime la feconde fonte. A Salt7.bourg, Olt I'on fait
d'excellent acier, on le chaulfe jufqu'au rouge blanc ;
on met du fel marin dans de l'eau froide,
&
on l'y
trempe. En Carinthie, en Stirie, on ne tient pas le
fer rouge,
&
au lieu de fel, c'eíl: de I'argile que I'on
detrempe dans I'eau. Ailleurs, on frappe le fer rouge
long - tems avant que de le tremper; enforte que
quand on le plonge dans I'eau , il
ea
d'un rouge
éteint.
Dans pre[que toutes les aciéries , on jette des cra[–
fes ou fcories fur la fonte, pendant quelle
ea
en fu–
flon; on a foin de l'en tenir couverte , pour empe–
cher qu'elle ne fe brftle. En Suede, c'ea du fable de
riYiere. En Carinthie, T irol
&
Stirie, on emploie au
meme ufage des pierres
a
fuíil pulvérifées. En St;rie,
on ne fond que quarante a cin'luante livres pe[ant
de fer a la fois ; ailleurs, on fond jufep,'a cent
&
cent
ving-cinq livres
a
la fois. lci I'orifice de la tuyere
ea
en demi-cercle; aüleurs il
ea
oval. On regarde dans
un endroit la chaux comme un mauvaisfondant ; ce
fondant réuílit bien en Alface. Les fontes de Salt7.–
bourg font paiífes dans la fuíion ; dans d'autres
endroirs on ne pellt les avoir trop limpides
&
trop
GOlúantes.
La,
on agite la fonte,
&
on fait bien;
ici, on fai! bien de la laiífer tranquüle. Quelques–
uns ne vetúent couler que fm des lits de fable de ri–
viere fin
&
pur,
&
ils
prétendent que I'acier en vau–
dra
mieux; en Alface, on fe contente d'tm [able tiré
de la terre,
&
I'acier n'en vaut petlt..etre pas moins.
Il faut attribuer tomes ces différences prefqu'au-
ACÍ
1°3
tant au préjl1gé
&
a
I'entetement des ouvriers, epl'a
la namre des mines.
Apres a)!:oir iníl:ruit le Leéteur de rolltes ces peci-
. tes différences, qui s'obfervent dans la fonte de I'a–
cier nattuel, afin qu'ü puiífe les eíI'ayer tolltes, &
s'en tellir
a
ce
qt~
lui parollra le mieux, relative–
ment
a
la nature de la mine qu'il aura a employer ;
nous aHons reprendre ce travail, tel epl'il fe fair
a.
D ambach
a
fept lieues de Strasbourg,
&
le fuivre
jlúqu'a la fin.
A mi- cote d\me /les montagnes de Vofges, on on–
vrit une mine de fer c¡ui avoit tous les caraéteres .
d'ttne mine abohdante
&
riche. Elle rendoit en 1737
par la fuíion cinqtlante nlr cent; les filons on étoient
larges de quatre
a
cinc¡ pieds,
&
on leur trouvoit
jnfc¡u'a vil'lgr a trente roí/es de profondeur. Ils
cou~
roient dans des entre-deux de rochers extremement
écartés; ils jettbient de tous cotés des branches auffi
grolfes <¡Ile le tronc,
&
qtte I'on fuivoit par des gal–
leries. La mine étoit couleur d'ardoile, compofée
d'tm grain fermgineux tres -
fin;
enveloppée d'une
ten'e graKe, .qui, diíI'oute dans I'eau, prenoit une
alfez belle couleur d'un brun violeto Quoiqu'on la
pulveris~t,
la pierre d'aimant ne paroiíI'oit point
y faire la moindre impreffion; I'aigttílle aimantée
n'en relfentoit point non plus
a
fon approche: 111ais
10rCc¡u'on l'avoit fait rotir,
&
(Iu'on avoit dépouülé
la terre gralfe de Con humidite vifqueufe, I'aimant
commen<;oit
~
s'y attacher.
Il ell: étonnant que léS corps les plus compaéts ,–
comme 1'01'
&
I'argell! , mis entre le fer
&
l'aimant ,
n'arretent en aucune fa<;on l'aétion magnétiC¡lle,
&
qu'elle {oit fufpendue par la fenle terre graífe qui
envcloppe la mine.
On tiroir cette mine en la calfan! avec des coins;
comme on fend les rochers ,
&
on la voituroit dans
un fourneau
a
fondre.
UI
on la couloit fur un lit de
fable fin , epti lui dOnnoit la forme d'une planche de
cinq
a
íix piés de long fur un pié ou un pié
&
demi
de largem , & deux ou nois doigts d'épaiíI'eur.
Long-tems avant que de couler , on remuoit fou–
ven! avec des ringards , afin de meler les deux e[–
peces de mines epIi [eroient reaées féparées, meme
en fitÍion , fans cette précáution. Il etlt été peut-etre
mieux de ne les point meler du tout,
&
de ne faire
couIer eple la partie fupérieure , qui contenoit I'acier
le plus pur. C'eíl: aux Entrepreneurs
a
le tenter.
Apres cette fonte , c¡ui
ea
la meme que celle da
fer,
&
qu'on yerra
a
I'art. FORGE, dans le derníer
détail ; on tranfportoit les planches de fonte ou les
g~teaux,
dansune auu'e uíine, qu'on appelle propre–
ment
Aci¿rie.
C'eíl: la qtle la fonte recevoit fa pre–
miere qtlalité d'acier.
Pour parvenir
a
cette opération , on caíI'oit les
plaques, ou gueuCes froides, en morceaux de vingt–
cinq a trente livres pe{ant; on faifoit rougir c¡uelques–
uns de ces rnorceaux,
&
on les portoit fous le mar–
teau epti les divifoit en íragmens de la groíI'eur du
poing. On pofoit ces derniers morceaux (ur le bord
d'un creuCet qu'on remplilfoit de charbon de
h~tre
:
lorfqtle le feu étoit vif, on y jettoit ces fragmens les
uns apres les autres , comme
íi
ol} eut voulu les
fondre.
•
C'ea
ici une des opérations les plus délicates de
l'art. Le degré de feu doit etre ménagé de fa<;on eple
ces morceaux de fonte [e tiennent íimplement mous
pendant un tems tres-notable. On a foio
al~rs
de les
raíI'embler au miliel1 du foyer avee des nngards ,
afin qu'en fe touchant, ils fe prennent
&
foudent les
uns aux autres.
Pendant ce tems les matieres étrangeres fe fon–
dent,
&
on leur procure I'écmúement par un trou
faít au bas dl1 creufet. Pour les morceal1X réunis
&
{olldés les uns
allX
autres, on en forme
~me
O1affe
















