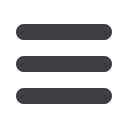
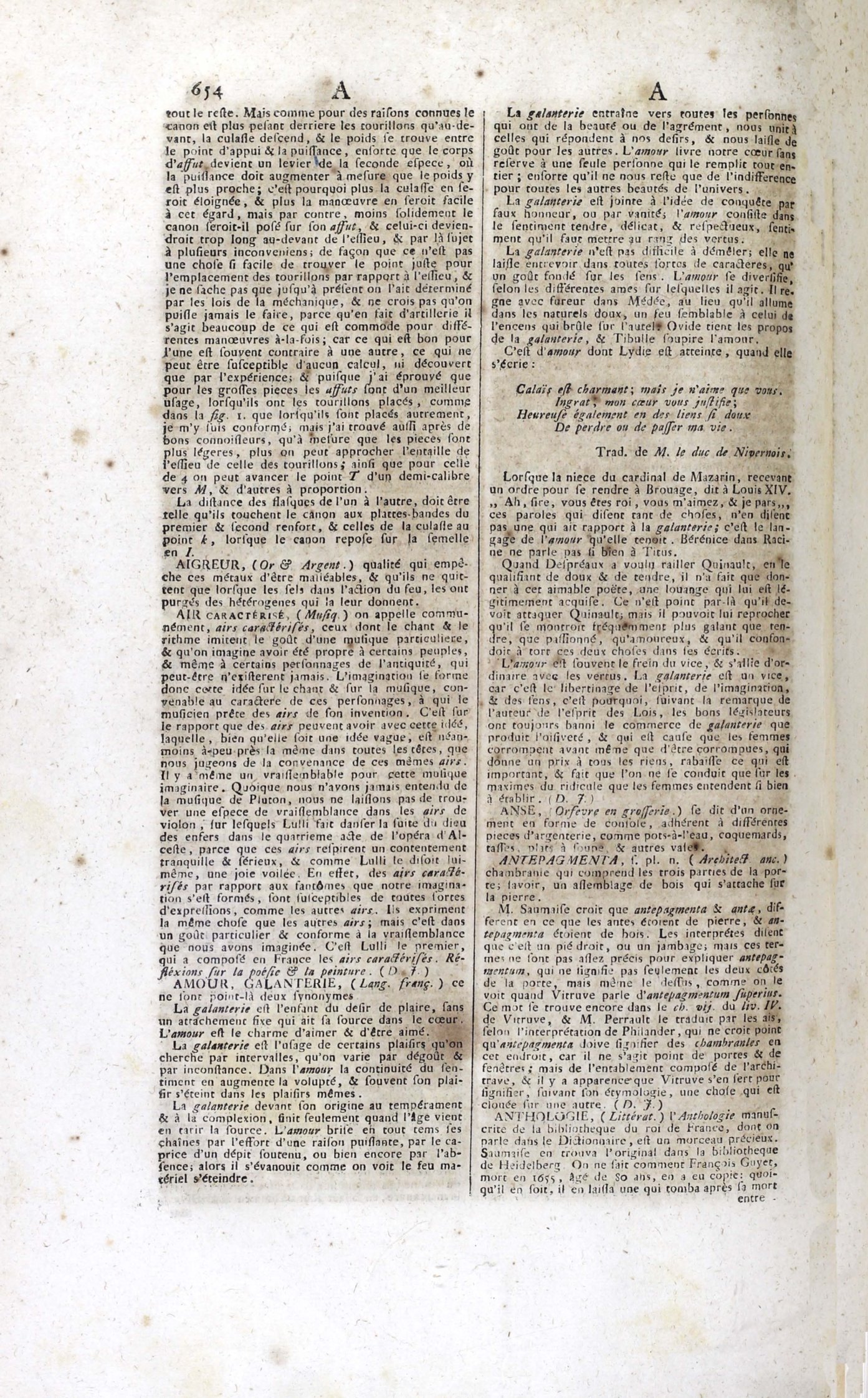
,\_
,
A
tout le re !le. Mais comme pour des raifons connues le
'(:auon efi plus pelaot derriere les couríllons
qu'<~o·de
vanr, la culaíle defcenrl,
&
le poíds fe rrouve entre
ie poi
m
d'appui
~la
puiftance, enforre qu.e le corps
d'affut
deviene un levier \de la
fecond~
efpece,
!JÚ
la ·puHian<'e doit augmenter
a
4t1efure que le poids
y
~ll
plus proche;
..:'ell
pourquoi plus la cula(fe en fe–
roit
éloignée,
&
plus la manrecrvre
en
feroi.t facile
~
cet égarJ,
mt~is
par conrre, moins folídement le
:canon feroit·il pofé fur fon
affut,.
~
cetui-ci dev_ic;n–
droit trop long a.u·devanr de l'ell1eu,
~
par
l}tlu¡et
.a
plufieurs incooveniens; de
fa~on
que
~e
n'eO: pas
une chofe
ti
f:¡cile de rrouver le point
jollt;
pour
l'emplacement des rouríUpns par rapporr
~
l'e(fieu,
&
je ne rache pas que
jufqu'~
préfent on l'ait dererminé
par les ' !oís de la
méch.aniqu~,
& ne crois pas qu'on
puille jamais le faire, paree qu'en
t~ir
d'arcillcrie
¡¡
s'agit beauco!Jp de ce quí ell commod.e pour dilfé–
Tentes manreuvres a·la-fois; car ce qui· ell: bon pour
J'une ell:
fouy~nt
comraire
a
une
aurr~'
ce qui ne
,peut etre
fufceptibl~
d'aUCUJ) calct!J,
IIÍ
<féCOUVert
qu.e par l'expériel)ce;
~
'puifque
j'
ai éprouyé <lue
.pour les groífes pieces les
uffuts
fqn~
d'un meilleur
ilfage, lorfqu'·ils onr
l~s
rourillons
placé~
,
~o
m
m
¡e
daos
la
fig.
r.
que
lorfqu'il~.
foht placés aurremenr,.
je
m'y
(uis confo,rll}é; mais J'ai r,rouvé aufij agres de
bons connoifle urs, qu'a me!'ure que les pieces fo.ot
plús lt'!,{eres, plus
on
peut approcher l'e¡WJille
<:)~
t•ellieu de celle des tf;mrilloos; !linli que pour cene '
de
~
o.n peut av'!-ncer le poiur.
T
q'ur¡ deq¡i·calihre
'Vers
M.
&
~·aurres
a
proportiOO.
La difbnce des
flafqu~s
de l'un
a
l'~utre,
doi.c erre
.telle qu'ils touchenr le can91l aux phrr,es-J.landes du
premier & (;ecood ref!fOrt,
~
cejles de la q.Jiafje
3U
poinr
k,
lort'qu!! le caqon repofe fur Ja
f~mell~
.
~n
/.
'
.
AIGR.qJR, (
Or
&
Argmt.)
qualité. qui emp.e–
che ces méraux d'etre ma11éables,
~
qu'1ls ne qutr–
tenr que lorfque les fel5 dans l'aéli(>n du feu, les 0nt
purg~s
des hétérogenes
qui
la leur donoent,
AJR
CARACTÉlu<;€ )
(
Mr1(tq. )
on appelle commu·
.né01enr,
aírs car(ifléri(és,
ceux done le chane
&
le
rirhme imüeot le gofir .d'une
ufique p3rtiaulielie'
&
qu'on imagine avoir été propre
a
certains peuples'
~
meltle
·a
cerr:¡in~ p~fonnages
de l'anriqo!té' qui
peur-c!rr~ r¡'e,illeren~
jam:tis.
Uim~ginariqu
le forme
done C(.lltte
idée
fur le cha1 r
&
fur la mufique, con–
Vt!nab!e au car..aéler'e de ces
perfon~1ages,
a
qui le
mulicien prére des
4ÍN
de fon
in~ention.
C'ell fur.
le rapperr que des
airs
peuvent avoir
av~c
cerre
i<lé¿,
l_aquelle , bien qu'elle foir une idée vagur, ell néan·
moins
a~eU • pres· la
merne dans toutes les t6tes, que
0005
jugeons de la con vennnce de CeS memes
{I_ÍI'S.
ll
y
a
' ml!me un
llradlembla91e pour cecee mohque
imaginaire. Qubique nous n'avons jamais entendu de
[a
mulique
de
Pluron, nous ne laillons pas de.
rrou~
ver une efpece de vrailifP,Jblance daos
les
(ltrs
de
viqlqn ; lur Jefqucls Lulli fair danler la fuite
du
dieu
des enfers dans le quarrieme aéle de l'opéra d' Al·
celle, paree que ces
a.irs
rel'pirent un contenrement
tranquiJte
&
Cérieux,
&
comme Lulli le dtfoir lu i–
meme' une joie voilée . En effer' des
airs Ctll;a{fé,.
rifés
par rapport aux
fanr~mes
que notre
im~gi n:t·
tion s'eO: formés, font (utCeP.tíbles de coútes torres
p'expreffions, co.mme les
autre~
airs
lis expriment
!a
m~me
chofe
q~e
les atftres
air
s;
mais c'ell daos
uo goGt paniculier
&
conforme
a
la
yrai~emblance
que nous avons imaginée.
C' efl
Lulli
le premier,
gui a compofé en Fr:tnce les
airs caraélérj{és.
R?–
.f!éxio1U
./ier la
poéfie
&
fll
peinttere.
(
D
1-
)
· AMOUR,
GALANTf:RJE,
(
~4ng.
{rlnf.)
ce
ne tone poinr-la deux ívnon'ymes
•
· La
gaiantn;it
ell l'enfJnt du delir de
pl~ire, fa~~
\10
atra'chemenc
6~e
qui air fa fource
d~ns
le
c~ur.
L'amour
etl le <:harme d'aimer
&
d'~tre
aimé.
· La
'ga~411terie
ell !'ufage de cert;¡ins
plai-lir~
qu'tm
~herche
pa·r intervalles, qu'on varíe. par. dégour_
&
par
incoo llanee . .Qans
l '•~o11~·
la
con~inutré
du
le~timcnr en augmeoce la volupcé,
~
fo\lvenr fon pla1·
fir s'éreint datis les pla ilirs mt!mes .
.
La
gala.nterie
devane .fon origiqe
a
u tetiJpérament
~
a
lá c'omplexior1, finir
feuleme!J~ qua~d
l'ige
vi~nt
~~~
tlrir la fource.
L'a111our
bri(e eh rout rems tes
~haines
par l'efForr d'une ¡:ailon
puillr~flte ,'
par le. ca–
price
d'ur1 dépit fourenu, ou b,íen ' e'ncore p3r
l'ab·
fence;
alor~
il s'évanouit comme on voit le feu
ma~
téríel
~'éteindre
•
·
'
' ··.
· ·
-
'
'
1 ..
~
•
•
~
'' • •
1
A
- La
_r.rl1111ttrit
entra
toe vers
route! les · perfonnes
qui
out
~ie
la beauté ,ou de l'agrément, nous
unir~
celles qur rép
ondenta
nos delirs, & nous laifle de
goílt pour
les
aurr:e.s.L :amottr
livre narre
c~ur
fans
rd'erve
~
une f.f'ule perfonne qui le remplir tour en–
tier;
enforre qu'il ne
nou~
refle que de . l'indifference
pour toures les
autr~ beaur~s
de l'univers.
La
ga/at;tn·ie
ell joínte
~
l'idée de conqu<!re
par
faux honoeur', ou pdr
vanir~;
l',ai110fiY
coulflle dans
Je
feQtiment cendre, délicar,
&
refpetlueux, fenr[..
~ent
ql.l'il faut !l)et•re
~u
r31')g ,des verrus.
La
galtJT}tt!rte
n'dl
NS
diflicile a démt!ler; elle
ne
laí,í]e encrevoir daos .r:olnes
Corros
de caraéleres,
qu•
t;rn gouc foudé
ftJr les
feos . L'
amor~r
fe diverlitie
felon les d itféreQ.res arnt's
furl~l~uelles
il agit.
ll
re:
gne ªvec fureur
d~ns
1\>
léd.ée., au líeu qu'il allume
daos les narur.els doux, un fe u Cemblable
a
celui
de
l'encens qui brQie rur l'a(itel Ovide rienr les propos
eJe
la
ga{a11terie,
~ Tibu.l l~
li>upíre l' amonr.
c·~ll
d' f111)0IIr
do'ot
Lydi~ -~O:Att~eín,re.
quand
~llc
s',écrie :
f;a/ai'f
e.flcharmr¡q,t; "Jais
je n'aime qtte
voru.
b¡grat, mon
c¡ztlr '!JIJttS
juflifie;
J:!eur.eufi
égt~lemcnt
en deS' lie!Js
.fi
doux
De per.dre
011
de
pajfor
11Jtl
vie
.
Tr~d.
de
M.
/p
du.c
tk
Nirurnait,'
~orf~ue
la niece du cardinal de Maz;arin, recevant
qn ord
re pour fe . rendre a Brouage, die a Louis
XIV.
, Ah,
fi.re,. vous !?res roí, voBs m:aimez,
&
je pars,,
ces paroles qui
~ifenr
ranr de cfwfes, n'eo difeot
pas
lJOf!
qui air rapport
.a
la
gt~lanterie;
c'ell le
lar~gage de
1'
qmoflr
"qu'elle teQeit . Béréoice dans
Raci–
ne ne parle pas
ti
flfen
a
Ti
rus .
Qu'and Del'préaux a :voQI!l railler Quinaulr,
en
e
qualifiant de doux
~
de rer¡dre, il n'a fa ir que don–
ner
iJ
ce~
aimqble poere, .une louange qt¡i tui t>ll lé–
girimemenr acquife. Ce
n'~ll:
poinr par-lii qu'il de–
voit arraquer Quinaulr; mais
il
po uvoit luí reprocher
qu 'i l fe monrro¡r fréqu frnmen t plus galant que ren–
dre, que p..rffionné, qu'amonreux,
&
qu'il confon·
doic
a
[Otr
CeS deo
X
Chafes dans
fes
écrits.
l
·
L'amO.!Ir
eil fouvenr le frein dn vice,
&
s'ailie d'or•
qinaire
:J
ve~
les
ver·ws.
La
,fffllt!ntt'rfe
ell un \'
rce,
car -c'ell le· liberrinage de l'el'prir, de
l'imagin~rion,
&
des
fens, c'etl poutquoi, fuivanr la remarque de
l'aureur
de
l'efprit des Lois, les bons
lé!!i~laceurs
·Ont roujonrs banni
le commerce de
ga{onterie
que
produir l'oiliveré,
&
qui ell caufe
que
les femmes
c:orroiT¡pent a vanr
mi!
me qne d'i! rre yorrompues,
qui
qonne uq pri:<
~
rous les
ri ~ns ,
rabal fle ce qoí ell
important,
&
f¡¡ir que ('on ne fe conduir que fur les .
r¡u-<imes du rid icule que les femmcs enrendenr
li
bien
~
érablir.
( D.
} :
)
ANSE,
(
Orfivr~
en
gro!forie.)
fe dit d'nn orne–
rñerir en forme 'de contor'e, adhérenr
a
différenres
pieces d'argenrerie, comme pots·a·l'eau, coquemards,
taffes ,
lJt,
a
f;>U['
,
&
autres vaf
.
dNTEPdGMENTA,
t:
pi.
n.
(
Ar~J;itt'fl.
an~·.)
chambran le qui
~.·o mp reud
les treis p<1rt1es de la por·
re; !avoir' un allemblage de bois quí s'atrache
rur
la pi erre.
1\-1.
Saumaife croir que
antepagmenta
&
(fflf4,
dif·
'fe ren t en ce que les
ante~
écotenr de pierre,
&
.'lfl·
te.pagmmtn
éroient de hois. Les inrerpréres dilent
qne c'ell un pié droir, ou un
jdmb<~ge ;
lll<liS
~es
ter–
me ~
ne fo11r pas aflez précis p0ur el(pliquer
Allttpag•
tt~e~tt1111,
qui ne ti gndie pas
fe~
lemene les deux c6cés
de
la porte, mais
nH~me
le deffus·.. .comme on. le
\!Oit quand Vícruve parle
d'a'ftepagmen.tum
foptrmr.
Ce
mor '¡e rrquve encore
Jans
le
cb. vij .
du
Jiv.
/P.
e!
e Vtrruve,
&
M. Perrault le trodu it pal' les ais',
fel0 n l'inceiprératiQn
de
Philander, qui ne croit poiot
qu'tr.>J,tepaf{me~ta.
Joive
tiJ
ifier des
c,hambranies
e!l
cec
~
enJroir, qr il ne s'agi c poillt de parees,
~ ~e
fenerres; mais de l'enrablemenr compofé de
1
aréhr–
rr¡¡ve,
&
il
y
a apparence"que Virruve s'en lert
pour
Jign ifier; fui vanr fon érymologie, une c(lo:íe qui ell
clouée
ínr
une autre.
(D.
J.. )
.
ANT HO,LüG IE,
(
Lit~éra,t.),
1'
At1fhologu
m:wuf–
crire de la bihl io rheque do roi de france , don,e on
r~rl e
cla
1~
le Qiétionn_airc, ell un morceau P:rét·1eu:.:.
Satumiíe en rrouva
1'
ori<r inal dan.s la
btbl!o~heque
de H t'idelberg On ne filie "'comrnenr
Fran~·1is G.uye~,
more en
r6S"r; ,
~gé
de So
dhs,
en a eu
copze: quor·
qu' il el'\ foic ,
U
en J¡¡ifla' une qui tomb.a apres
Ca mort
·
~
'
·
·
· ·
·
' entre .
















