
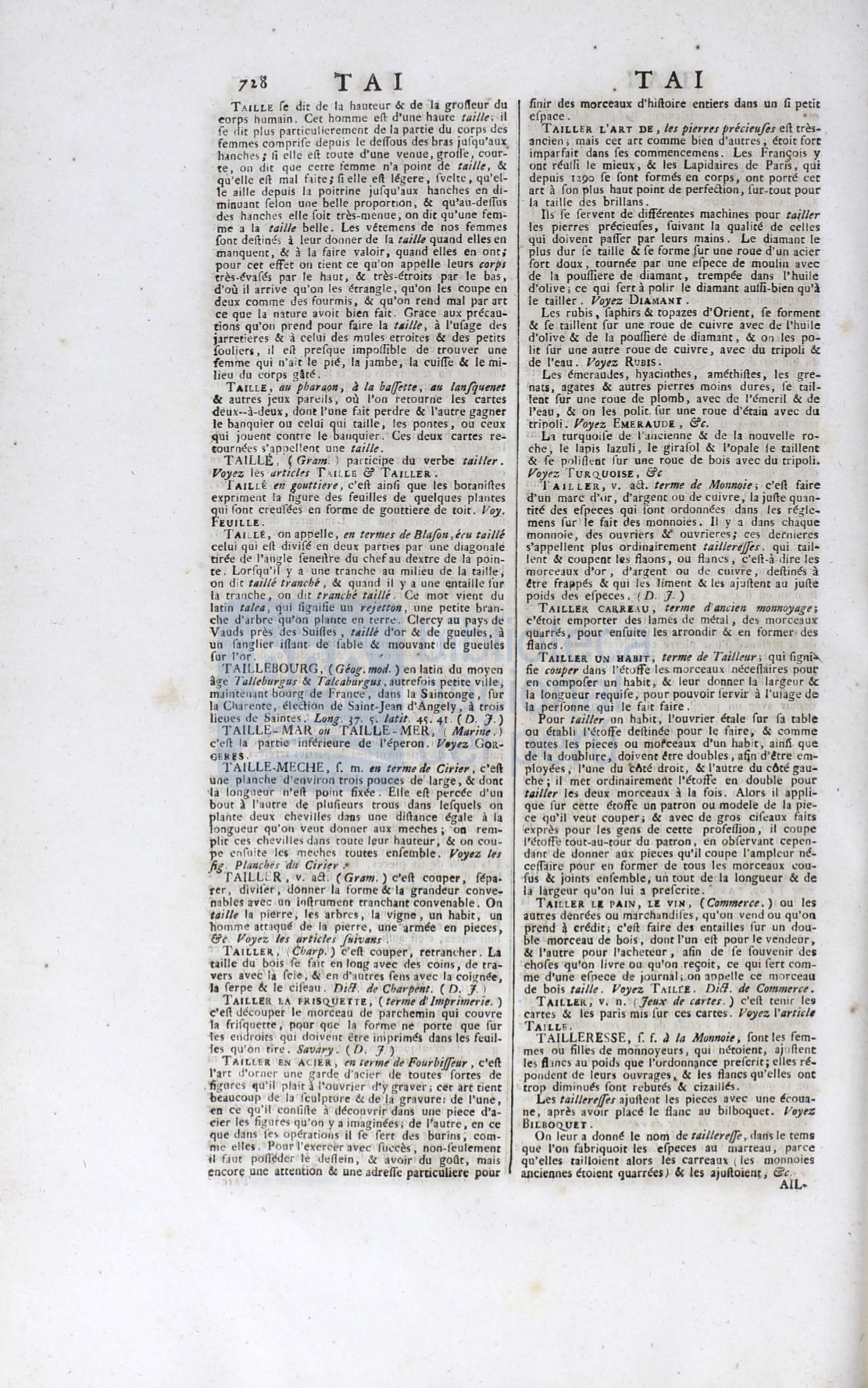
T A I
T AJLLE re dit de la haureur
&
de la grot1eur du
eorps humain. Cet homme efl: d'une .haure
rai/le ;
il
fe dit plus parriculieremenr de la partte du corps des
femmes comprifc depuis le deffous
de~
bras jufqu'au x.
h~nches ;
li elle efl: toute d'une venue, grofle, cour–
te on dit que cette femme n'a poinr de
tai//1!,
&
qu:elle efl:
m.alfaite:.
(j
.elle .ell légere, fvelte , qu'el-
1e aille depu1s
la
potmne ¡ufqu'aux hanches en d!–
minuant felon une belle proporrion,
&
qu'au-deffus
des hanches elle foir tres-men ue, on die qu'une fem–
me a la
taille
belle. Les vtremens de nos femmes
font defl:inés
i
leur donner de la
tflille
quand elles en
manquenr, &
a
la fai re valoir, quand elles en ont;
pour cet effet ou tient ce qu'on appelle leurs
eorps
tres.évafés par le haut,
&
rres-étroirs par le bas ,
d 'ou il arrive qu'on les érrangle, qu'on les coupe en
deux comme des fourmi s , & qp'on rend mal par are
ce que la nacure avoit bien fait . Grace aux précau–
tions qu'on prend pour faire la
tllifle.
a
l'ufage
d~s
jarretieres &
·a
celui des mutes etroites & des petits
foul icr', il efl: prefqqe impoaible de trouver une
fe mme qui n'ait le pié, la jambe, la cuií[e & le mi–
lieu du corps glré.
TAJLLE'
1111
pharq_on'
a
la b/J(Jittt!'
1111
lanfl¡um/!t
& autres jeux pardi ls, ou l'on rerouroe les canes
d eux--a-deux, dont !'une fait perdre & l'autre gagner
le banquier ou cel ui qui taille , les pontes, ou ceux
'4ui jouent conrre le bauquier.
Ces
deux cartes re–
~ournéts
s'appcllent une
tai!le.
TAILLÉ , (
Gram.
)
participe du verbe
tailler.
Voyez
les
úrticles
T A!LL6
&
11AJLLER .
"[
AILLÉ
m
Kouttiere,
c'efl ainfi que les boranifl:es
expriment la lígure des feuilles de quelques plantes
gui font creu'fées en forme de gonttiere de toit .
1/oy.
fEUILL!!: .
· T AI LLÉ, on arpell e,
en termes de 8/afltz ,hu tai//é
celui qui efl divifé en dcux parries par une diagonale
círée de l'angle fene1lre du chef au dextre de la poin–
te . Lorfqu'il
y
a une tranche au mil ieu de la taille ,
on dit
t11illé tronché,
& quand il y a une enraille f"ur
la
tr~nche,
'On dit
t ram·M tai/U . Ce
moc vient du
latín
talea,
q ui fignillé un
rejetton,
une perite bt·an–
che d'arbre í¡u'on plante en rerr.e . Clercy au pays de
Vauds pres des ·Suifl es,
ttúllé
d'or & de g ueules,
a
un fanglier iflant de fable & mouvanc• de gueules
[ur l'or .
'
·
TA ILLEBQ{JRG, (
Géog. mod. )
en latín du moyen
ige
Talleburgur·& Talcaburgur,
autrefois perite ville,
mainten~nt
bourg de France, dans la Sainronge, fur
la
Cl,a rente, éleélion de Saint-J ean d,'Angely ,
~
trc>is
licues de Saintes.
Long .
l 7· S·
/atit.
4S.
41. (D.
'J.)
TA!LL~-
MAR
ou
TAlLIJE- M ER, (
Marhzt! .)
c'efl: la parric
irtférieu~e
de l'éperon .
1/•yez
G9R:
l)EJ<fS .
.
TA ILLE-MECHE, r. m.
tn
terme dt! Cirie, ,
c'efl
une pl•nche d'environ trois pouces de large, & dont
·b
longueur n'efl: point fixée . Elle efl percée d'un
bout
a
l'aurre de plufieurs trous daos lefquels on
plante deux
che~illes
da:ns une difl:ance égale
a
la
longueur qu'on veut donner aux meches; oa rem–
plic ces chevi ll es
d,~ns
couce
l~ur
hauteur, & oo cou–
pe
enfuite •les mcc:hes tbutes enfem!lle .
voyez
les
.fig. Planches 'du Girier
.•
·
• TAILLER , v. a
él.
(
Gram. )
c'efl: couper, fépa–
rer , diví(er , llonner la forme &·la grandeur conve–
·nables :rvec un ínfl:rurnent tranchant convenable . On
taille
la p1erre, les arbres, la vigne
1
un habic, un
homme atraqué de la pierre , une ' armée en pieces
1
&c. f/oyez les tlrtíder foivllns
.
•
TA!LLE~
'·
(
itharp. )
c'efl: couper, retram·her. La
taille"du· bois
te
falt en loog avec
des
coins, de tra–
vers avec la f'Cie,
&
en d'autres fens avec la coig née,
la
ferpe
&
le eifeau .
&iEl. de Cbar·pent.
(D.
J.
)
TAILLER LA FRISQ...ÚEJTE, (
terme d'Jmpriinerie.
)
c'efl découper le morceau de parchemin qui couvre
la
frifquette, pqur
q~e
la forme ne porte que fur
les
endroit~
qoi doiven t erre inlprimés daos les feuil–
les qu'on
m e.
Savary . (D .
J. )
TA!LLE-R
EN
ACIER ,
en temu de Fourbiffiur,
c'efl:
l'art d'orner une aa rde d'acier de toutes forres de
. figures qu'il plait
~
l!ou.vrier d'y g raver; cet art tiene
beauco~p
•.de la
fcu l ~core
& de cla gravuret de l'une,
en ce qu ti confifle a' découvrir daos une piece d'a–
cier les ñg.ures qu'on y a im'agin.éés ; de i
1
autré ,
en
ce
que da ns fes opératious
il
fe fert des burins ; com–
me elles . Pour l'excrcer avec
flt~ces
non-feulement
il faut poMder le de!lein,
&
avoir: du go(lr, mais
¡:n;or~
.une atrenc¡on
&
une adrelle
particuli~r~
pour
T A I
finir des morceaux d'hiíl:oire enriers daos un
fi
petit
efpace.
TAJLLER L'ART DE,
/u pierru précieufir
efl: tres–
ancien ; mais cet are comme bien d'amres , écoit forr
irnparfait daos fes commencemens . Les Fran_sois y
ont réufli le mieu1¡,
&
les Lapidaires de Pans, qui
depuis
1290
fe font formés en corps, onr porré cet
art
a
fon plus haut poinc de perfeéHon, fur- tout pour
la tail le des brillans.
n s fe ferv ent de différentes machines pour
tailler
les pierres précieufes, fuivant la qualité de celles
qui doivent paffer par leurs mains. Le diamant le
plus dur fe taille & fe forme fur une roue d'un acier
fort doux, cournée par une efpece de mouliu avec
de la pouaiere de diamant, crempée dans l' huile
d'olive; ce qui ferr
a
polir le diamant auai-bien qu'l
le cailler .
Voyl!z
DiAMANT .
Les rubis , faphirs & topazes d'Orienc,
(e
forment
& fe taillent (ur une roue de cuivre avec de l'huile
d'olive & de la poulliere de diamant ,
&
on les po–
lit rur une autre roue de cuivre,
avec
du tripoli
&
de l'eau .
Voyez
Ruu¡s .
: L es émerauJes, hyacinthes, améthifles, les gre–
nats, agates & autres pierres moins dures, fe tail–
lent rur une roue de plomb' avec de l'émeril & de
l'eau, &
on
les polit. fur une roue d'étaia avec dt1
tripoli :
f/oyez
EMERAUDE ,
&e.
L a turquoife de
l'~llci~nne
& de la nouvelle ro–
che, le lapis lazuli , le girafol & l'opale fe taillent
& fe
pnli fl~nt
(ur une roue de bois avec du trípoli.
Voyez
T URQOOISE ,
&e
"T
A
1
LL
1!
a,
v. a
él.
terme de Motmoil!;
c'efl: faire
d' un marc d'ur, d'argent ou
de
cuivre, la jufl:e quan–
tité des efpeces qoi fonr ordonnées dans fes régle–
mens fur le fait des monnoies.
11
y a dans chaque
monnoie , des ouvriers
$t
ouvrieres ; ces det nieres
s'appcllent plus ordinairement
taillenffir.
qui raíl·
l<'nt & coupenc lts tlaons, ou flanes, c'efl:-3 dire les _
morcea ux d'or' d'argent ou de cuivre ' defl:ioés
a
~tre
frappés & qui les lirnenc
&
les
aj~fl:ent
au julle
poids des
e(
peces.
( D .
J.
)
TArLLI!R. CAIUI!AO,
terml! d'anáen motmoyage;
c'étoit emporter des lames de métal , des morceaux:
qoarrés, pour enCuite les arr-ondir
&
en former des
flanes .
T AIJ,.Ll!:R UN
HA
BIT,
lerm"e de Tai//eur;
qui
fign~
ñe
&Otlpt!r
daos l'étoffe les morceaux néceflaires pour
en t'Ompofer un habit ,
&
leur donner la largeur
&:
la long ueur requi(e, pour pouvoir fervir
a
l'ufage de
la .Perfonne qui le fa it faire .'
Pour
tailler
un hahit , l'ouvrier étale fur fa rabie
ou établi l'étoffe deílinée pour le faire,
&
comme
eoutes les pieces ou mofceaux d'un habit , ainfi que
de la dou.blure, doi venc
~tre doubl~s,
a
fin
d'~rre
em–
ployées, !'une du chté droit, & l'autre du cOté gau–
che; il met ordinairement l'érolfe en double pour
t11iller
les deux morceaux
~
la fois . Alors il appli–
que fur cette étoffe un parron ou modele
d~
la pie–
ce qu'il veot couper
¡
& avec de gros
cif~aux
faits
lexpres pour les gens de certe profellion, il cou pe
l'érof!'e caut-au-tour du patron , en
obferv~nc
cepen–
danr de \Jonner aux pieces qu'il coupe l'amplcur né–
ceí[:lire pour en former de rous les morceaux
~ou·fus
&
joints enfemble , un tour de•la longueur & de
la largeur qu'on lui
~
prefcrire . ·
TAILLER Lp; PAIN,
U:
VIN ,
(
Comml!l'&l!.)
OU les
aurrú denrées ou'marcl\andifes, qu'on vend ou qu'on
prerld
a
crédit; c'efl faire des entailles fur un dou–
ble morceau de bois. donr l'un ell pour le vendeur.
&
l'autre pour ltachereur, añn de
(e
fouvenir des
chofes quton Íivre ou. qu'o,n
re~oit,
ce qui fert coro–
me d'un·e e(peoe de JOUrnal; on appelle ce morceau
de bois
taill~ .
lloyez
T A:ILCE .
DiE!. de Comnzerce.
TA! L'U R, v. n.
(Jeux de etn·tes . )
c'efl: tenir leg
canés
&
les paris mis fur ces carees .
1/~yez
l'arti&l'
TA!LLE.
TAILLERESSE,
f.
f.
J
la Mo1znoie,
font les fem–
mes
o\J ñllés de monnoyéu rs , qui nétoienc, ajuflent
les lbncs au poids que
l'urdonn~oce
preferir; elles ré–
pondent de leurs ouvrages, & les llanos qu'elles oor
rrop diminués (ont reburés & cizaillés .
Les
taillereffis
ajuflent
les
pieces avec une
~coua
ne , apres avo1r placé le flanc au bilboquet.
//oye:&
BILBOQYU .
On leur a donné le nom de
taÍ//I!reiJé,
<lans le tems
que l'on fabriquoit les erpeces au marceau' paree
i¡u'elles tailloient alors les carreaut ( les monnoies
a¡¡cieones étoient quarrées )
&
les ajufloien',
&c.
AIL·
















