
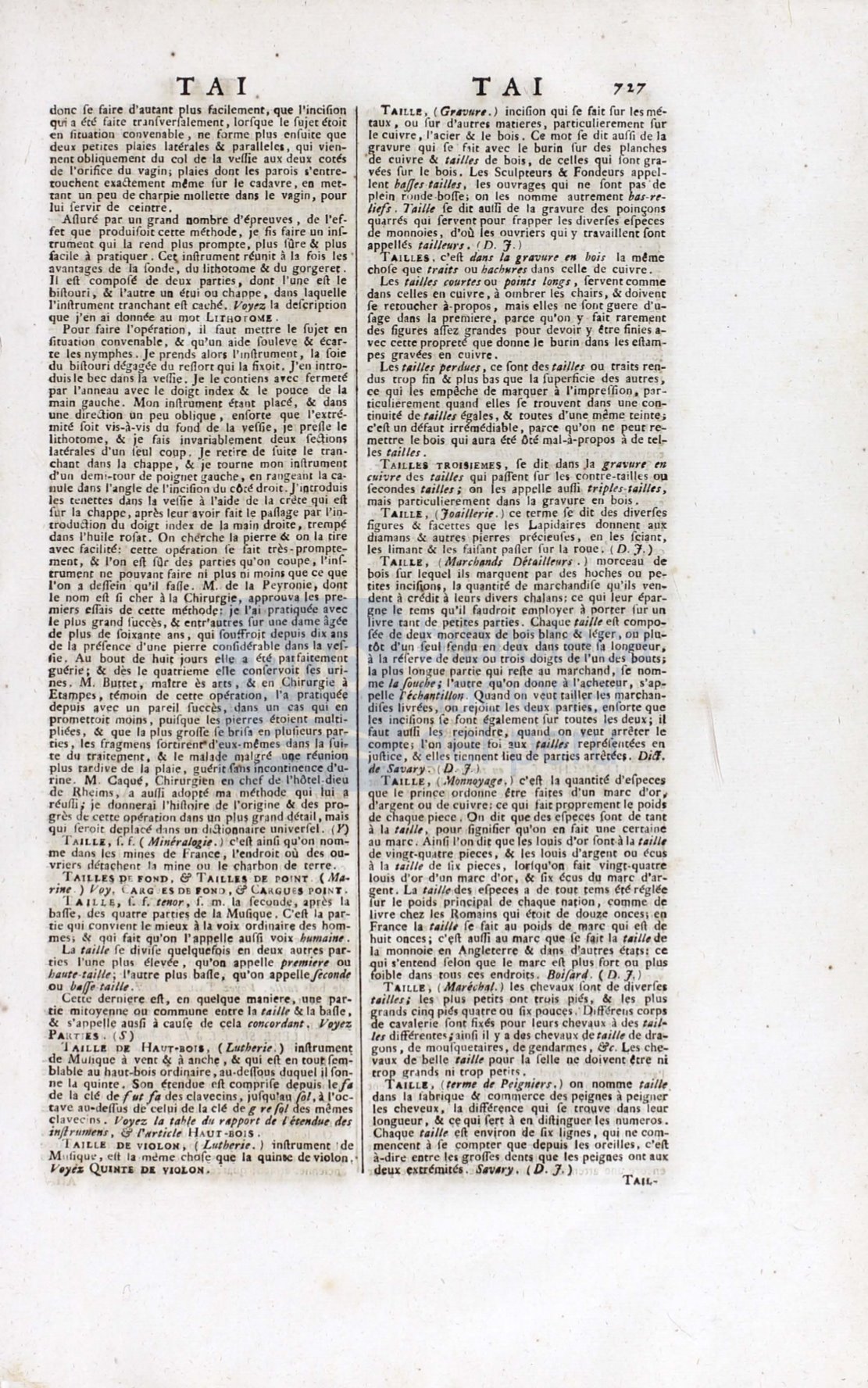
T
A
I
done fe faire d'autant plus facilement, que l'incifion
qm
a t!cé fa ice cnnfverfalemenc, lorfque le fujec écoit
en ficuarion convenable , ne forme plus enfuire que
deux pecices plaies lacérales
&
parallel~s,
qui vien–
nenc obliquemenc du col de la vdfie aux deux cocés
de l'oritice du vagin; plaies donr les parois s'encre–
touchenc exaélemenc mlme fur le cadavre, en mee–
tane un peu de charpie mollecce danJ le VRgin, pour
lui fervir de ceintre.
Afluré par un
~rand
nombre d'épreuves , de l'ef.
fet que produifort cecte méthode,
JC
lis faire un inf–
trumenc qui la rend plus prompte, plus 1\lre
&
plus
íacile
a
pratiquer .
Ce~
inllrument
r~tmit
a
h
fois les ·
avancagcs de la fonde, du lichocome
&
du gorgerec.
JI
eft ·compofé de deux parties, dont l' une e!l le
bi!louri,
&
l'aucre un écui ou chappe, dans laquelle
l'intlrumenc cranchant e!l cal.'ht!.
1/oyez
la defcripcion
que j'en ai donnée au rnoc LrTHOTOMt: .
Pour faire l'opt!racion, il fauc menre le fu jet en
fituacion convenable,
&
qu' un aide fouleve
&
écar–
te les nyrnphes. Je prends alors l'u¡!lrumenc, la foie
du bi!louri dégagée du reOore qui la fixoit. J'en il)tro–
duis le bec dans
la
veffie. Je le conciens a•ec fermeté
par l'anneau avec le doigc index
&
le pouce de la
main gauche. Mon ir¡(j.rumenc éc4nt placé,
&
dans
une direo!lion un peu obligue, enfone que l'exeré–
micé foit vis-il-vis du fuod de la veffie, ¡e prelle le
lichorome,
&
je fais
ínvari~blernent
deux feé\iorn
lacérales d'un lcul coup , Je retire de fuiee le eran·
chane clans la chappe,
&
je courne mon inflrun¡enc
d'un demr.rour de poignee gauche, en rangean1 la ca–
flUie daos l'angle de l'incifion du cOcé droir .)'•ncrodurs
les
t~nettes d~OS
l4 veftie
a
l'aide de la
cr~te_!JUÍ
eft
fqr la chappc,
apr~s l~ur
avoir fa ir le pa!lage par l' in–
troJuélion du doigt index de )a mai¡¡ droire,
rrem~
daos l'huile rofar. On chc!rche la pierre
61
on la tire
avec facilité: cecee opération fe fait rres · promp¡e–
ment,
{>¡
l'on ell fQr des parcies qu'on coupe, l'inf–
trumenr ne pouvanc faire ni plus oi moins que ce que
l'on
a
¡lelfein · qu'il fa
O
e. M . de la ,Peyror¡ie, clom
le oom eft fi cher
a
la Chirurgie,
appróuv~
Jes pre–
miers clfais de cecee m!!chode ; ¡e
l'~i
prariqué!! avec
Je plus graoq
lucc~s.
&
encr'apcres fur une dame agée
de plus de fojxanre ans, qui fouffroj¡ depuis dix ans
de la préfence d'une pierre confidérable ¡jans la ver.
lie . 4u bouc de huir ¡ours elle
ª
écé parfaicem!!nt
guéric;
&
d~s
le quacrieme !!ne col)teryoit
f~s
ori–
nes .
M .
Burr~t,
malrre
es
ans ,
{le
en ,CI)irurgie
~
Er~mp~s,
cémoin de cecre
op~rwon, 1'~
praciqué¡:
depuis avec un pareil
fl!CC~$,
qans un cas qui en
prorneecoir moins, puifque les pierres éroienc mulri–
pliées,
61
que la plus ¡troffe fe brifa en plu!)eurs par,
ríes, les
fragmen~ fowrenl"d'eux-m~mes dan~
la fui.
te dt1 rraieefl)enr,
~
le mal acle
n¡al~ré ut¡~
réunioo
plus rardive de Ja plaie, guérit fa'hs mcontinence d'u–
rine .
M .
Caqu~,
Chirurgien en chef de l'hOeel,dieu
de Rheims, a aufli adopcé ma méthode qui lui
í!
réuffi;
¡e
clonnerai l'hitlnire
d~
)'origine
&
des
pro~
gres
a~
qcc:e opérarion dQns
IIJl
plll$
gr~od
<!écail, mais
qui feroie dep lact! daos un dtaionnaire univerfel.
(Y)
TAJLU,
f.
f.
(
Minéralo¡,i,, )
c'ell ainfi qu'on
nom~
-me dans les mines de
Fr~JJ<!!=,
l'endroit ou des ou–
vriers dé¡a¡;henr la mine o
u
le <?!lªrbon de rerre .
.T
AII-J.!!~
P.E FOND,
{'f
'T'AJLLi~
J?!!
POINT .
(M
a,.
Tille · )
1/py,
ARG
JES DE
fONO,
&
CARGUES POINT .
T
AI LI.~ .
C.
f.
tn~or,
f.
m. la fecunde, apres la
balfe, ejes quarre
pat~ie~
de la Mulique. C'etl la par–
ríe qui convrenc le mieu"
~la
voix ordioaire des hom–
mes;
S¡
qQi fait qu'oq
l'l!Pfltll~ ~ufli
voix
humaine.
La
taille
íe
dj~if~
quelqqe(qis en deux autres par–
ríes l'une plus éleyée , qu'oa appelle
premiue
ou
hauu -tail/e ;
1
1
autre plus baRe, qu'oo appelleflconár
.ou
b•Jfo·fllÍ/1, .
.
Cette
derni~re
eJl,
eo quelque maniere,
,ug~
par–
tie micoyenne
QU
commune entre la
t4Í/Ie
&
la bafle,
&
s'appell<l aosli
a
cauf~
ele c;ela
concordant , 1/oy':r¿
PA!\TTU .
( S)
'J
ArLJ-l! o¡p; HAupaora ,
(
Luthuie . )
inllrument
. de Mulique
ii
venc
~ ~ anéh~,
&
qui e(t en tou f"lll;
blable au
oau~"bois
ordinaire. au-de!fqus
~uquel
il
fQn–
ne Id quinre. Son
~fendue
r.fiC011Jprife
~~puis
le¡{'.
de la cié de
f
ut
fq
d~~
clavecios, ¡ufqu'all
/01,
~!'oc
t ave al!•delfus dé celpi ¡le la cié de
g
re
/9.1
aés
memes
~lavec<ns.
f/oyez la ta/de du r11ppqrt de Ntt:náJJ' áu
znf!.rumens,
&
·r
Nrticle
JiAU<r -BOJ
s .
T AtLtl!
DI!:
VJOLON
1 (
J:,thcrie.)
in!lrument ¡de
M ufi qu.-, efl la ·m.!me
cba(~ qu~
la quinee de violan ,·
1/l)i:T.
QUINU Dlt VIOLON. .
T AILLI!, (
G,iiVfiYI.)
incilion qui fe fait fur les mé–
taux, ou íur d'aurres matieres, particulieremenr fur
le cuivre, l'acier
&
le bois .
Ce
mot íe dit aufti de la
,gravu~e
qui fe .
~1ie
avec le burin fur
de~
planches
de cmvre
&
taJ//es
de bois, de cetles qur fonc gra–
vées fur le bois. Les Sculpteurs
6c
Fondeurs appel–
lent
ba.f!u·lailles,
les ouvrages qui ne font pas ·de
plein ronde .bo(J'e; on les nomme aucrement
bas-re–
litft
.
Tt~ille
fe dit autli de la gravure des
poin~ons
qu4rrés qui fervent pour frapper les diverfes· efpeces
de monnoies, d'oil les ouvriers qui y cravaitlent font
~ppellés
tail/eu/'1.
( D .
J.}
TAl LLES , c'eft
dans la gravure en boif
la
m~me
chofe que
t•·aitr
ou
hadJNrU·
daos ce!le de cuivre.
Les
tpillu CQtsrtu
ou
poit;tr /ongr,
íervent comme
dans celles en cuivre,
ii
ombrer les chairs,
&
doivent
fe reruueher a-propos. mais
elle~
ne font gttere d' u–
fage dans la J>remiere, paree qu'on
y
fait
rarem~nr
des figures alfez grandes pour devoir y
~ere
finies
a–
vec cecee proprecé que doone le burin dans
l~s
ellall'l–
pes gravées en cuivre.
Les
t11illu perdue¡,
ce fooc des
taillu
ou traies rert–
dus rrop fin
&
plus bas que la fuperficie des aueres,
ce qui les
e
mpeche de marquer
a
l'impreffion, p3r–
ficulieremenc quand elles íe rrouvent dans une con–
tinuicé de
t11ille¡
égales,
&
roures d'une meme ceinte;
c'e!lun défaut irrémédiable, pa;ce qu'on nc peor re–
metere le bois qui aura écé Océ mal-.3-propos
a
de tel-
)es
taillu .
·
TAILJ,I!i TROISJ.EMES, fe
di~
d40S
Ja
gratJure
m
~uivre
des
taillu
qui pa{fenc f11r les contre-railles OJ.I
fecondes
t#ÍIIu;
on les
appell~
aufli
lriples-lt~ÍIIer,
mais particuliercment dans la gravl)re
en
bois,
T AILU: , (
]oail.lerir .)
ce eerme fe dit des diverfes
figures
&
facecces qul! les
Lapid~irl!s donnen~
ame
diamans
&
aueres pjerres
pr~creuft:s,
en les
fci~nc,
les limant
&
les faiíanr pafler fu r la roue.
( D.
J.)
T
AILLI!:, (
MdrdJ#n4s D#Aille11rs
. )
morceau de
~oís
fur lequel ils marquenr par des haches ou pe–
tites inciliont, la quancicé de marchandiíe qu'ils ven–
dent
a
crédir
~
leurs divers coalans; ce qui Jeur épar–
gnf;! le cems qu'il faudroit cmployer
a
poner fur un
!ivre ranc de
pe~j tes
parties . Chaque
1ail/e
eft compo–
fée de deux
n¡orc~aux
de l>ois blan¡:
&
lég~r,
o¡¡
plu–
rOt d'ur¡
I~ul f~ndu
en deo' dans eQure
f~
longueur,
~
la réferve de deux ou rrois doigcs
de
l'un dts bouts;
la plus
longu~
par
cíe
qui refte
~u marcpan~,
íc nom–
me
/afoup/J~ ;
l'aucre qu'on donne
i\
l'acheteur, s'ap–
pelle
Nch'll!til/oJ¡ .
Quand on veur cailler les marchan–
!lifes livrées, oo rejoint les deux partie¡, enforce que
les inci[¡ons
(e
fone
é~alement
Cur
~ol)ros
les deux; il
faut au'lfi le,s rejoinare, quand on veue arreter le
compre; l'on ajou ee foi aux
fiiÍI/u
repréfeucées en
ju!lice,
&
elles tieol)ent 1ieu de parcjes arrecéef .
Dié1.
tle S11vary .
1
D .
!J. )
T A.ILLE, (
.}tonnzyage ,
J
c'efl
!~
quancicé d'efpeces
que le
prin~e
orcjonne ter¡: faites d'un marc d'or,
d'argent ou de cuivre : ce qui fai t prppremeot le poide
de cnaque piece .
On
dit que des el'pe.ces font de rant
a
la
t11tlle,
pour fignifier qu'on en fait une cercaine
au marc . Ain[¡ l'on \li' que Je,s lo11is d'or
fonc·~
la
fllill'
de
vingt-qu~tre
pieces,
&
les louis d'argenc
o
u écus
i\
la
tgil/e
de ljx pieces, IOf(qu'on fait vingt-quacre
louis d'or d'un rnarc d'or,
&
fix éaus du mare d'ar–
geot . La
taill~
des
eCpece~
a de [Ol)t tems écé régU!e
fur le poids prirwipal de c;paque nation,
~QQlrne
de
livre chez le&
~om~ins
qui étoit de
<lou~e
onces; en
france la
t11ilü
fe fait au poi¡ls de 1113rc qui etl de
huir onces;
c'~ll
auffi
a
u marc; que fe ·fQit la
t•ill'
de
la mo
0
ooie en .A,ngleterre
&
¡laos d au¡res
~tats:
ce
.qui s'entend fe(on que le marc eft plus fort pu plus
foible dans ¡ous ces endroits .
Boifl¡rt/ .
(
Q. ] ,
J
TAJLL!, (
M11rioh11{.)
les c;hevaux font de cjjver[ec
t11iller;
le~
plus peeics ont ¡r4is p,iés,
&
les plus
grands cinq prés qua¡re ou [¡x pouoes .·01/férerts corps
de cavalerie font fixés pour !eurs
chev~u x
i\
des
tait–
ler
différences;ain(i il y a das chev»llX
rJ~'aillecle
dra–
gons, de
mo11fquetair~s,
de gendarmes,
&c.
l,es che–
vaux de belle
tai/le
pQlÍr
la
íelle pe doivent
~tre
ni
rro()
grand~
ni rrop perirs.
TA.rLLI,
((erm,_ de
Pri$1!it rr,)
on nomme
taillt.
dans la
i~b~ique
éf
COOlQ\erce de$ P41igrtes
a
peiguer
les cheveux, ' la dilféronce qui fe trQ\Ive dans leur
longueur.
&
<;~'qu! r~n
a
en diftinguer
l~s
numeras.
Chaque
tai/1~
cft envjron iJe fix lignes, qui ne com–
mencent
a
fe
c;~ll\pter
que dcpuis les oreilles, c'ell
a-dire eocre !es grolfes
denc~
que les peignes onr auJC
(leuJC
~l(uémités :
511VIII:J
• (
D.
J.
)
















