
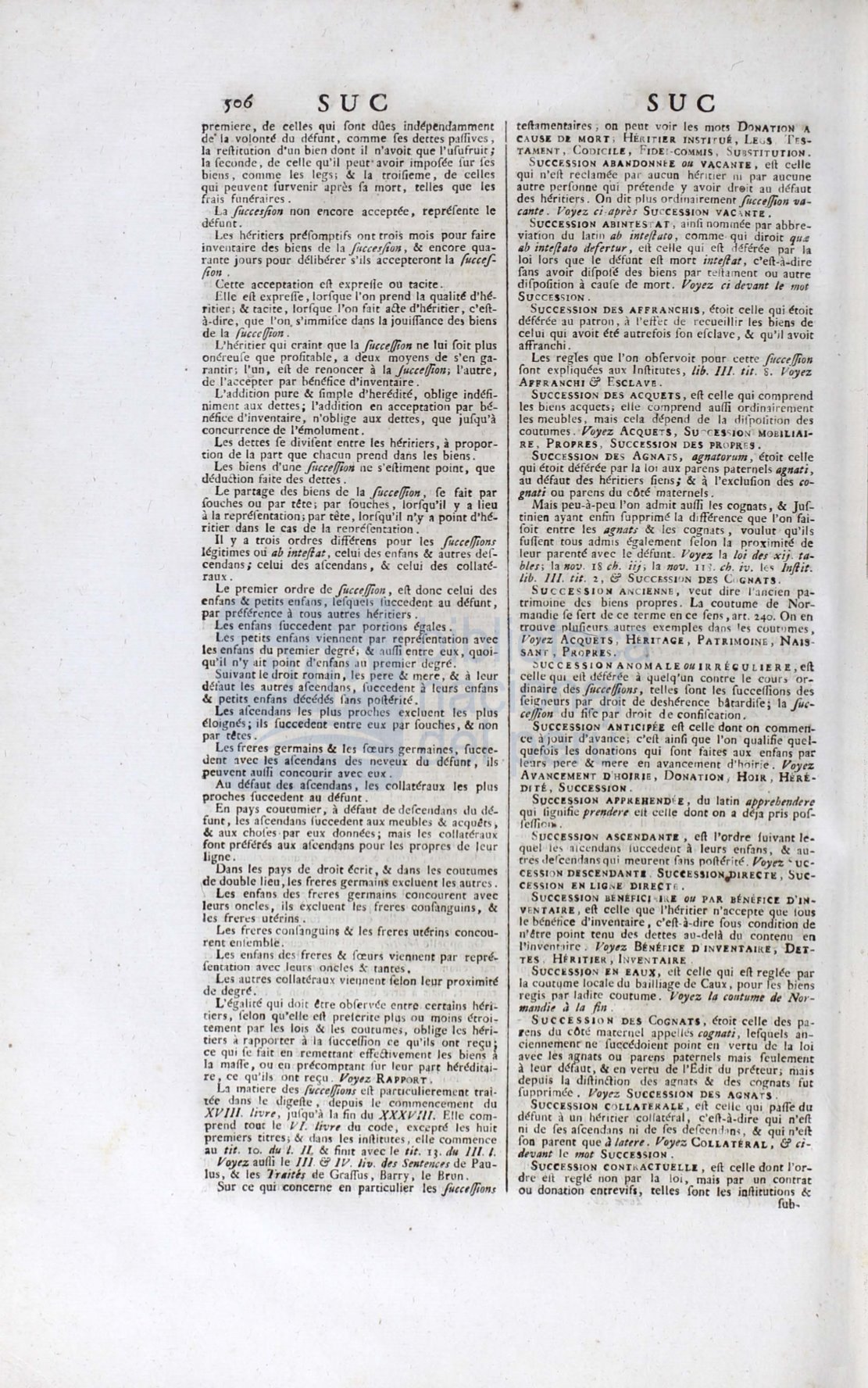
su e
premiere, de
celles
qui fonr dGes indépendamment
de' la volonté du défunr, comme fes deeres paffives,
la rdlicucion d'un bien done il n'avoit que l'ufufruic;
la fecunde, de celle qu'il peu
e·
avoir impofée fur fes
b ieus, ca
m
me les _legs ;
&
la croifieme, de celles
qui peuvenc furvemr aprc!s fa
'!Jore, telles que les
frais funéra1res .
La
jiiCcufion
non encore accepcée, repréfentc
le
défunc .
Les héritiers préfompcifs nnr crois mois pour faire
iovencaire des biens de la
jiiCce~(ton,
&
encore qua–
rance jours pour délibérer s'ils acccpteront la
{uccif–
{toll
.
Cette acceptation efl exprefle otl racite .
Elle en expreffe, lorfque l'on prend la qualitl! d'hé–
ritier;
&
cacice, lorfque l'on fa ir aéle d'héritier, c'efl:-
3-dire, que l'on. s'immifce
da.nsla jouiffance des biens
de la
(uccc(Jion_.
.
.
.
L'héricier qUJ cratnt que In
jiiCce./lion
ne IUJ fo1r plus
onéreufc que proficable, a deux moyens de s'en ga–
rantir ; l'un, en de renoncer
a
la
jucce(Jion;
l'aurre,
de l'accépcer par hénéfice d'inventaire.
L'addicion pure
&
limpie d'herédicé, oblige indéfi–
nimenc aux dettes
¡
l'addicion en accepcaciou par bé–
néfice d'invencaire, n'oblige aux detres, que jufqu'a
concurrence de l'émolumenr.
Les decces fe divifenr entre
les
héririers,
a
propor–
tion de la pare que chacun prend dans les biens .
Les biens d'une
jiiCce(Jion
ne s·enimenc point, que
déduftion faite des decres .
Le partage des biens de la
focce(Jion ,
fe faic par
fouches ou par
r~re ;
par fouches , lorfqu'il y a lieu
a
la repréfencacion; par d!te , lorfqu'il n'.y
a
poinr d'hé–
ricier dans le cas de la reoréfencation .
11
y
a
rrois ordrcs différens pour les
.fucce(Jions
légieimes oú
ab
int~(lat,
celui des en fans
&
a
ueres def–
cendans ; celui des afcendans,
&
celui des collaeé–
raux.
Le premier ordre de
Ji!cct_(fion,
en done celui des
enfans
&
pccies en fans, lefquets luccedenr au défunt,
par préférence
il
cous aucres hériciers .
Les enfans f"uccedene par porcions é"ales.
Les petirs enfans viennenc par reprl!-encacion avec
les enf3ns du premier degré;
&
nuffi encre eux, quoi–
qu' il n'y aie poinc d'enfans
.m
prcmicr degré.
Suivanr le droit romain, les pere
&
mere,
&
a
leur
dét"aut les autres afcendans' fu ccedenc
a
leurs enfans
&
pecics enfans décér:lés fans polléri cé.
Les afcendans les plus proches excluent les plus
éloignés; ils fuccedenr entre e
u~
par fouches,
&
non
par e!res .
Les freres germains
&
les
freurs germaines, fucce–
dcnc avec les afcendans des
nev~ux
du défunc
1
ils ·
peuvent auffi concourirc avec eux .
Au défaur de1 afcendans, les collaréraux
l~s
plus
proches fuccedent a11 défunc.
En pays coucumier,
a
défa>a de defcendans .tu
clé–
funt, les afcendans fuccedenr aux mcul>le.;
&
acquóes,
&
aux cho(es ·par eux données; mais les collaréraux
font préférés aux
aft·en~ans
pour les proprcs de Jeur
ligne .
Daos les pays de droir écric,
&
daos les courumes
de
double lieu, les freres germains excluenr les aurrcs.
Les enfans des frcres germains concourene avec
leurs ancles, ils él(cluenr les freres aonf,Jnguins,
&
les
frer~s
ueérins .
Les frcrcs conf3nguin$
&
les frercs ueérins concou-
renc enlcmble .
•
Les enfans des freres
&
freurs
viennen~
par reprá–
feoe~tion
avec leurs ancles
&
canees.
Le> aucres collaeéraux vieqnent
f~lon
leu.r proximité
de
degré.
L'éga lieé qui doie
~ere obferv~e
cnere cenains
hér~tiers , fclon qu'elle el\ prelcrite ph¡s ou moins
étroi~
rement par les lois
&
l~s
courumc;, oblige les héri–
tiers
ii
rapporcer
i\
la lucceffion ce qu'ils onc
re~
u¡
ce qui fe fair en rcmercant effeélivement les biens
a
la
marre' ou en précompranr fur lcur part
hérédie~i
re, ce
qu'il~
ont
re~u .
17oytz
RAPPORT·. ·
La rnnciere des
[ucc~(Jio1u
etl parcJculieremenr eral–
té('
daos le
d1~ene,
depuis le commencemene elu
XV/JI. livrt ,
¡uf'qu'a la fin du
}(XXVI/l.
Elle com–
prend tour le
V
J.
livu
du code,
exc~pré
les huir
premiers rieres;
&
<lans les inlliruces , elle commence
au
tit.
Io.
du l.
11.
&
fimr avec le
tit.
IJ ·
d11
111.
¡.
17oytz
aufli le
//l.
&
I V. liv.
du
Se11tmcu
de Pau–
lus,
&
les
Tr11ith
de GraiTus, Barry, le Brun.
Sur ce
qui
concerne en parriculier les
focu(Jion$
su e
rellamentai~es ,
on peut voir
les
mors Dn!IATION A
CAUSI:
D~
MOR T; HÉRITIER INSTJTUR' LEt.S TE5-
TAM~NT,
CoDrCILE, FrDEI-COMMIS , Su B>TlTUTION.
SUCCESSION
ABAWDONN~I:
OU
V....
CAIITE, en celle
qui n'efl
reclam~e
par aucun hénner "' par aucune
autre perfonoe qui prérende y avoir dreic au cléfaut
des hériciep. On die plus ordi nairemenr
fi~ect.lfion
va–
cante . Voyez ci-apri:I
SuccESSION
VAC ~NTI! .
SuC:CI:SSION ABINTES f AT , ainfi nomcnée par abbre–
viatíon du larin
ab inte(l11f0,
comme qui diroic
q11.e
/lb
inttflato tfe{ertur.
etl celle qui . en rléférée par la
loi lors que le défunc ell more
mtejlat,
c'ell-a-dire
fans avoir difpoli! des biens par retlJmenr ou aucre
difpo!icion
a
ca ufe de more.
17oyez
á
devant le mor
SuccESSION .
SuCCESS!ON DES AFFRANCHIS , éroie celle qui étoit
déférée au pJtron, ;\ l'elrec de rccueill ir les biens de
celui qui avoic écé autrefois fon efelave,
&
qu'il avoir
affranchi .
Les regles que l'on obfervoic poor cerre
jilcc~(Jion
fonr expliquées aux lnllieures,
lib.
/JI.
tit.
s.
Voytz
APFRANCHI
&
EsCLAVE .
SucCESSION DES ACQUI:TS, efl celle qui comprend
les biens acquets ; elle COmprend auffi Orclinlii"Cmenr
les meubles , mais cela clépend de la dit'poticion des
coucumes .
Voyez
ACQUI!TS'
su ~cES,ION
MGBILIAI–
RE , PaoPRES , SucctSSION DES PROPRF.S.
SuccESSION DE
AGNArs,
agnator11m,
écoit celle
qui étoit déférée par la lo1 aux parcos parernels
agnati ,
au défaut des héririers fiens;
&
~
l'exclufion des
co–
gnati
ou parcns du cOté 'maeernels.
Mais peu-a-peu l'on admic au
ni
les cognats,
&
Juf–
tinien ayanc enfio fupprirné la d11férence que l'on fai–
foic entre les
11gnat>·
&
les cognars , voulm qu'ils
fuffenc cous admiS égalernenr felon la proximité de
leur parenté avcc le défunr.
Voyez
la
loi du xij. ta–
bla;
la
11ov.
rS
ch. iij ;
la
nov.
n
¡.
ch. iv.
lE<
Jnflit.
lib.
JJ
/.
tit.
2 ,
&
S
UCCESSI<JN
DI!
S
CuG
NA
TS .
SuccE s sr o H A CIENNE , veur dire l':tncien pa–
rrimuine des biens propres. La courume de Nor–
mandie fe fert de ce cer me en ce feos, art.
140.
On en
trouve
r>~rs
aucres exem pl es dans les cuur, mes,
V~yez
ACQUETS , HbtTAGE, PATRIMOINE, NAIS–
SAlH ,
P~toPRE~.
:> UC C E S S 1O N A N O M A
LE
OU
1
1\
R
É
G
U L 1
f:
R
1! ,
eft
celle qu1 ell t.léférée
a
quelq'un concre le cour;
or~
di naire des
fi¡culfions,
relles fonc les fucceffions des
feigneurs par droit de deshérence bhardife; la
.fuc–
ce.f!ion
du fifc par droic d e confifcacion.
~UtCESSION
AI!TICIPÉI: efl Celle dont on C'Ommen–
Ce
a
jouir d'avance; c'cn ainfi que l'on qualifie que l–
quefois les donarions qui fonc faires aux enfans par
le:~rs
pere
&
mere en
av.llncement d'hoirie.
17oyez
AvANC!MENT D'HOIR!
E, DoNATJOH ,· HotR , Hll:at-
DITÉ , S u ccESSION .
.
Svcc!SSIOH APPREHEHD
~ 1:,
du latin
appnhepdtre
qui fignifie
pre,dere
ell cell!' donr on
a
M¡a pris pof–
fcffio,~ .
SpCCI!SSION ASCENDANTI, en l'ordre fuivant le–
qu~l
les nt"cendans fuccedeu c i\
leurs enfans,
&
nu–
tres <lel"cendans qui meurenc f.1ns pollériré .
17oyn
' uc–
CESSIONDISC!NDANTI . SUC:USSIONJ>IRECTI! , Suc–
CESSION EN LIG E
DIRE~T G .
SUCCESSION BENÉFICJ •.It l:
OU
PAil
BÉNÉFICE D'llf·
VENTAIRE, ell celle que l'héririer n'accepre que lous
le béoétice d'invenraire, c'ef\-a,dire fous condicion de
n'4cre point renu des derres au-deli\ du concenu en
l'invenr;~ire.
Voytz
BtNÉFJCE p 'INVI!:IITAIRI!,
Du·–
TI!S . HÉRJTIER' INVJ! NTAIRE .
Succ~SSJON
EN EAUll ,
~tl
celle qui efl reglée par
la COUt4me locale du bailliage de Caux ' pour res biens
regis par laclice coutume.
1/oyez la co11tume de Nol"–
marJdie
a
la
.fl11
.
SuccESSJ o N DES CoGNATS, écoir celle des pa–
r ens du cOté macernel appellés
cognati ,
lefquels an–
ciennemenr oe fur;cédoienr poinc en verru de la loi
avec les agnars ou parens paternels
mais
feulement
a
leur déíauc,
&
en
ve•·~u
de I'Edit du préceur; mais
depu is
la diflinftion des
a~nars
&
des cognars fut
fupP rimée.
Voyn
SUCCESSION DES AGt!ATS .
SUCCE&SJON COLLJITERALE , en Celle qui paffe du
défum
i\
un héncier collaréral, c'efl-a-dire qui n'ell:
ni de
fe~ afc~ndo ns
ni ele fes defcend:m> ,
&
qui n'efl:
fon parent que
a
lattre. 17oyez
CoLLATÉRAL'
&
ci–
devant
le
mot
SuccESSJON .
SUCC:ESSION CONTKACTUELU , en celle dont l'or–
dre ell reglé non par la
loi, mais par un contrae
ou donation entrevifl, telles font les ioflitutions
&
fub-
















