
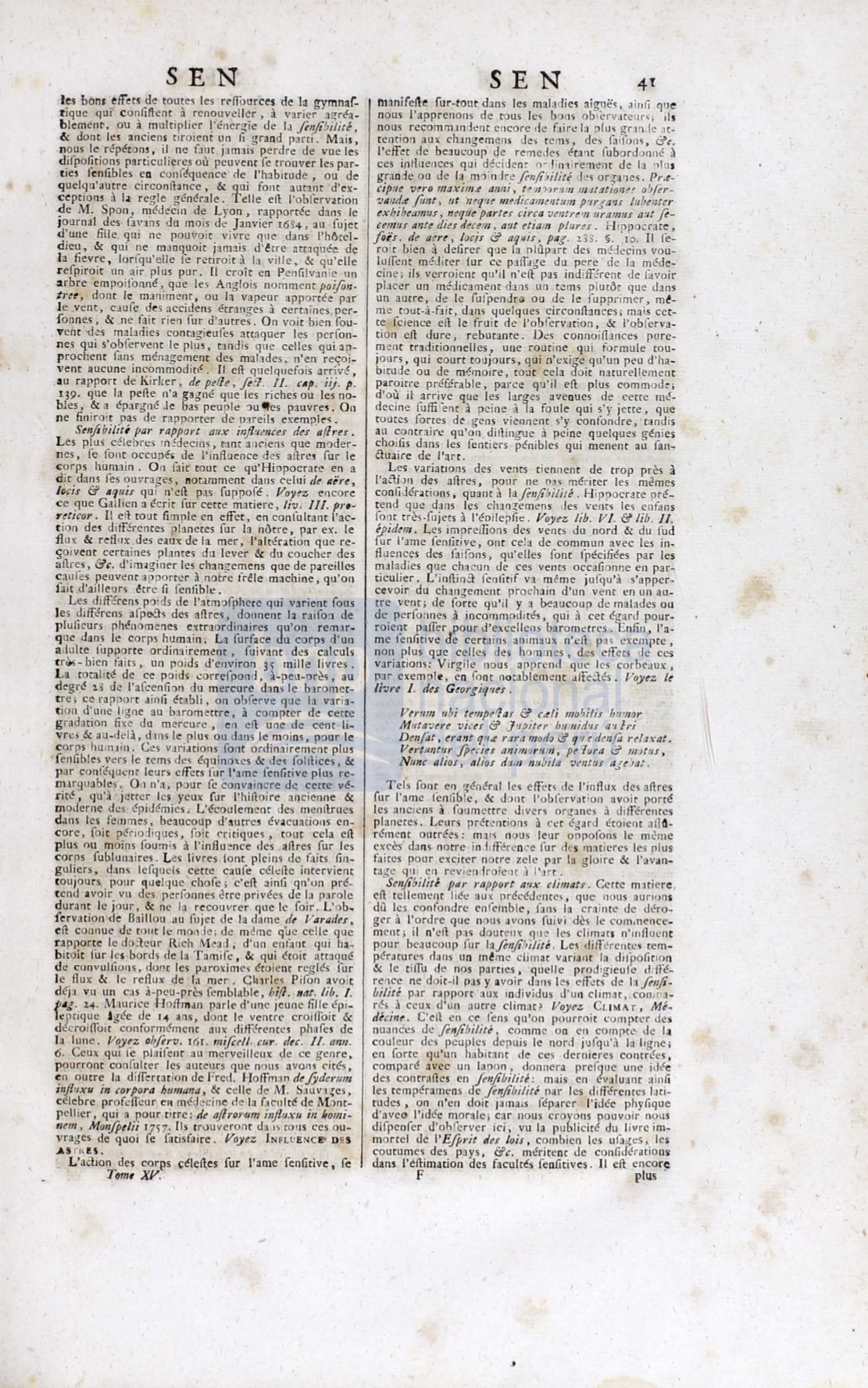
S
E N
les
bbnr effets de roures les
r~flources
de la gymnaf–
t.ique qui conlitlent
it
renouvellcr,
a
varier ag-réa–
blemen~,
ou :\ multiplier \'éncr_gie
d~
la
finjibilité,
&
done les anc1ens t1r01ent un
11 grand parri . Mais,
nous le répérons , il ne
f:~ur
jam is perdre de vue les
d i(politions parriculierc.s ou peuvent fe trouver les par–
t ies (entibies en conféquence ele
l'habirude , ou de
quelqu'autre circonnance,
&
qui
font auranr d'ex–
ceprions :\ la reg le générale . Telle en l'obi"ervarion
~e
M. S
pon, médecin de Lyon, rapportéc dans le
JOurnal des favans du mois d.- Janvier
r6S4 , a
u fu jet
d'une filie qui ne pouvoir vivre que dans
l'h6rel –
d ieu,
&
qui ne manquoit jamais d'erre attaquée.
d~
la fievre. lorlqu'elle ll! rcriroit
a
la vil le ,
&
qu'elle
r efpiroit un air plus pur.
Il
croit en f>elló lvanic un
.ubre empoi!onné , que les Ang lois nomment
poijó11·
~re~,
dont le maniment, ou la vapeur apportée par
le
verlt.
caufe des accidens érranges
a
certaines per–
fonne.~,
&
ne fait rien fur d'autres. On voir bien fou–
. Yent
''C!~s
maladics contagieufes attaquer les pcrfon–
nes qui s'obfcrvent le plus, randis que cell es qui ap–
prochenr fans rnénagement des malades, n'en
re~oi
venr aucune incommodité.
Il
en quelquefois arrivé ,
a
u rapport de Kirlcer ,
de pe!/
e ,
fi,'l.
11.
c~p.
iij.
p.
r
39·
que la pefle n'a gagné que les riches ou les no–
bles,
&
a épaFgné .le bas peuple :>u
~fes
pauvres. On
ne
fin iro;t pas de rapporter de parei ls
exempl ~<.
Sm.fibiliti par rapport aux injlumces des a/lru.
L e
s plusc~lebrt:s
rnédecin ,
e.tnt
a11 C1ens que moder–
n es, fe fonr occupé' de l' mfiuence des aflres fur le
corps humain . O n fait rour ce qu'Hi pocrate en
a
d it dans fes
ouvra~es,
nordmmenr dans celui
tlt 11fr•,
J~pir
&
11t¡11is
qu1 n' en pas [uppofé .
Voytz
encore
ce que Gallien a écrir fur cerre mariere ,
liv ,
1
JI.
pr•~
reticor.
U
ell rout fimple en effet , en cont'ultant l'ac–
t ion des différenrcs
laneres fur la néltre , par ex. le
fl ux
&
refiux des eaux de la mer, l'altération que re–
soivenr cerraines plantes du
lever
&
du coucher des
aflr<:s,
&c.
d'im·¡g iner les
changc~ens
que de pareilles
caufes peuventa oorrer
a
notre
lr~le
machine, qu'on
fait d'ailleurs érre li fenlible.
Les différens poids de l'armofphere qui varient fous
les différens aCpeéts d
es aflres, don nene la r:lifon de
plufieurs phénomenes
extraordinair.esqu'on remar-
, q ue dan5 le corps hu
main. La [urfacedu corps d' un
adulce fupporre ordinairemenr, fuivant des calculs
trtM-
bien faits , un poids d'environ
H
mili
e
livres .
L a
totalicé de ce poids correfpond , a-peu-
r~s,
au
.
deg~é ~8
de l'a[cenfhn du rnercure dans le baromer–
t re ; ce rapporr .tinli érabli, on obferve que la varia–
t ion d' une 11gne
a
u barometrre,
a
compter de cecee
g radation fixe du mercure ,
en
en une de cenr li–
vre.;
&
au-del~,
daos le plu• ou dans le moins, pour le
corps hun11in. Ces variations font ordinairemenr plus
fen!ibles
vers
le rems de• équinoxes
&
des (ol!lices,
&
par conféqucnr leurs effets Cur !'ame fenlirive plus re–
marguables. Üol n'a, pour re convaincre de cette vé–
r ité
1
qu'a jetter les yeux fur l'hinoire ancienne
&
moJerne des épidémies. L'écoulement des menllrues
dans les femmes, be:tucoup d'surres évacuations en–
cere , foi r pénodiques, foir critiques , to ur cela en
plus nu moins foum ;s
a
l'infiuence des aflres fm: les
corps fubluna ires .
Les
llvres !onr pl eins de faits lin–
g uliers, daos lefquel
certe caufe cél<:ne interviene
toujours pour quelque chofe ; c'e!l ainfi qn'on pré–
t end avoir vu des perfonnes erre privées de la parole
duranr le jour,
&
ne la recouvrer que le foir . L'ob.
fervation de Baillou_au fu jet de la dame
dt Varadu,
e!l connue de rour le monde ; de meme que celle que
n pporte le doél:eur Rich M ad , d'un eofant qui ba–
biroir (ur les bords ele la Tamife ,
&
qui étoir atraqué
de
convullions, donr les paroximes étoiem reglés fur
le flux
&
le reflux de la mer . CJ.tarle• Pifon avoit
déja vn un cas a-peu-pres femblable,
hi{J. 1111t. lib.
/ .
f.
llg.
24.
Maurice Hoitrttan parle d'une jeune filie épi–
~ ptique
J5ée de
14
ans, done le vemre croi(Jbit
&
décroifloit conformémenr aux dilférenres phafes de
la lune.
Voyez olljerv. 161. mifie/1. cur. tlec.
/l.
mm.
6.
Ceux qm re plaifenr au ·merveilleux
~e
ce genre,
pourronr confulter les aureurs que nous avons cirés
1
e n ourre la difrertation de Fred. f;Ioffman
dtJYder¡m:
injluxu incorpora
~mnana,
&
celle de
M.
Sauv1•{es ,
célebre profefreur eH fllé\feci ne de la faculté de M.1nt–
pellier, qui a (IOUr rirre
>
dt aftro>wm i11jluxu
Ü1
komi–
tum , Mo11JPelit
I7'i7·
lis trouveronr da" rous ces ou–
vrages de quoi fe fatisfaire .
Voyez
I NFLUENCE"
D ES
.AS
rtd!:S.
L'acl10n des corps
célefi.esfur l'ame fe n!irive, fe
Tomt XV.
S E N
ruanifelle fur-tour daos les maladies
aigue~,
ainr. que
nous l'apprenons de rous les bnns oblervJreur ;
il s
nous recomnundent encore de
fai r~
l:t
;>lu• gr1n
le
ar–
rcntion aux changemans de> tcms, des
faiíon~ ,
&e.
l'effet de bcaocoup de remedes étant lubordonné
a
ces if!tluences qui décidenr
n•
lin1iremenr de la •>l us
grande oo de la
m:>inJre finji:Jilité
•le•
or!$'anes.
Pr.e-·
cipu~
vtro 1/Jttxim.t amzi,
t~
n?or'l111
IJiiltOtJOIJe.!
ob{er–
V/1111~
.fimt,
tJt
1uq11e
11udi~ammtwn
p·ny a•¡;
tubmte~·
exhthtamus ,
neqa~
partts Clrca VeJitrt'/1 uramu.s ll flt
fl–
cemtu antt dies tÜcem . aut ttiam piures.
1-l1ppocrate,
fois .
de out, locis
&
at¡«is , pag .
2SS.
§.
Jo.
ll
te–
roit bien
a
de!irer que la r>lfi part des mé,lecins vou–
lufrent méditer !ur ce pafiage du pere de la méde–
cine; ils verroient qu' il n'en pas indifférent de favoir
placer un méJicamenr daos un tem
plutélt que dans
un aurre,
de
le fu f'pendrG ou de le fup primer,
m~mc tout-a-fair, dans quelques circonnancJ?s; mais cee–
te fcience efl le fru it de l'obfervario n ,
&
l' oble rva–
rion e!l dure, reburante.
O
s connoifl ances purc–
menr rraditionnelles, une rourine qui formule rou–
jours , qui court roujours, qui n'exige qu'un peu d'lta–
blrudc ou de mémoire,
ro~t
cela doit narurellemenr
paroitre
pré~rable,
paree qu'il efl plus
commod~;
d'ou it arrivc que les larges avenues de cerre mé–
dccine fuffi e nt
a
pei ne ¡\ la fo ule qui s'y jette . que
roures forres de gens viennenr s'y confondre, randis
au co ntraire qu'on. dillingue
a
p~ine
quelques génies
clto¡fis dans les fentiers pénibles qui menent au Can,
éiuaire de
l'~rt .
Les
variat~ons
des venrs tiennent de trop pres
a
l'aéli>.Jn das aflres
1
pour ne
nH
mérirer les
m~
mes
conlidér~rions ,
quanr
a
la
fl11jibilité .
Hippocrate pré–
tend que dans
les cltan;remens des vents
le~
enfa ns
fon t tre,.fujers
3
l'éoilepfit: .
Voyez lib. V
J.
&
lib.
JI.
ljlidm1.
Les im prcfTions des
venrs
du nord
&
du fud
lur !'ame fenfirive, onr cela de commun
avec
les in–
fiuenc~s
des fitifons, qu'elles font fpéciliées par les
maladies que cha .un de ces venrs occaíionne en par–
ticulier. L' inflin.:l fentitif va mEme jufqu'a s'appcr–
cevoir
du changemenr prochain d'un venr en un au–
trc venr; de forre qu'il y
a
beaucoup de malades ou
de perfonnes
a
incommodités. qui
a
cer ég-ard pour–
roient pa!fer
1
pour d'excellens barometres . 'Enfin, l'a–
me fenlitive ae cerrains animaux n'efl pas exempte ,
non plus que celles des hommes, des effers de ces
variations: Virgile nous appren<l que les corbeaux ,
par exemple , en font notablemenr affeétés .
Voytz le
livre
l.
des Gtorgiq•tes .
Vtrum
t~bi
tempeflar
&
r~li
mobilis h11mor
Muta:un vices
&
} 'tpiter h11 11id'u a·t lri
Denját,
erant
'l''<Z
rara modo
&
q•t edmfa re/axat.
VtrtUitfllr JPu íu aninJOrllm, pe'lora
a
1JJQttts ,
N unc alias, alios dtJdJ n11bila 'IJCI/ttJs II.:Jt !lat.
Tels fonr en général les effers de !' influx des aflres
fur !'ame !entibie,
&
don t l'obterva rion avoi r porté
les anciens
a
íoumetrre d!vers organes a différenres
planetes. Leurs prétentions
a
Ce[
cga rd étoien t all d–
·rémenr outrées : mars nuus leur oppofons le merne
exces dan• notre inJ¡Ifércnce fur des marieres les pl us
fa ires pour excirer norre zele par la gloire
&
l'avan-
rage qui en revien roie r
a
l'art .
.
Senfibilité pttr rapport
ti!IX
ctimats .
Cerre matiere ,
cfl tellemel]t
lié~
aux précédenres , que nous aurions
dQ les confondre en femble, fans la crainte de déro–
ger
a
l'ordre que nous avons [uivi des le com.nence–
menr ; il n'efl pa• doureux que les cl imots n'mfl ucnr
pour beaucoup fur
lafinjihilité .
Les di fférenres tem–
pérarures dans un
m~me
climat variant la dii"pofinon
&
le rifru de nos parries, quelle prodig ieufe d;lfé–
re ce ne doir-il pas y avoir dans les effers de 13
fin(i–
bilité
par rapport aux iodividus d'un cl imat , conona–
rés
a
ceux d'un aurre climat
1
Voyez
CLJMAT,
Mé–
dhin~.
Cell en ce fens qu'on pourroit compter des
nuances de
finfibilité ,
comme on en compre- de la
coul eur des peuplcs depuis le nord jufqu'a la l•gne ;
en forre qu'un habiranr de
c~:s
dernieres concrees,
comparé avec un lapon , donnera prefque une idee
des conrrafles en
fenfibilit; :
mais en évaluanr ainli
les tempéramens de
finfibilité
par les différenres lati–
tudes , on n'en doit jamais féparer
l'idée phyfique
d'aveo l'idée morale ; car nous croyons pouvoir nous
difpeofer d'obfe rver ici, vu la publicité du livrc im–
morrel de
1'
E.fprit des loir ,
cambien les ufages , les
courumes des pays,
&c.
méri renr de confidératioos
daos l'é!limation des facultés fen!itives .
11
efl. encore
F
plus ·
















