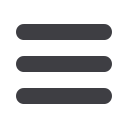
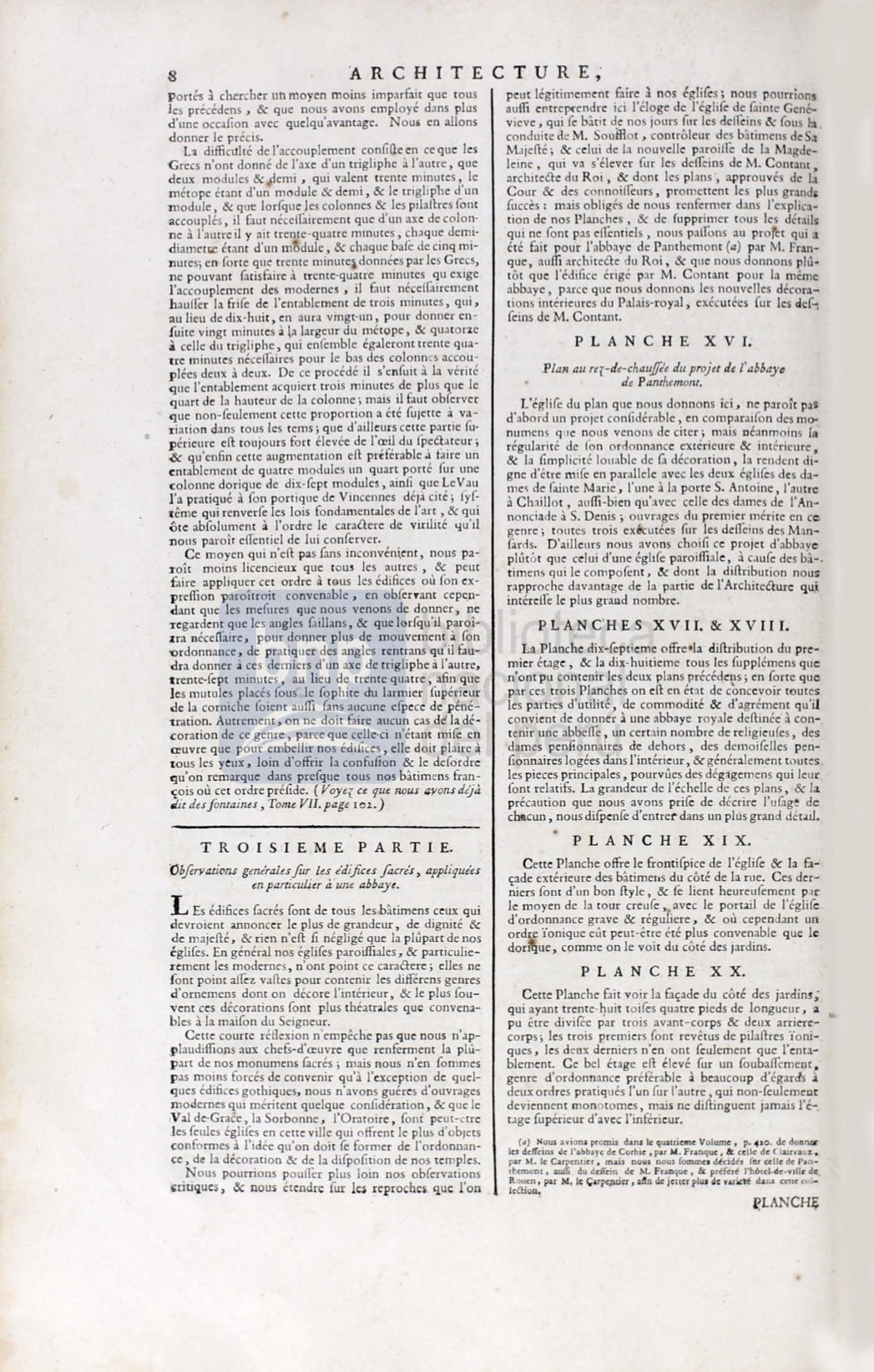
ARCH I TE CT URE ;
Porrh
a
chercher un mayen moins imparfair que
[QUS
les précédens
,
&
que nous avons employé dans plus
d'une occafion avcc quclqu'avantage.
ous en allons
donner le précis.
La
diflicu!té de l'accouplement coníille en ce que les
Grecs n'om donné de l'axe d'un trigliphe
3.
l'amre, que
deux modules
&
¡lemi , qui valent treme minutes, le
métope étant d'un mndule
&
demi,
&
le 1rigliphe d'un
module,
&
que lorfque les colonnes
&
les pilaíl:res ÍOnt
accouplés, il f.rnt néceífairemcm que d'un axe de colon–
nc a l'amreíl
y
air trcme-quatre minuces , cbaque demi–
diameu;e
étaot
d'un mlidule,
&
chaque bafe de cinq mi–
n urc:s; en fortc que treme minure.¡données par les Grecs,
ne pouvanc farisfairc:
a
creme-qualre minutes
C}ll
exige
J'accouplemenr des modernes ,
il
faut
néceffairemenc
h auffer la frife de l'emablerncnt de trois minmes, qui,
au lieu de dix·huit,
en
aura vingc·un, pour donner en–
fuite vingr minutes
a
la largeur du mécope ,
&
quato11e
a
celle du trigliphe' qui enfemble égalerom !rente qua–
trc minutes néceífaires pour le bas des
colonn~s
accou–
plées dcux 3 deux. De ce procédé il s·c,,fuit
a
la vérité
q ue l'entablement acquierc trois minutes de plus que le
q uart de la hauteur de la colonne; mais il faut obferver
que non-feulement cene propon ion a été fu¡ette
a
va–
riation dans taus les rcms; que d'ailleurs ceue partie fu–
Jlérieure eíl: toujours fort élevée de l'reü du fpeél:ateur;
&
qu'enfin cene augmenmion eíl: préférablc
a
fa ire uñ
cmablement de quatre modules un quarc porté fur une
colonne dorique de dix-fe pt modules, ainfi que LeVau
J'a pratiqué
3.
fon portique de Vincennes déj;\ cité;
íff–
t cme qu·i renveríe les lois fondamentales de l'arr,
&
qui
o te abfolument • l'ordre le caraél:ere de virilité <;u'il
no11s parcire!femicl de lui confe rvcr.
Ce moyen qui n'eíl: pas fans inconvéntent, nous pa–
roic moins licencieux que rous les amres
,
&
peut
faire appliquer cct ordre
a
wus
les édifices ou fon ex–
preffion 'Paroitroü convcnable , en obferYanc
cep~o
dant que les mefurcs que nous venons de donner , ne
n gardent que les angles faillans,
&
que lorfqu'ü parol-
.u a néce'13.ire, pour donner plus de mouvernem
a
fon
"Ordonnance , de praciquer des angles rciurans qu'il fau-
·
dra donner
a
ces derniers d'un axe de rrigliphe
a
l'amre,
t rente-fept minutes , au licu de trente·quatre, afin que
les mutules placés fous le fqphite
du
larmier fupérieur ·
de
la
corniche foienr auffi fans aucune efpece de péné–
·u ation. Amremenr, on ne doit faire aucun cas dé la dé·
c orarion de ce genre , parce que cclle·ci n'étant mifc en
ec:uvre que pour ernbellir nos édifices , elle doit plaire
~
t ous
les
yeux , loin d'offrir la confufion
&
le deíordre
qu'on remarque dans prefque taus nGs b3.timens fran–
<¡ois ou cet ordre préíide.
(Voy<{
a
9ue
MUS
4yons dija
liit
desfamaines, Tome VJI. page
101.)
TRO I S I EME PARTIE.
"(Jbfarvatims genúales
jiir
les e'dijices facre's, applique'es
en particulier
a
une ahhaye.
L
Es édifices facrés font de tous les b3.timens ccux qui
dcvroicnr annoncer
le
plus de grandeur, de digniré
&
de majeíl:é ,
&
rien n'cíl: íi négligé que la plilpart de nos
églifcs.
En
général nos églifes paroüliaks,
&
particulie–
rcment les rnodernes , n'onc point ce caraékre ; elles ne
{ont poim aÍÍe"Z. valles pour comenir les différens genres
d'ornemens dom on décore l'intérieur,
&
Je plus fou–
venr ces décoracions fonr plus théarrales que convcna–
bles
a
la maifon du Seigncur.
Cene courte réffexion n'cmpCchc pas que nous n'ap–
plaudillions aux che&-d'reuvre que renfermeat la plíl–
part de nos monumens íacrés; mais nous n'en fommes
pas rnoins forcés de convenir qu·a l'exception de quel–
gues édifice.s gmhiques, nous n'avons guéres d'ouvragcs
modcrnes qui mérirem quelque confidérarion,
&
que le
Val
de-Graée, la Sorbonne ,
l'Oracoire, fonc pcuc-crre
les
Íeules óglifes en cene ville qui offrent le plus d'ob1ets
conformes
a
l'idée qu'on doit fe former de l'ordonnan–
ce, de Ja décoratioo
&
de la difpofirion de nos temples.
ous pourrions pouífer plus loin nos obfervarions
~ritiques,
&
nous étendre fur
le¡
repro
hes
que
l'
on
pcut légitimcmenc fuíre
a
nos églifcs; nous pourrions
aulli ertrep<"endre ici l'éloge de l'églife de faime Gené–
vicve, qui fe b3rn de nos jours Ítlr les deílcins
&
fous
la
conduite de M. SoulHot , comroleur des Mtimens de Sa
Majeíl:é;
&
cclui de la nou"elle paroiífe de la Magde–
lcine, qui va s'élever íur les ddfeins de M. Comlm
>
architeél:e du Roi ,
&
dont les plans , :ipprouvés de la
Cour
&
des connoiífeurs , promettent les plus
grand~
focces : mais obligrs de nous renfermer dans l'cxplica–
tion de nos Planches ,
&
de íupprimer tous les détails
qui ne font pas eífcnticls , nous paífons au proj\:t qui a
été fui t pour l'abbaye de Panthemont
(a)
par M. Fran–
quc , auffi archited:e du Roí ,
&
que nous donnons phj ...
tOt que l'édifice érigé par M. Contant pour
la
rn&ne
abbaye, parce que nous donnons les nouvcllcs décor:l–
tions intérieures du Palais-royal , exécurées Íur les dcf-,
feins de M. Contant.
P L A N C H E X V I.
Pla1< att re¡-de-chauffee dtt projtt de l'abbaye
de
P
amhemom.
L'égli(e du plan que nous donnons ici, ne paro1t pas
d'abord un projet confidérable, en comparaifon des mo–
numens que nous venons dc citcr; mais néanmoins
fa
régularicé de fon ordonnance extérieure
&
iméricurc
&
la limplicicé louable de
fa
décoracion, la rendcm
di~
gne d'etre mife en parallele avec les deu>: églifes dos da–
mes de íainte Marie , !'une
:l
la porte S. Antaine, J'autre
a
Chaillot , aulli-bien qu'avec celle des dames de )'An–
nonciade
a
S. Dcnis; ouvrages du premier méricc en ce
genre; comes erais exécutées Íttr les deífcins des Man–
fards. D'ailleurs nous ª"ons choifi ce projet d'abbaye
plutot que celui d'une éghfe paroilliale ,
a
c.iufe des
bl-.
timem qui le compofent,
&
done la diíl:ribution nous
rapproche da\'antage de la partie de l'Architeél:ure
qu~
imércífe le plus graud nombre.
P L A N C'H E S X V II.
&
X V l l I•
La Planche dix-feptieme offre•la diíl:ribution du pre–
micr étage ,
&
la dix-huitieme [Qus les fupplémens que
n'ontpu contenir les dcux plans précédcns; en force quo
p:u ces trois Planches on eíl: en état de cbnccvoir couces
lcs parttes d'utilité-, de commodi
té & d'agrémenr qu'il
conviene de donner
a
une abbaye
roya.ledeíl:inée"
a
con–
tenir une abbeffe , un cert"in no
mbre dereligieu(es , des
dames penfionnaires de dehors , des demoi(ellcs pen–
fionnaires logées dans l'imérieur,
&
généralemem touces
les pieces principales, pourvUes des dég1gemens qui Jeuc
fom relati&.
La
grandeur de l'échelle de ces plans ,
&
la
précaution que nous avons priíc de décrire l'ufage de
chacun , nous difpenfe d'entrer dans un plus grand déwl.
P L A N C H E X I X.
Cette Planche offre le frontifpice de l'églife
&
la
&–
<¿ade c:xtérieurc des b3.rime11s du c(Hé de la rue. Ces der–
niers font d'un bon íl:yle ,
&
(e
lient heureufemcm p1r
le moyen de la tour creuíe 'favcc le portail de l'églife
d'ordonnance grave
&
régu icre ,
&
oU cependanr un
ordre 'ionique elir pem-Ccre
été
plus convenable que le
dori'fiue , comme on le voit du c(Hé des jardins.
PLANCHE X X.
Cette Planche fui t voir la
fa~ade
du coté des jardins;
qui ayant rrence·>Juit toifes quarrc picds de longueur, a
pu Crre diviíée par trois avam-corps
&
dcux arriere–
corps; les trois premiers fonc revCtus de pilaíl:res 'ioni–
ques , les deux derníers n'eo onr fculement que l'ema–
blcment. Ce bel étage eíl: élevé fur un foubaífement ,
genre d'ordonnance préférable
a
beaucoup d'égards
l
deux ordres pratiqués l'un fur l'autre, qui non-feulemeot
dcvicnoem monotomcs, mais ne diftinguem jamais l'é–
rage fupérieur d'avec l"inférieur.
(11)
Nous :nion• ptomis
da.ns~
qwtricmc Volwnc , p.
110.
dt
don
le.s ddfdru de: l'abbayc de
Corbíc:, par W. Fr'anquc
~
&.
cc:Uc: de < lauvaux...
~:~!~:e:, ~n~~c~;~~i~d:~,~: F~~~C::'"&ªp~~~7r~ª~1~~~-~~1f;~;
Rouc:n ,
pu
N , le Carpc-J\titt, a.ftn
de
jcucr phu
de yilric'll! d.aru cc:uc cut...
l«lion~
1,?LANCH~
















