
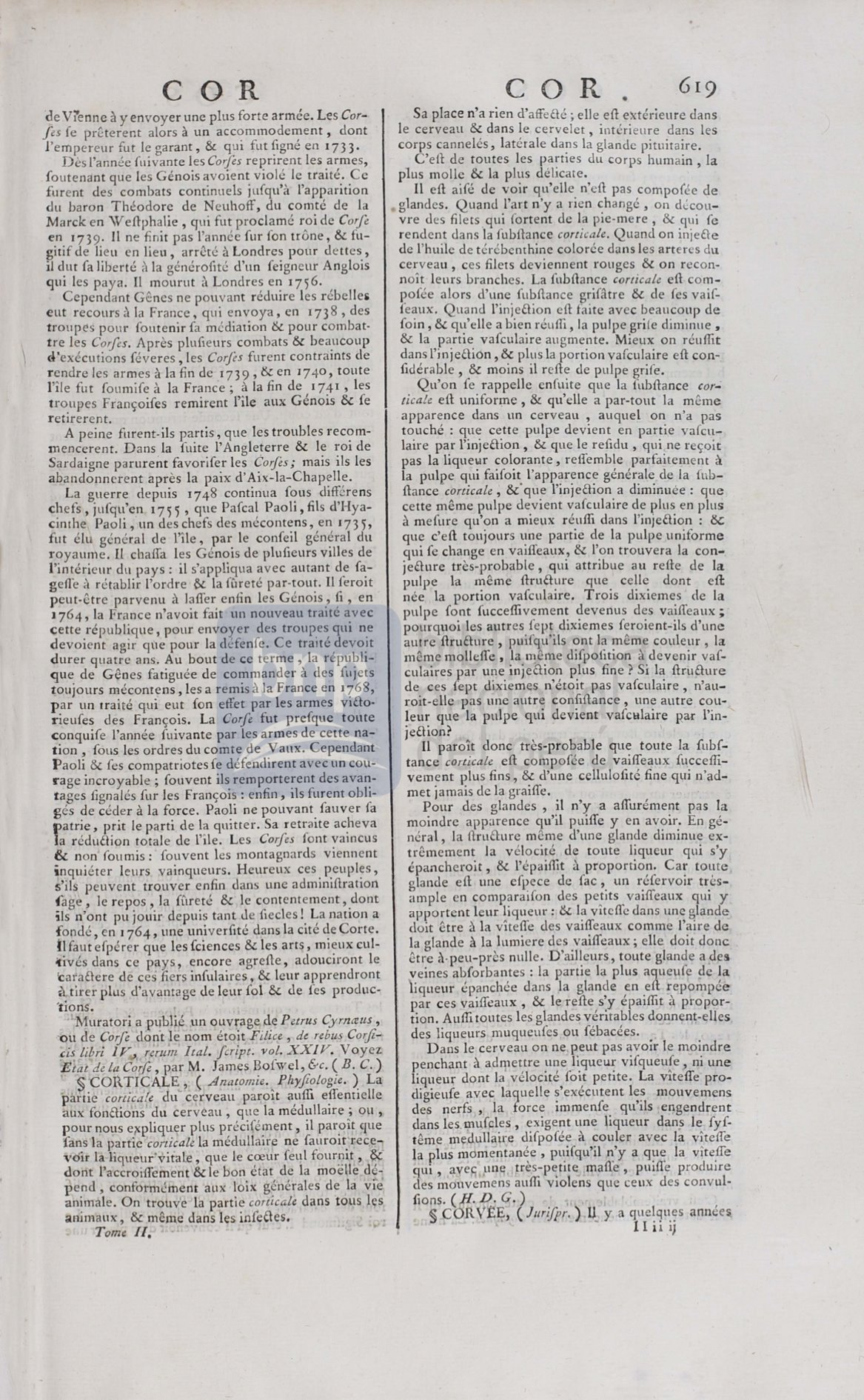
COR
de Vi'enne
ay
envoyer une plus forte armée. Les
Cor–
fes
fe preterent alors
a
un accommodement' dont
l'empereur fut le garant,
&
qui fut figné en r
73 3.
Des l'année fuivante les
Corfes
reprirent les armes,
foutenant que les Génois avoient violé le traité. Ce
furent des combats continuels jufqu'a l'apparition
du baron Théodore de Neuhoff, du comté de la
Marck en Weftphalie, qui fut proclamé roí de
Cor.feen
1739.
11
ne finit pas l'année fur fon treme,
&
fu–
gitif de lieu en lieu, arreté
a
Londres pour dettes,
il
dut fa liberté a la générofité d'un feignenr Anglois
qui les paya.
Il
mourut
a
Londres en
1756.
Cependant Genes ne pouvant réduire les rébellei
eut recours
a
la
France, qui envoya, en
1738,
des
troup~s
pour fontenir fa médiation
&
pour combat–
tre
les Corfes.
Apres pluíieurs combats
&
beaucoup
cPexécutions féveres, les
Corfes
fnrent contraints de
rendre les armes
a
la fin de
1739'
&
en
1740,
toute
l'ile fut foumife
a
la France;
a
la fin de
1741,
les
troupes FrarH,;:oifes remirent Pile aux Génois
&
fe
retirerent.
A
peine fnrent-ils partís, que les troubles recom–
mencerent. Dans)a fuite
1'
Angle~erre
& le roi de
Sardaigne parurent favorifer les
Codes;
mais ils les
abandonne.rent apres la paix d' Aix-la-Chapelle.
La guerre depuis
1748
continua fous différens
chefs, jufqu'e_n
17
55 ,
qne Pafcal Paoli, fils d'Hya–
cinthe Paoli, un des chefs des mécontens, en
173
5,
fut él
général de l'ile, par le confeil général du
royaun'le.
Il
chaífa les Génois de plufieurs villes de
l'intérieur du pays: il s'appliqua avec autant de fa–
gefle
a
rétablir l'ordre
&
la fureté par-tout.
11
feroit
peut-etre parvenu
a
Jaífer enfin les Génois, fi, en
1764,
la France n'avoit faít un nouveau traité ave e
cette républiqne, p0ur envoyer des troupes qui ne
devoient agir qúe pour la défenfe. Ce traité devoit
durer quatre ans. Au bout de ce terme, la républi–
que de Genes fatiguée de commander a des fujets
toujours mécontens, les a remisa la France en
1768,
par un traité qui eut fon effet par les armes viél:o–
rieufes des Fran<;ois. La
Corfe
fut prefque toute
conquife l'année fuivante par les armes de cette na–
tion , fous les ordres du comte de Vaux. Cependant
Paoli
&
fes compatriotes fe défendirent avec un
C0\1-
!l'age incroyable; fouvent ils rernporterent des avan–
tages fignalés fur les Fran<;ois : enfin, ils furent obli–
gés de céder
a
la force. Paoli ne pouvant fauver fa
patrie, prit le pélftÍ de la quitter.
S
a retraite acheva
la réduétion totale de l'ile. Les
Coifes
font vaincus
&
non (oumis: fouvent les montagnards viennent
inquiéter leurs vainqueurs. Heureux ces peuples,
s'ils peúvent trouver enfin dans une adminifiration
fage, le re pos, la fftreté
&
le contentement, dont
ils n'ont pu jouir depuis tant Je fi.ecles! La nation
a
fondé, en
1764,
une univerfité dans la cité de Corte.
11
faut efpérer que les fciences & les arrs, miéux cul–
'tivés dans ce pays, encore agrefre, adouciront le
l:araétere .de ces :fiers infulaires, & leur apprendront
a
tirer plus d'avantage de leur fol
&
de fes produc–
'tions.
....Muratori a publjé un ouvrage de
Petrus Cymceus,
·-ou de
Corfe
don't le nom
é.toi~
F ilice
,
de rehus Corji–
~is
lihri 1P
'·
rerum
!tal. fcript:
vol.
XXJV.
Voyez
Etat
de la
Corfe,
par
M.
James Bofwel,
&c. (B. C.)
§
CORTICALE, (
Anat
omie. Phyfiologie.
)
La
panie
cotticale
du" cerveau
par:oi.tauffi eífenrieUe
aux fonétions du cerveau , que la médullaire ; ou ,
pour nous e!'pliquer plus précif ment,
il
paroit que
fans la partie
conicale
la médullaire ne fauroit rec,e,
vóir
la liqueur'vitale, que le creur feul fournit,
~
dont l'accroiífement &le bon état de la moeUe dé–
pend
~
confotmément aux loix ge"nérales de la v1e
animale. On trouv'e la partie
cortícale
dans tous
l~s
animaux' &
mem.e
dans les infeCtes.
Tome
JI.
COR
•
S
a place n'a rien d'affeél:é; elle efi extérieure dans
le cerveau
&
dans le cervelet, intéri eure dans les
corp: cannelés, laté rale
da~ s
la gLande pituitaire.
e
eft de toutes les partles du corps humain
la
plus molle & la plus délicate.
'
11
eft aifé de voir qu'elle n'efr pas compo(ée de
glandes. Quand l'art n'y
a
rien changé, on d !cou–
vre des filets qui fortent de la pie-mere,
&
qui
(e
rendent dans la fubftance
corticale.
Quand on injeét:e
de l'hnile de térébenrhine colorée dans les arteres du
ce~veau
,
ces
filets deviennent rouges & o
n recon–noit leurs branches. La fubftance
corticale
efi.com–pofée alors d'une fubfiance griHhre
&
de fes vaif–
feaux. Quand l'injeétion eft faite avec beaucoup de
foin, &
qt~'elle
a bie!1 réuíli, la pul pe grife diminue,
&
la part1e vafculatre augmente. Mieux on réuffit
dans l'injeél:ión,
&
plus la portien vaículaire efr con–
fi.déra?le, & moins il
refi~
de pnlpe grife.
Qn on fe rappelle enfutte que la fubftance
cor~
ticale
efr uniforme'
&
qu'elle a par-tout la meme
apparence dans un cerveau , auquel on n'a pas
touché : que cette pulpe devienr en partie vafcu–
laire par l'injeél:ion ,
&
que le reíidu , qui ne re<;oÍt
pas la liquewr colorante' retiemble parfaitement
a
la pulpe qui faifoit l'apparence générale de la
ú b–
france
corticale;
&'que l'injeétion a diminuée: que
cette meme pulpe devient vafculaire de plus en plus
a mefure qu'on a mieux réuffi dans l'injeétion :
&
que c'eíl toujours une partie de la pulpe uniforme
qui fe change en vaiífeaux,
&
l'on trouvera la con-.
je<ll:ure tres-probable, qui attribue
a
u refie de
la
pulpe
la
meme frruél:ure que celle dont
eft
née la portien vafculaire. Trois dixiemes de la
pulpe font fucceffivement devenus des vaiífeaux;
pourquoi les autres fept dixiemes feroient-ils d'une
aurre ftruél:ure, puifqu'ils ont la meme couleur, la
meme molleífe , la
~eme
difpofition
a·
devenir vaf–
culaires par une injeél:ion plus fine
?
Si la frruél:ure
de ces fept dixiemes n'étoit pas vafculaire, n'au–
roit-elle pas une autre confiíl:ance , une autre cou–
leur que la pulpe qui devient vafcHlaire
Rar
l'in-
jeétion?
1
11
paroit done tres-probable que toute
la
fubf–
tance
corticale
efr compofée de vaiífeaux fucceili–
vernent plus fins,
&
d'une cellulofité fine qui n'ad–
met jamais de la graiífe.
Pour des glandes , il n'y a aífurément pas
la
moindre apparence qu'il puiífe
y
en avoir. En gé–
néral' la firuél:.ure meme d'une glande diminue ex–
tremement la vélocité de toute liqueur qui s'y
épancheroit, & l'épaiffit
a
proportion. Car tou te
glande eíl une efpece de fac, un réfervoir tres–
ample en comparaifon des petits vaiífeaux qui
y
apportent leur liqueur:
&
la viteífe dans une glande
doit etre
a
la viteífe des vaiífeaux comme l'aire de
la glande a la lumiere des vaiífeaux; elle doit done
etre a-peu-pres nulle. D'ailleurs, toute glande a des
veines abforbantes : la partie la plus aqueufe de
la
iqueur épanchée dans la glande en eft tepompée
par ces vaiífeaux, & lerefte s'y épaiffit a propor–
tion. Auffi toutes les glandes véritables
donnen~-e1les
des liqueurs muqueufes ou fébacées.
Dans le cerveau on ne peut pas avoir le moindre
penchant
a
admettre une liqueur vifqueufe' ni une
liqueu:r dont la' vélocité foit petite. La viteífe pro–
digieufe avec laquelle s'exécutent les mouvemens
des nerfs ,
la force immenfe qu'ils engendrent
dans les.mufFles, exigent une liqueur dans le fyf–
teme
m~,dullaire
difpofée
a
couler avec
la
viteífe
la plus momentanée , puifqu'il n'y a que la viteífe
gui , avec une tres-petire ,maíle , puiífe produjre
des
mduv~mens
auffi violens que ceux des conv ul–
úons.
(!l.
D.G.)
§
COR
Vf:~,
(
Jurifpr.)
U
y
a quelqnes année$.
~
11
i i
_ij
(
















