
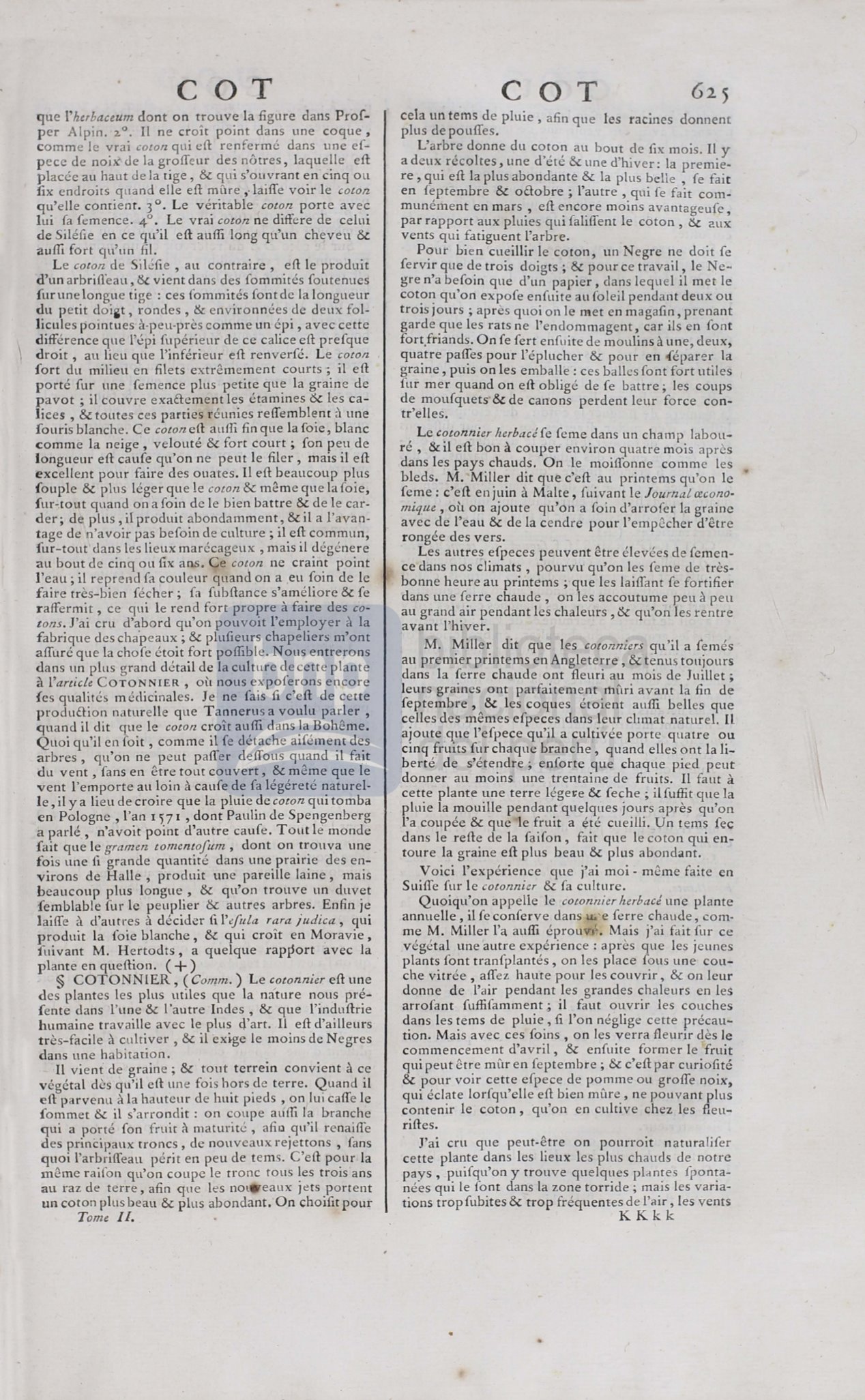
COT
ue l
herhaceum
dont on trouve la figure dans Prof–
per A lpin.
2°.
Il ne cro1t point dans une coque,
comme le vrai
coton
qui efi renfermé dans une ef–
pece de noix de la
g~oífeur de~
r:orres,
laque~
le efr
placée au haut de la uge,
&
qlll s ouvran t en c
mq oufix endroirs quand elle efr mure ,.laiífe voir le
cot.on.qu'elle comient. 3
°.
Le vé_ritable
cot.~n
porte a
ve~
lui fa femenee. 4°. Le vra1
coton
ne d1ffere de cehu
de Siléfie en ce qu'il e!l: auffi long qu'un cheveu
&
auffi fort qu'un
fil.
Le
coton
de Siléfte , au contraire , efi le produit
d,un arbriíreau,
&
vient dans des fommités foutenues
furunelongu e rige :ces fommités fontde la longueu r
du p etit
doi~t,
rondes, & environnées de deux fol –
licules pointues a-peu-pres comme un épi,
avec
cette
différence que l'épi fupérieur de ce calice efr prefque
droit , au lieu que l'inférieur efr renverfé. Le
coton.
fort du milieu en filets extremement courts ; il eft
porté fur nne femence plus petite que la graine de
pavot ; il couvre exaB:ement les étamines
&
les ca–
lices '
&
toutes ces partíes réunies
reífembl~nt
a
une
fouris blanche . Ce
cot.oneft
auffi fin que la fo1e, blanc
comme la neige , velouté
&
fort court ; fon peu de
longueur efr caufe qu'on ne peut le filer, maís il efr
excellent pour faire des ouates. Il efr beaucoup plus
fouple
&
plus léger que le
coton
&
meme que la foie,
fur-.rout quand on a foin de le bien battre
&
de le car–
der; de plus,
if
produit abondamment,
&
il a l'avan–
tage de n'avoir pas befoin de culture; il efr commun,
fur-tout' dans les lieux marécageux , mais il dégénere
au bout de cinq o u ftx ans. Ce
cot.pnne craint point
l'eau; il reprend fa couleur quand on a eu foin de le
faire tres-bien fécher ; fa fubfiance s'améliore
&
fe
raffermit ' ce qui le rend fort propre a faire des
co–
tons.
J'ai cru d'abord qu'on pouvoit l'employer a la
fabriqu e des chapeaux;
&
plufieurs chapeliers m'ont
aífuré que la chofe étoit fort poffible. Nous entrerons
dans un plus g rand détail de la culture decette plante
a
l'art.icle
CoTONNlER' oü nous expoferons et¡lcore
{es qualités m édicinales.
J
e ne fais ft c'efi de cette
produB:ion naturelle que Tannerus a voulu parler ,
quand il dit que le
coton.
croit auffi dans la Boheme.
Quoi qu'il en foit, comme il fe détache aifémer:t
d~s
arbres, qn'on ne peut paífe r deífous quand 11 fa1t
du vent, fans en etre tout cou
vert,
&
meme que le
vent l'emporte an loina caufe de fa l
égéreté naturel–
le, il ya lieu de croire que la pluie _de
cot.onqui tomba
en Pologne , l'an 1571 , dont Pauhn de Spengenberg
a parlé, n'avoit point d'autre caufe. Tout le monde
fait que le
gramen
tomcn~oJ,um,
dont on
.t~onva
une
fois une fi grande
quann~e
dans une.
pra1r~e
des
e~virons de Halle , prodmt une pare1lle lame, ma1s
beaucoup plus longue,
&
qu'on trouve un duvet
femblable fur le peuplier
&
autres arbres. Enfin je
laiífe a d'autres
a
décider
fi
l' efula rara judica'
qui
produit la foie blanche,
&
qui croit en Moravie,
fuivant M. Hertodts, a quelque rapport avec la
plante en queftion.
e+)
§
COTONNIER, (
Comm.)
Le
cotonnier
efr une
d es plantes les plus utiles que la náture nous pré–
fente dans l'une
&
1'autre Indes ,
&
que l'indufrrie
humaine trav aille avec le plus Q.'art. Il efr d'ailleurs
tr ' s-facile
a
cultiver ,
&
il exige le moins de Negres
dans une habitation.
n
vient· de graine;
&
tout terrein convient a ce
végétal d ' s qu'il eft une fois hors de terre. Quand il
eft parvenu
a
la hauteur de huit pieds , on lui caífe le
fommet
&
il s'arrondit : on coupe auffi la branche
qui a porté fon fruit
a
maturité ' afio _q u'il renaiífe
des principaux troncs, de nouveaux reJe ttons , fans
quoi l'arbriifeau périt en peu de tem . C'eft pour la
meme raifon qu'on coupe le tronc tous !es trois ans
au raz de terre, afin q-ne les not eaux Jets porrent
un coton plus beau
&
plus abondant. On choiiit pour
Tome 11.
COT
cela un tems de pluie , afinque les racines donnen t
plus de pouífes.
L'arbre donne du coton au bout de íix mois. Il
y
a dcux_ récoltes, une d'été & une d'hiver: la premie–
re, qm efr la plus abondante
&
la plus belle , fe fait
en feptembre
&
oétobre ; l'autre , qui fe fait com–
munément en mars , eft encore moins avantageufe
par rapport aux pluies qui faliífent le coton,
&
au~
vents qui fatiguent l'arbre.
P?ur bien cueillir le coton, un Negre ne do1t fe
ferv1r que de trois doigts ;
&
pour ce travail, le Ne-–
gre n'a befoin que d'un papier, dans lequel il met le
cot?~
qu'on expofe enfuite au fo leil pendant deux ou
tro1s Jours ; apres quoi on le meten magaft n, prenant
garde .que les rats ne l'endommagent, car ils en font
fort.fnands. On fe fert enfuite de moulins
a
une, deux,
qu~tre pa~es
pour l'éplucher
&
pour en í éparer la
grame, ptus on les emballe: ces balles font fort utiles
fur rner quand on eft obligé de fe battre; les coups
de moufquets
&
de canons perdent leur force con·
tr'eHes.
Le
cotonnier herbacé
fe fe me dans un champ Iabou–
ré ,
&
il efi bon
a
couper environ quatre mois apr '
S
dans les pays chauds. On le moiífonne comme tes
bleds. M. Miller dit que c'efr au printems qu'on le
feme: c'eíl en juin a Malte, fuivant le
Joumal acono–
mi'lue,
ott on ajoute qu'on a foin d'arrofer la graine
avec de l'eau
&
de la cendre pour l'empecher d'etre
rongée des vers.
Les autres efpeces peuvent etre élevées de femen–
ce dans nos climats, pourvu qu'on les fe me de tres–
bonne heure au printems ; que les laiífant fe fortifier
dans une ferre chaude' on les accoutume peu
a
peu
au grand air pendant les chaleurs,
&
qu'on les tentre
avant l'hiver.
M. Miller dit que les
cotonniers
qu 'i l a femés
au premier príntems en Angleterre,
&
tenus tonjours
dans la ferre chaude ont fleuri au mois de Juillet;
leurs graines ont parfaitement rnf1ri avant la fin de
feptembre,
&
les coques étoient auffi belles que
celles des memes efpeces dans leur chmat naturel. IL
ajoute que l'efpece qu'il a cultivée por te q uatre ou
cinq fruits fur chaque branche, quand elles ont la li–
berté de s'étendre; enforte que chaque pied peut
donner au moins une trentaine de fruits. Il faut
a
cette plante une terre
lége~e
&
feche ; il fuffit que la
pluie la mouille pendant quelques jours apres qu'on
l'a coupée
&
que le fruit a été cueilli. Un tems fec
dans le refie de la faifon, fait que le coton qni en–
toure la graine efi plus beau
&
plus abondant.
Voici l'expérience que j'ai moi- meme faite en
Suiífe fur le
cotonnier
&
fa cu lture.
Quoiqu'on appelle le
cotonnier herhacé
une plante
annuelle, il fe conferve dans
' e {erre chaude, com–
me M. Miller l'a auffi éprou
' . Mais j'ai fait fur ce
végétal une 'autre expérience : apres que les jeunes
plants font tranfplantés, on les place fous une con–
che vitrée, aífez haute pour les couvrir,
&
on leur
donne de l'air pendant les grandes chaleu rs en les
arrofant fuffifamment; il faut ouvrir les couches
dans les tems de pluie, ft l'on néglige cette précau–
tion. Mais avec ces foins, on les verra fl eurir des le
commencement d'avril,
&
enfuite former le fruit
qui peut etre m l'tr en feptembre;
&
c'efi par curioGté
&
pour voir cette efpece de pomme ou groífe noix,
qui éclate lorfqu'elle eft bien ml'Ire, ne pouvant plus
contenir le coton, qu'on en cultive chez les fl eu–
riftes.
J'ai crn que peut-etre on pourroit naturalifer
cette plante dans les lie ux les plus chauds de notre
pays, puifqu'on
y
trouve quelques plantes fponta–
nées qui le fon t dans la zone torride ;
mais
les varia–
tions trop fu bites
&
trop fr ' quentes de l'air, les vents
KKkk
















