
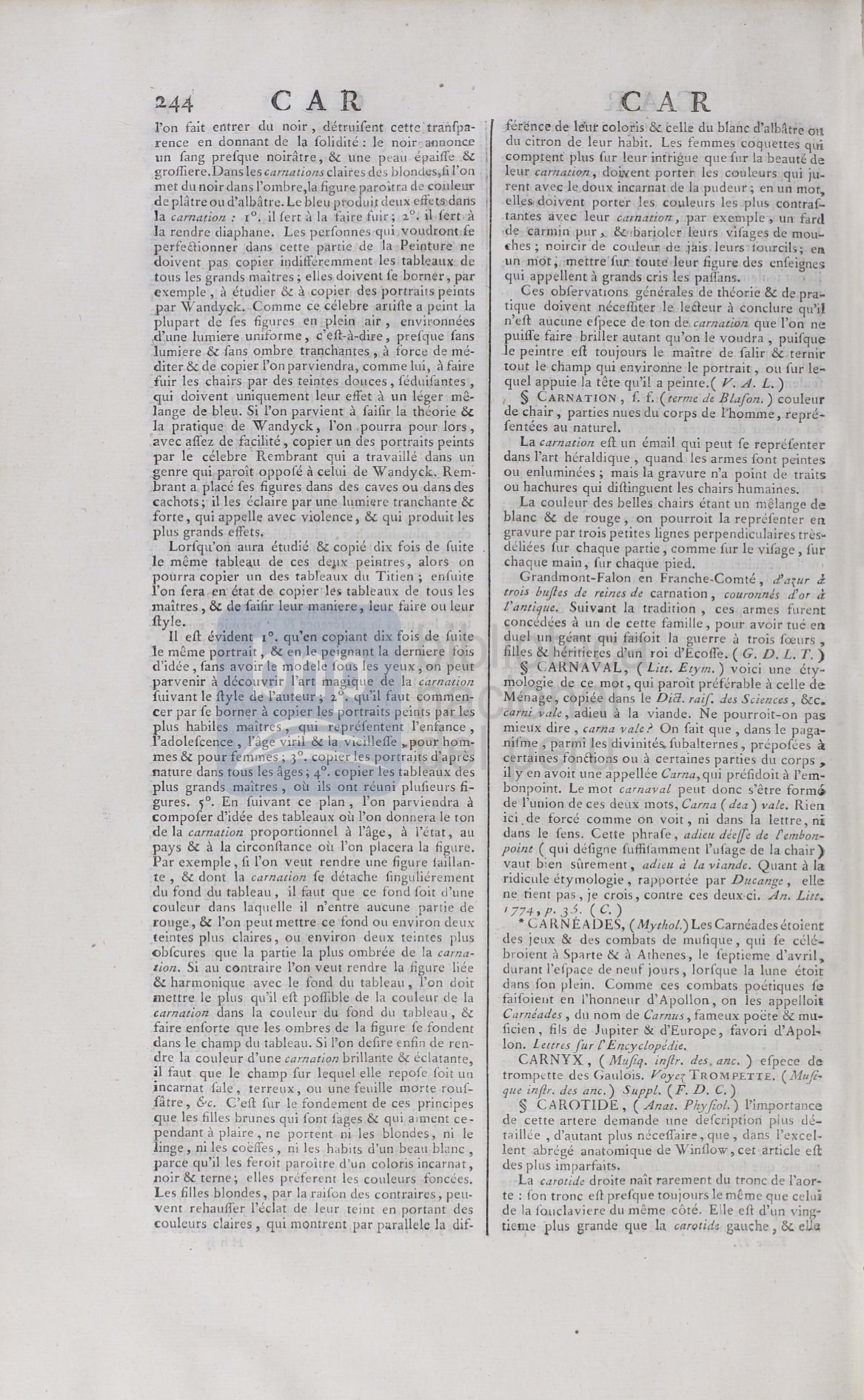
CAR
l'on fait entrer du noir, détruifent
cet.te. tranfpa–
rence en donnant de
1~
folidité : le
n01ra~monc.e
un fang prefque
noir~hre ,
&
une p ea
u
épaiife
&
groffiere.Dans les
carna.tions
claires des blondes,fi l'on
rnet du noir dans l'ombre,la figure paroitra de co,uLeur
de platre ou d'albatre. Le bleu produi.r deux effets darts
la
carnation:
¡
0 ,
ilfert
a
la fairefuir;
2°.
il
fert
a
la renclre diaphane. Les perfonnes qui voudront fe
perfeétionner dans cette partie de la Peinture ne
doivent pas copier indifféremment les tabl;eaux de
tous les grands maitres; elles doivent fe borner, par
e xemple
a étudier
&
a copier des portrairs peints
par
W
andyck. Comme ce célebre anifie a peint la
plupart de fes figures en plein air , ehvironnées
.d'une lumiere uniforme, c'efr-a-dire, prefque fans
lumiere
&
fans ombre tranchantes' a force de mé–
diter
&
de copier l'on parviendra, comme luí,
a
faire
fuir les chairs par des teintes douces, féduifantes ,
qui doivent uniquement leur effet
a
un léger me–
lange de bleu.
Si
l'on parvient a faiftr la théorie
&
la pratique de Wandyck, l'on pourra pour lors,
ave
e
~ífez
de facilité, copier un des portraits peints
par le célebre Rembraot qui a travaillé dans un
genre qui paroit oppofé
a
celui ae Wandyck.
Rem~
brant a placé fes figures daos des caves ou daos des
cachots; illes éclaire par une lqmiere tranchante
&
forte, qui appelle avee violeoce,
&
qui produit les
plus grands effets.
Lorfqu'on aura étudié
&
copié dix fois de fuite
Je
meme tableau de ces de
lX
peÍRtres, alors on
pourra copier un des tableaux du Titien ; enfuite
l'on fera ,.._en· état de copier · les tableaux de tous les
ma1tres,
&
de faiíir leur maniere, leur faire ou leur
ftylle.
11.
,
'd
•
'
.
d'
r
.
d
r
.
I
eu ev1 ent
¡
0 ,
qu en cop1ant
IX
rots
e 1L11te
le meme portrait'
&
en le peignant la derniere fois
d'idée, fans avoir
le
modele fous les yeux, on peut
.parvenir a découvrir l'art magique de la
carnation
fuivant le fiyle de l'auteur;
2
°.
qu'il faut commen–
.cer par fe
born~r
a
copier les portraits peints par les
plus habiles ma1tres, qui repréfentent l'enfaoce ,
l'adolefcence , l'age viril
&
la vieilleífe ,. pour hom–
mes
&
pour femmes;
3°.
copier les portraits d'apres
nature dans tous
l~s
ages;
4°.
copier les tableaux des
plus grands maitres , ou ils ont réuni plufieurs
fi–
gures. )
0 •
En fuivant ce plan, l'oo parviendra a
compofer d'idée des tableaux oi1l'oo donn era le ton
de la
carnation
proportionnel a l'age' a l'état' a u
pays
&
a la circonfrance
Oll
l'on placera la figure.
Par exemple,
fi
l'on veut rendre une figure íaillan–
te ,
&
doot la
carnation
fe détache finguliérement
du fond du tableau, il faut que ce fond foit d'une
couleur daos laquelle il n'entre aucune partie de
rouge,
&
l'on peut mettre ce food ou envi ron deux
teintes pl us claires, ou environ deux teintes plus
<>bfcures que la partie la plus ombrée de la
cama–
lion.
Si au contraíre l'on veut rendre la figure liée
&
harmooique avec le fond du tablean, l'on doit
mettre le plus qu'il efi poffible de la couleur de la
carnation
dans la couleur du food du t ablea u,
&
faire enforte que les ombres de la figure fe fondent
dans le champ du tableau. Si l'on defire enfio de ren–
dre la couleur d'une
carnation
brillante
&
éclatante,
il faut que le champ fur lequel elle repofe foit un
incaroat fale, terreux, ou une feuille morte rouf–
fatre,
&c.
C'efr fur le fondement de ces príncipes
que les tilles bruoes qui font fages
&
qui a1ment ce–
pendant a plaire' ne porrent ni les blondes' ni le
linge' ni les coeffes ' ni les habits d'un beau blanc'
paree qu'il les feroit paroirre d'un coloris incarnat,
noir
&
terne; elles préfe rent les couleurs
foncées~
Les filies blondes, par la raifoo des contraires, peu–
vent rehauífer l'éclat de Ieur teint en portant des
couleurs claires , qui montrent par parallele la dif-
CAR
férence de
leur
coloris
&
celk du blanc
d'alb~tre
01
du citron de leur habit. Les femmes coquettes qui
compt~nt
plus fur leur intrigue que fnr La beauté
de
leur
camatifm,
do~vent
porter les ce>uleurs qui
ju–
rent avec le doux incarnat de la pudeur; en
un
mot~
elles doívent porter les couleurs les plus contraf–
tanres ávec leur
camation,
par exemple
>
un fard
.de carmin pur,..
&
•hariQler leurs vifages
de
mou-..
ches; noircir de conleur de .iais leurs fourcil ; en
un mót; mehre'fu.r toute leur figure des enfeignes
qui appellent a grand.s cris les paífans.
. Ces
o~fervat1?ns
générales de théorie
&
de pra–
tique dOivent neceffiter le leéleur
a
conclure qu'il
n'eft aucune efpece de ton de
carnation
que l'on ne
puiífe faire briller autant qu'on le voudra , puifque
le
peintt·e
ea
toujours le maitre de falir
&
ternir
tout le champ qui environne le portrait,
ou
fur le-
quel
appuie
la
tete
qu'il
a peinre.(
V.
A.
L.)
1
§
CARNATION,
f.
f. (
terme de Blafon.)
couleur
de chair, par
ti
es nues du corps de rhomme, re pré..
fentées
au
naturel.
La
carnation
eft un émail qui peut fe repréfeoter
dans l'art héraldique, quand les armes font peintes
ou enluminées;
mais
la gravure n'a point de traits
ou hachures qui difi:ioguent les chairs humaines.
La couleur des belles chairs étant un melange de
blanc
&
de rouge, on pourroit la repréfenter
en
gravure par trois perites lignes perpendiculaires tres–
déliées fur chaque partie, comme fur le vifage, fur
chaque main, fur chaque pie
d.
Grandmont-Faloo en Franche-Comté,
d'atur
J
trois bujles de reines de
carnation'
couronnés d'or
a
.Z'antique.
Suivant la tradirio n , ces armes furent
concédées a un de cette famille, pour avoir tué en
duel un géaot qui faifoit la guerre
a
trois freurs ,
filies
&
héritieres d'un roi d'Ecoífe. (
G. D. L.
T.)
§
CARNAVAL, (
Litt. Etym.)
voici une éty–
mologie de ce mor' qui paroit préférable a celle
de
Ménage, copiée dans le
Día.
raif. des Sciences,
&c..
cami vale ,
adieu
a
la viaode .
N
e pourroit-on pas
mietix dire,
cama vale?
On fait que, dans le paga–
nifme' parmi les divinités. fubalternes' pr
1
po~ '
es
a
certaines fonél:ioos ou
a
certaines parties du corps
,
il
y
en avoir une appellée Carna,gui préfidoit
a
l'em–
bonpoint.
Le
mot
carnaval
peut done s'etre form<i–
de l'union de ces deux mots,
Cama ( dea) vale.
Ríen:
ici .de forcé comme on voit , ni daos la lettre,
ni
dans le fens. Certe phrafe,
adieu
déelf~
de l'embon–
point
(
qui déftgne fuffifammenr l'ufage de la chair}
vaut bien Sllrement,
adieu
a
la viande.
Quant
a
Ja
ridicule étymologie, rap porrée par
Ducange,
elle
ne tient pas, je crois, contre ces deux-ci.
An. Litt.
'774,P·3-'· (C.)
*CA RNÉA DES, (
Mythol.)
Les Carnéades étoient
des jeux & des combats de muíique, qui fe célé–
broiem
a
Sparte
&
a
Arhenes, le feptieme d'avril,.
durant l'efpace de neuf jours, lorfque la lune étoit
dans fon plein . Comme ces combats poétiques fe
faifoient en l'honneur d'Apollon, on les appelloit
Carnéades,
du nom de
Camus,
fameux poete
&
mu–
ficien, fils de Jupiter
&
d'Europe,
favori
d'Apol..
Ion.
1 ettres fur
l'
Encyclopédie.
CARNYX, (
Mujiq. inflr. des anc.
)
efpece de
tromp tte des Gaulois.
Voye{
TROMPETTE.
(A1uji..
que injlr. des anc.)
Suppl. (F.
D. C.)
§
CAROTIDE, (
Anat. Phyjiol.)
l'importance
de cette artere demande une defcription plus dé–
taill ' e , d'autaot plus néceífa ire, que, dans l'excel
lent abrégé anatomique de \Vinílow, cet article eft
des plus imparfaits.
La
carotide
droite nait rarement du tronc de l'aor–
te : fon tronc eft prefgue toujours le meme que celui
de la fouclaviere du meme coté. Elle efi d'un ving–
tiente plus grande que la
carotide
gauche )
&
elle
















