
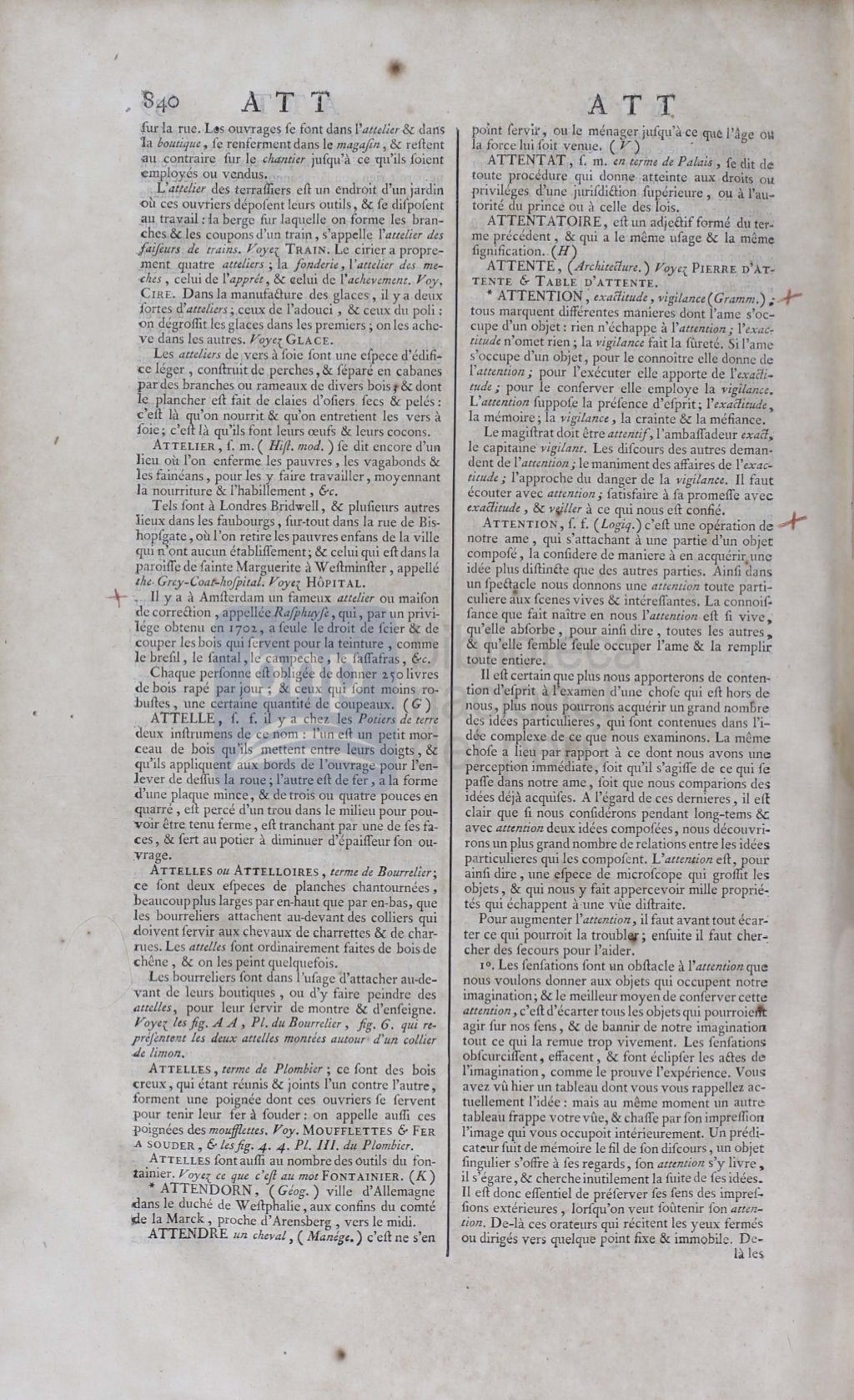
ATT
Suda me.
L~s
ouvrages fe font dans
l'attelier&
darts
'la
boutique,
fe renferment dans le
magaJin,
&
reíl:ent
.au contraire fur le
c"amier
jufqu'a ce t¡u'ils foient
employés
0\1
vendus.
L'atrelier
des terraffiers
eíhm
endroit d'un jardin
-Qtl ces ouvriers dépofent lenrs outils,
&
fe di(pofent
.au travail :
13
berge fur laquelle on forme les bran–
ches
&
les coupons d'un traiJl, s'appelle
l'attelier des
JaYeurs de trains. Voye{
TRAIN. Le cirier a propre–
ment qnatre
atteliers;
la
fonderi~,
I'allelier des me–
clzes,
celui de
I'appre't,
&
aelui de
l'aclzevement. Voy,
CIRE. Dans la manufaaure des glaces, il ya deux
fortes
d'attellers;
ceux de l'adouci ,
&
ceux du poli:
on dégroffit les glaces dans les premiers ; on les ache–
ve dans les atllres.
Voye{
GLACE.
Les
atteliers
de vers a foie font une efpece d'édiJi.
ce léger , coníl:ruit de perches,
&
féparé en cabanes
par des branches ou rameaux de divers bois1
&
dont
le plancher eil fait de claies d'ofiers [ees
&
pelés :
c'eil
M.
qu'on nourrit&: qu'on entretient les vers a
foie; c'eíl: la qu'ils font lettes reufs
&
leurs cocons.
ATTELIf.R, [. m. (
Hifl.
modo
)
[e dit encore d'un
lieu
0\1
l'on enferme les pauvrcs, les vagabonds
&
les fainéans, pour les y faire travailler, moyennant
la nourritme
&
l'habillement ,
&c.
Tels [ont a Londres Bl·idwell,
&
plnfieurs autres
lieux dans les faubourgs, [m-tout dans la rue de Bis–
hop[&ate, oh
I
'on retire les pauvres enfans de la ville
qui n ont aucun établiIfement;
&
celui qui eíl:dans la
paroiífe de [ainte Marguerite aWeíl:miniler , appellé
L!L~.
Grey-Coat-Izofpital. Voye{
HOPITAL.
-t '
II Y
a a Amíl:crdam un fameux
audier
ou mai[on
de correél:ion , appellée
RaJPlllirfl
,qui, par un privi–
lége obtenu en
170'2,
a feule le droit de [cier
&
de
couper les bois qui [ervent pour la teinture , comme
le
b~efu,
le fantal, le campeche, le [aífafras,
&c.
Chaque perfonne eíl: obligée de donner
'250
livres
de bois rapé par jour;
&
ceux qui font moins ro–
buíl:es, une certaine quantité de coupeaux.
(G)
ATTELLE, [. f.
il
ya chez les
PotÍers de terre
·deux inilrumens de ce nom : l'un eíl: un petit mor–
A:eau de bois qu'ils mettent entre leurs doigts,
&
qu'ils appliquent aIL" bords de I'ouvrage pour l'en–
lever de deífns la roue; l'autre eíl: de fer, a la forme
d'une plaque mince,
&
de trois ou quatre pouces en
quarré , eíl: percé d'un trou dans le milieu pour pou–
·voir
~tre
tenu ferme , eíl: tranchant par une de [es fa–
ces,
&
fert au potier a diminner d'épaiífeur fon ou–
.vrage.
ATTELLES
ou
ATTELLOIRES,
terme de Bourrelier;
ce [ont deux efpeces de planches chantournées,
beaucoup plus larges par en-haut que par en-bas, que
les bourreliers attachent au-devant des colliers qui
doivent [ervir aux chevaux de charrettes
&
de char–
mes. Les
aue!üs
font ordinairement faites de bois de
ch~ne,
&
on les peint quelquefois.
Les
bourreliers font dans ['ufage d'attacher au-de–
vant de leurs boutiques, ou d'y faire peindre des
attelles,
pour leur fervir de montre
&
d'enfeigne_
Voye\. les fig. A A
,
PI. du Bourreiier, fig.
6.
q/ti re–
pr¿/ent~nt
les deux attelles mondes alttour d'un collier
.de limon.
ATTELLES,
terme de Plombier;
ce font des bois
creux,
ql.liétant réunis
&
joints l'un contre l'autre,
forment une poignée dont ces ouvriers [e fervent
pOlte tenir leur fer a [ouder: on appelle auffi ces
:poignees
des
mouffieues. Voy.
MOUFFLETTES
&
FER
A
SOUDER,
&
üsfig-
4-
4.
PI.
lll.
du Plombier.
ATTELLES font aulIi au nombre des outils du fon–
tainier.
Voye{ ce que c'eft au mot
FON'IAINIER.
(K)
*
ATTENDORN,
(Giog.)
ville d'Allemagne
Clans le duché de Weíl:phalie, aux confins du comté
11e la Marck , proche d'Arensberg , vcrs le midi.
ATTENDRE
un che-vat ,
(
Mantce. )
c'eíl: ne s'en
ATT
po)nt fervit, ou le ménager ju[qu'a ce
que
l'~ge
o"
la force lui [oit venue.
(V)
.
ATTENTAT,
f.
rn.
en terme de Palaio,
fe dit
d~
toute ,Procédure qlLÍ donne at,teinte aux droits ou
-privileges d'une jmifdiaion
[lIp~rieure,
ou a l'au–
torité du prince ou
a
celle des [ois.
ATTENTATOIRE, eíl:un adjeilifformé du ter–
me précédent,
&
qui a le
m~me
ufage
&
la
m~me
f1gnification.
(H )
ATTENTE,
(Arcluteélure.) Voye{
PI
ERRE D'AT–
TENTE
&
TABLE D'ATTENTE.
*
ATTENTION,
exaélitude, vigilance (Gramm.)
¡
tous marquent différentes mániere5 dont ['ame s'oc–
cupe d'un objet: rien n'échappe a
l'atuntion; l'e."ac–
titlide
n'omet rien ; la
vigilance
fait la fftreté. Si l'ame
s'occupe d'un objet, pour le connoltre elle donne de
l'
aaention;
pOLlr
¡>
exécuter e11e apporte de
l'
exaai–
tilde;
pour le conferver elle employe la
vigilance.
L'attenlÍon
fuppof,e la préfence d'e[prit;
l'exaaitude,
la mérnoire; la
vigilance,
la crainte
&
la méfiance.
Le magiíl:rat doit
~tre
attentif,
l'ambaífadeur
exaél.
le capitaine
vigilant.
Les di[cours des autres deman–
dent de
l'attention;
le maniment des alfaires de
l'exac–
titude;
l'approche du danger de la
vigilan".
I1
faut
écouter avec
attention;
fatisfaire
a
[a promeífe avec
exaélitude,
&
v~ller
a ce qui nous eíl: confié.
ATTf.NTION, f. f.
(Logiq.)
c'eil une opération de
~
notre ame, qtú s'attachant a une partie d'un objet
compofé, la confidere de maniere a en acqtlérir.une
idée plus diíl:inae qtle des autres parties. Ainfi dans
un [peaacle nous donnons une
naention
toute parti–
culiere aux [cenes vives
&
intéreífantes. La connou.
[ance qtle fait naltTe en nous
l'attention
eíl:
íi
vive;
qtl'elle ab[orbe, pour ainfi dire , toutes les autres
~
&
qu'elle femble feule occuper I'ame
&
la remplir.
toute entiere.
Il
eíl: certain que plus nous apporterons de conten–
tion d'efprit a I'examen d'une chofe qui eil hor5 de
nous, plus nous pourrons acquérir un grand nomóre
des idées particulieres, qui font contenues dans l'i–
dée complexe de ce que nous examinons. La
m~me
chofe a lieu par rapport
a
ce dont nous avons une
perception immédiate, foit qu'il s'agiífe de ce qui fe
paífe dans notre ame, [oit que nous comparions des
idées déja acquifes. A l'égard de ces dernieres, il eft
clair que
fi
nous confidérons pendant long-tems
&
avec
attention
deux idées compo[ées, nous découvri·
rons un plus grand nombre de relations entre les idées
particulieres qui les compo[ent.
L'
attention
eíl:, pour
ainfi dire , une e[pece de micro[cope qui groffit les
objets,
&
qui nous y fait appercevoir mille
proprié~
tés qui échappent a-une vlle diíl:raite.
Pour augmenter l'
attenlÍon,
il faut avant tout écar":
ter ce qtli pourroit la trouble,¡-; enfuite il faut cher-.
cher des [ecours pour l'aider.
1°.
Les [enfations font un obíl:ac1e
a
l'attentionque
nous vOluons donner aux objets qtLÍ occupent notre
imagination;
&
le meilleur moyen de conferver cette
attention,
c'eíl: d'écarter tous les objets qtli pourroieIft:
agir [ur nos fens,
&
de bannir de notre imagination
tout ce qtLÍ la remue trop vivement. Les fen[ations
obfcurciífent, effacent,
&
font éclipfer les aaes de
l'imagination, comme le prouve l'expérience. Vous
ave1. vu hier un tablean dont vous vous rappellez ac–
tuellement l'idée : mais au meme moment un autre
tableau frappe votre v\te,
&
chaífe par fon impreffion
l'image qui vous occupoit intérieurement. Un pré?i–
cateur fuit de mémoire le
Jil
de fon di[cours, tm obJet
finr"lier s'olfre
a
fes regards, ron
auentioll
s'y livre.
il s égare,
&
cherche inutilement la [uite de fes idées_
Il
eíl: done eífentie! de préferver [es fens des impre[–
fions extérieures, lorfqu'on veut fOlltenir ron
atten–
tion.
De-la ces orateurs qui récitent les yeux fermés
ou dirigé.s vers quelque point
fixe
&
immobile. De-
l~
le$
















