
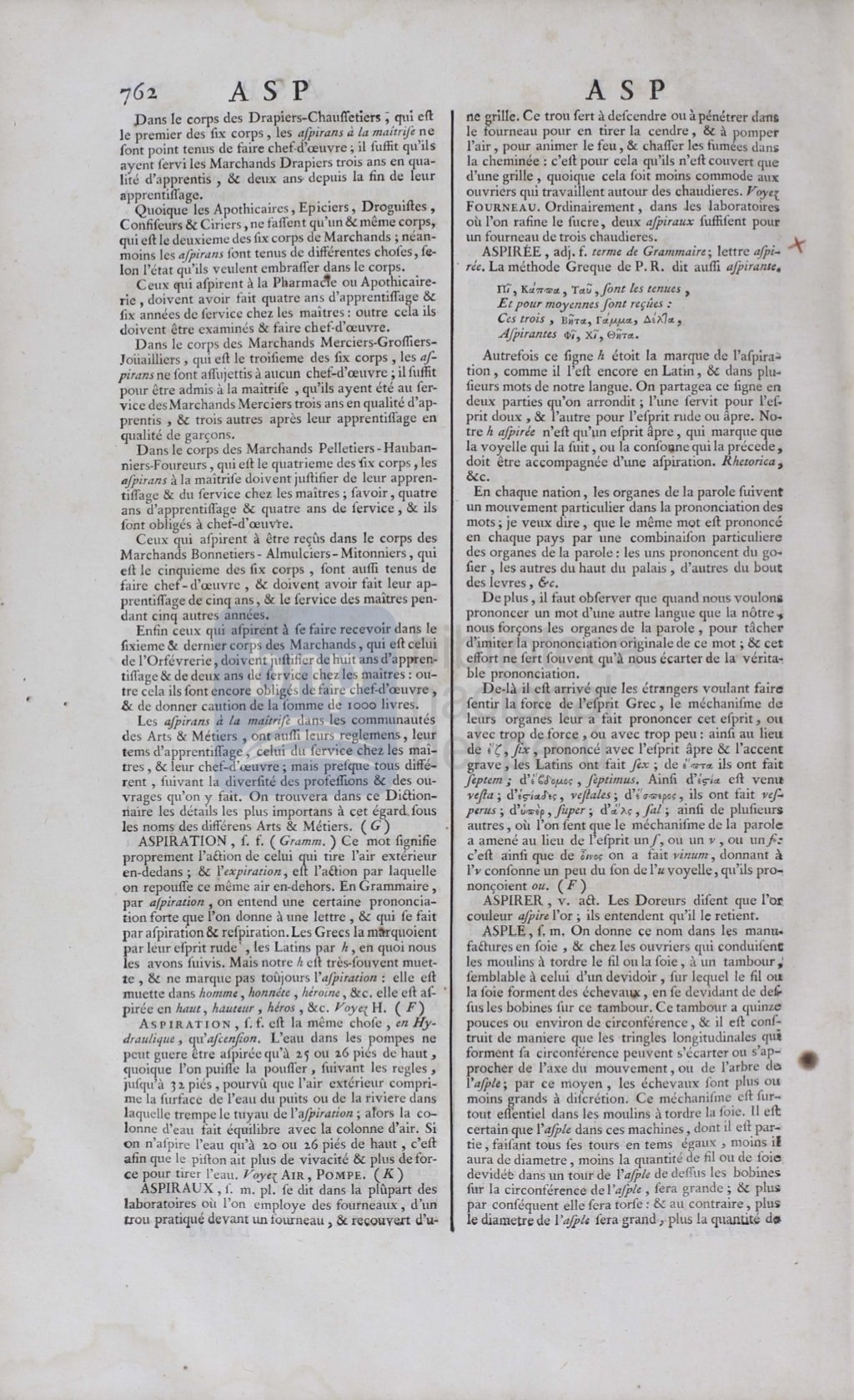
ASP
Dans le corps des Drapiers-ChauíI'etiers; qui
dI:
le premier des üx corps, les
aJPirans
a
la maítrije
ne
font point tenus de faire chef.d'ceuvre;
il
[uffit qu'ils
ayent [ervi les Marchands Drapiers ?"ois ans en qua–
lité d'apprentis ,
&
deux ans depUls la fin de leur
apprentiKage.
. .
. .
.
Quoique les Apothlcalres, EpIClers, Droguiíl:es ,
Confi[eurs
&
Ciriers, ne faíI'ent qu'un
&
meme corps,
qui 13ft le deuxieme des üx corps de Marchands ; néan–
moins les
aJPirans
[ont tenus de différentes chofes, fll–
Ion l'état qu'ils veulent embraíI'er dans le corps.
Ceux
qttÍ
a{pirent
a
la Pharmac1e ou Apothicaire–
rie , doivent avoir fait quatre ans d'apprentiifage
&
{¡x années de [ervice chez les maitres : outre cela
ils
eloivent etre examinés & faire chef-d'ceuvre.
Dans le corps des Marchands Merciers-Groffiers–
Joiiailliers, qui eft le troiüeme des ftx corps , les
a!–
pirans
ne font aíI'ujcttis
a
aucun chef-d'ceuvre;
il
fuffit
pour etre admis
a
la maitri[e ,qu'ils ayent été au [er–
vice desMarchands Merciers trois ans en qualité d'ap–
prentis ,
&
trois alltres apres leur apprentiífage en
ql1alité de gar<;ons.
.
D ans le corps des Marchands Pelleuers- Hauban–
niers-Foureurs, qui eft le quatrieme des
'fix
corps , les
aJPirans
a la maltri[e doivent juil:ifier de leur appren–
tiíTage & du [ervice chez les maitres ; favoir, quatre
ans d'apprentiírage
&
'luarre ans de fervice, & ils
(ont obligés
a
chef-d'ceuvre.
Ceux 'lui a(pirent
a
erre reC;lls dans le corps des
Marchands Bonnetiers - Almulciers- Mitonniers , qui
eft le cinquieme des ftx corps , font auffi tenus de
faire chef- d'ceuvrc ,
&
doivent avoir fait leur ap–
prentiíTage de cinq ans, & le fervice des maltres pen–
dant cinc¡ autres années.
Enfin ceux 'lui a(pirent
a
fe faú'e recevoir dans le
fixieme
&
dernier corps des Marchands, 'lui eft celui
de l'Orfévrerie, doivent juftifier de huit ans d'appren–
tiírage & de deux ans de [ervice chez les maitres : ou–
tre cela ils font encore obligés de faire chef-d'ceuvre ,
&
de donner caution de la Comme de
1000
livres.
Les
afpirans
a
la maitrift
dans les communautés
eles Arts & Métiers , ont auíTi leurs reglemens, leur
tems d'apprentiíTage, celui du fervice chez les mal–
tres,
&
leur chef-d'ceuvre; mais preCque tous diffé–
rent , Cuivant la diverftté des profeíTions
&
des ou–
vrages qu'on y fait. On trouvera dans ce Diaion–
naire les détails les plus imporrans
a
cet égarclfolls
les noms des dilférens Arts & Métiers.
(G)
ASpIRATION, f. f.
(Gramm.
)
Ce mot
fi~nifie
proprement l'aajon de celui qui tire l'air exterieur
en-dedans;
&
l'expiration,
e11l'aaion par laquelle
on reponífe ce meme air en-dehors. En Grarnmaire ,
par
a[piration,
on entend une certaine prononcia–
tion forre gue l'on donne
a
une leme ,
&
qui fe fait
par a[piratlOn
&
reCpiration. Les Grecs la m:tr'luoient
par leur e[prit rude ' , les Latins par
Iz,
en quoi nous
les avons ftúvis. Mais notre
/z
e11: tres-[ouvent muet–
te ,
&
ne marque pas tO\ljours l'
aJPiration:
elle eft
muette dans
/zomme
,
/zonnete
,
lzéroine,
&c. elle e11 af- .
pirée en
IUlut, Izautmr, Uros,
&e.
Voye{
H.
(F)
As PIRATION, (. f. e11 la meme cho[e,
en
Hy–
draulique,
epX
afcenJion.
L'ean dans les pompes ne
pent guere etre aCpirée qu'a
25
ou
26
piés de haut
~
quoique l'on puiífe la pouíTer, fuivant les regles ,
jlúqu'a 32 piés , pOurVll que l'air extérieur compri–
me la [urface de l'eau du puits ou de la riviere dans
laquelle trempe le tuyau de
l'aJPirarion
;
alors la co–
lonne d'eau fajt équilibre avec la colonne d'air. Si
on n'afpire l'eau qu'a
20
ou
26
piés de haut , c'eft
afin que le pifion ait plus de vivacité
&
plus de for–
ce pour tirer l'eau.
Voye{
AIR, POMPEo
(K)
ASPIRA
UX
,f. m. pI. [e dit dans la plllpart des
laboraroi:es Ol! l'on employe des foUrneaIL"l(, d'un
trou pratlqué devant lUl fé:mrneau )
&
recouve,rt d'u-
ASP
ne grille. Ce trou fert
a
defcendre ou
a
pénétrer dan,
le fourneau pour en tirer la cendre,
&
a
romper
l'air, pour animer le fen, & cha1Ter les fiunees damo
la cheminée : c'eft ponr cela qu'ils n'eft couverr que
d'une grille, 'Iuoique cela [oit moins cornmode a\lX
ouvriérs qui travailient autour des chaudieres.
V<rye{
FOURNEAU. Ordinairement, dans
les
Jaboratoirei
ol! l'on rafine le [ucre, deux
aJPirawc
fuffifent pOli!
lm fO\lrneau de trois chaudieres.
ASPIRÉE, adj. f.
ttrme de Grammaire;
Iettre
aJPi-
. de.
La méthode Greque de P. R. dit allffi
aJPirame.
ni,
Kd7T'G1a., Ta.ü
,font
les
tenues,
Etpour moyeTmes fom re9úes :
Ces trois
~
B»Ta., r'¡p.}ML, Af.711a.,
AJPirantes
<1>1',
xI',
e»Ta..
Autrefois ce figne
/z
étoit la marque de l'a[pira,;,
tion, comme il l'e11: encore en Latin,
&
dans plll–
fieurs mots de notre langue. On partagea ce figne en
dellX parties qu'on arrondit; l'une fervjt pour l'e[.
prit doux , & l'autre pour l'efprit mde ou apre. No.
tre
/z
aJPirée
n'eft qu'tm eCprit ¡¡pre, qtú marque qtle
la voyelle qtlÍ la fuit , ou la confolilne qtli la précede,
doit etre accompagnée d'tme afpiration.
R/zetorica ,
&c.
En chaqtte nation, les organes de la paroIe [uivent
un mouvement particulier dans la prononciation des
mots; je VetlX dire, que le meme mot eft prononcé
en chaque pays par une combinaifon particuliere
des organes de la parole: les uns prononcent du go.
fier , les autres du haut du palais , d'autres du bout
des levres,
&c.
De plus, il faut ob[erver qtte qttand nOtlS voulom;
prononcer un mot d'une autre langue que la notre"'T
nous fon;:ons les organes de la parole , pour tilcher
d'inlÍter la prononciation originale de ce mot ;
&
cet
elfort ne [err [OU vent qtt'a nous écarter de la
vérita~
ble prononciation.
De-la il eft arrivé qtte les étrllngers vouIant faire
(entir la force de l'efprit Grec, le méchanifme de
leurs organes leur a fait prononcer cet efprit,
Oll
avee trop de force, ou avec trop peu: ainft au lieu
de
ti; ,
jix
,
prononcé avec l'efprit apre
&
l'accent
grave, les Latins ont fait
fex
;
de
f''WTa.
ils ont fait
fiptem;
d" '''J'op..~,
fiptimus.
Ainft d"s-Ia. eft venu
'Yefta;
d'
's-lctJ't~,
'Yejtales ;
d'
" ..
'G1'pO~,
ils ont fait
'Y'¡:"
pmts
;
d'~,..~p,
filper;
d'
d.'7I~ ,
fal;
ainft de plufieurs
autres, Ol! l'on fent que le méchani{me de la parole
a amené au lieu de l'e[prit
unf,
ou un
'Y,
ou unf:
c'eft a'Ínft qtle de
ó",O~
on a fair
'Yinum,
donnant
a
1''1'
con{onne un peu du fon de l'u voyelle, qn'ils pro–
non~oient
Olt.
(F)
ASPIRER, v. aa. Les Doreurs diCent que
l'or,
couleur
aJPire
l'or ; ils entendent qtt'ille retient.
ASPLE,
f.
m. On donne ce nom dans les manu.
faaures en foie , & chez les ouvriers qui conduiCent
les moulins
a
tordre le
6.1
on la foie ,
a
un tambour
~
{emblable
a
celui d'un devidoir , fUI" lequel le fil ou
la foie forment des échevaux, en fe devidant de defi.
[us les bobines fur ce tambour. Ce tambour a qtlinze
pouces ou environ de circonférence , & il e11: conC–
tntit de maniere que les tringles longitudinales qui
forment fa circoruerence peuvent s'écarter ou
s'ap~
procher de l'axe du mouvement, ou de l'arbre de
I'a¡ple;
par ce moren, les échevaux font plus ou
moins grands
a
dilcrétion. Ce méchani(me. eft (ur–
tout eílentiel dans les moulins
a
tonlre la fOle. Il eft
certajn 'fue
l'aJPIe
dans ces machines, dont il eft par–
tie, fallant tous [es tonrs en tems égaux, moins il
aura de diametre , moins la quantité de fil on de foio
devidéé dans un tour de
l'aJPle
de deírus les bobines
nlr
la circonférence de
1
'aJPIe
,
[era grande ;
&
plus
par conféqtlent elle [era torfe :
&
au contraire, plus
le ruametre de
l'aJPle
fera grand, plus la qtIantité dct
















