
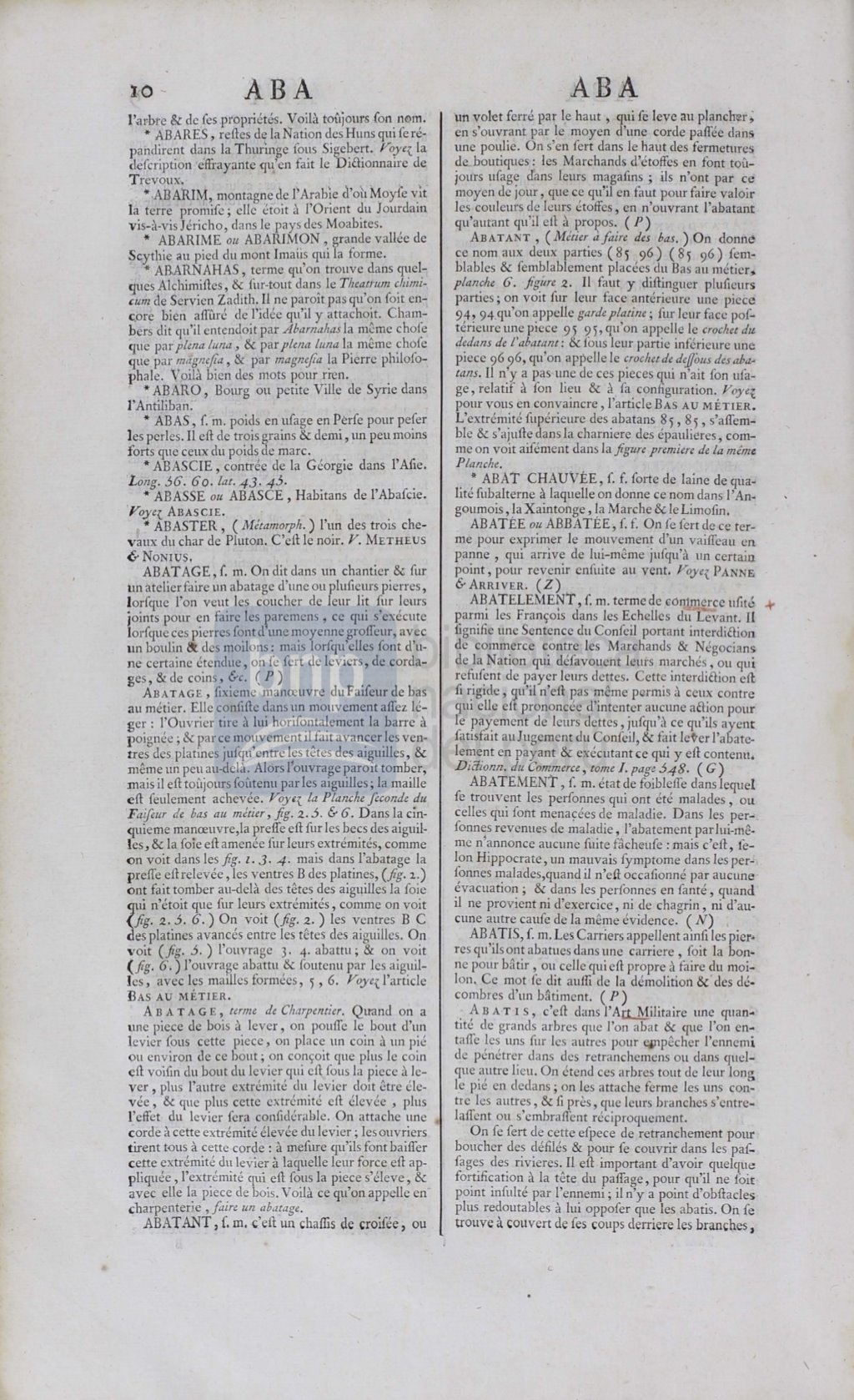
'ABA
l'arbl'e
&
de [es ptopriétés. VoiJa tOí'ljOurS fon n0m.
*
ABARES, refres de la Nation des Huns qui (e ré–
pand~re~t
dans la Thunnge
íOl.1S
Sige?ert.
rOlet
la
de(cnphoneffrayante 'Iu'en falt le DlfriolUlalre de
Trevoux,
*.ALlA'RUv,t, montagne de l'Arable
d'O~l
Moyfe
~lt
la terre promi(e; elle étoit a l'Orient
~u
Jourdam
vis-a-vis Jéricho dans le pays des Moabttes.
*
ABARIME
'Olt
ABARIMON, grande vallée de
Scythie au pied du mont Imaiis qui la forme.
*
ABARNAHAS, terme Cju'on trouve dans quel–
ques Alchin:ifres,
&
[ur-tout
dan~
le
Thea,trllln
~Izimi
cum
de Sel"Vlen Zadlth. II ne parol! pas qu on [Olt en–
cpre bien aíluré de l'idée qu'il y attachoit. Cham–
bers dit qu'il entendoit par
Abarnahas
la meme chofe
Cjue par
plena luna,
&
par
plena ll/na
la meme
~ho(e
que par
mágllefla,
&
par
magnefla
la Plerre phtlo[o–
phale. Voila bien des mots pour rien.
*
ABARO, Bourg ou petite Ville de Syrie dans
l'Antiliban.
*
ABAS,
f.
m. poids en u(age en Pér(e pour pe(er
les perles. I1 efr de trois grains
&
demi, un peu moins
forts que ceux du poids de marco
*
ABASCIE , contrée de la Géorgie dans l'Aíie.
'Long.
J6.
60.lat·43·
4J·
*
ABASSE
Olt
ABASCE, Habitans de l'Aba(cie.
'Yoye{
ABASC1E.
*
ABASTER,
(Métamorplz.)
I'un des trois che–
vaux du char de Pluton. Cefr le noif.
r.
METHEUS
éT
NONIUS.
ABATAGE,f. m. Onditdans un chantier
&
(ur
un atelierfaire un abatage d'une ou pluíiems pierres,
lorfque I'on veut les coucher de leur lit (ur
Imus
joints pour en faire les raremens , ce qui s'exécute
lor(queces pierres(ontd unemoyenne grolfeur, avec
un boulin
&.
des moilons; mais lorfqu'elles (ont d'u–
ne certaine étendue, on fe (ert de leviers, de corda-
ges,
&
de coins,
&c.
(P)
.
ABATAGE, íixieme manreuvre duFal(eur de bas
au métier. Elle confifre dans un mouvement alfez lé–
ger; 1'0uvrier tire a lui hori(ontalement la barre
a
poianée ;
&
parce mouvement il fait avancer les ven–
ttesOdes platines jufqu'entre les tetes des aiguilles,
&
meme un peu au·dela. Alors
1
1
0uvrage parolt tomber,
mais il efr toujours (oí'ttenu par les aiguilles; la maille
efi {eulement achevée.
roy"t la Plancl" Jeconde du
Fai[eur de
bas
alt mJtier, jig.
2.
J.
&
6.
Dans la cin–
quieme manreuvre,la prelfe eíl: fur les becs des aiguil–
les,
&
la (oie eframenée fuI' leursextrémités, comme
on voit dans les
jig.
l .
3.
4-
mais dans I'abatage la
prelfe efrrelevée, les ventres B des platines,
(jig.
2.)
ont fait tomber au-dela des tetes des aiguilles la (oie
CJ1lÍ
n'étoit que (ur lems extrémités, comme on voit
(jig.
2.
J.
6. )
On voit
(jig.
2. )
les ventres B C
¿es platines avancés entre les tetes des aiguilles. On
voit
(fíg.
J. )
l'ouvrage
3·
4. abattll;
&
on voit
(jig.
6.)
l'ouvrage abattu
&
(outenu par les aiguil–
les, avec les mailles forrnées, 5 ,6.
royet
l'artiele
13As AU MÉTIER.
A BATAG
E,
terme de C/uzrpentier.
Qtrand on a
une piece de bois a lever, on poulfe le bout d'un
levier fous cette piece, on place un coin
a
un pié
ou environ de ce bout ; on cons;oit que plus le coin
efr voifm du bout du levier qui efi fous la piece
a
le–
ver, plus I'autre exrrémité du levier doit etre éle–
vée,
&
que plus cette extrémité eíl: élevée , plus
l'effet du levier (era confldéraale. On attache une
corde
a
cette extrémité élevée dulevier ; lesouvriers
tirent t<luS
a
cette corde :
a
me(ure qu'ils font baill'er
cette extrémité dulevier
a
laquelle leur force efr ap–
pliqllée, I'extrémité c¡ui efr (ous la piece s'éleve,
&
avec elle la piece de bois.Voila ce qu'on appelle en
charpenterie ,
faire un abatage.
ABATANT ,
f.
m. ,'efr un chaffis de uoifée , OU
ABA
un voler ferré par le haut , qui fe leve al! planchTtr;
en s'ouvrant par le moyen d'une corde pall'ée dans
une poulie. On s'en (ert dans le haut des fermetures
de boutiques; les Marchands d'étoffcs en fonr tou–
jours u(age dans leurs magaíins ; ils n'ont par ce
moyen de jour , que ce qu'il en f¡lUt pour faire valoir
les cOllleurs de leurs étoffes, en n'ouvrant l'abatant
qu'autant qu'il efr
a
pro~os.
(P )
ABATA 'T,
(Méder afaire des bas.)
On dooné
ce nom aux deux pa11ies (85 96) (85 96) fem–
blables
&
(emblablement placées du Bas au métier,
planche
6.
jigure
2.
I1 fam y difrinauer pluíieurs
parties; on voit (ur lem face
antérie~re
une piece
94,
94.qu'on appelle
garde platine;
ftu leur face pof–
térieure
U1~e
píece 9) 95, qu'on
ap~el~e
le
~roc/ze&
du
dedans de
L
abatant;
&
(ous leur pame mféneure une
piece 96 ?6, qu'on appelle le
croclzetde
defloltS
des
aba–
tamo
II n ya pas une de ces piec¡¡s qui n'ait (on u(a–
ge, relatif
a
(on lieu
&
a
(a configuration.
royef.
pour vous en convaincre, l'artieleBAs AU MÉTIER.
L'cxtrémité lilpérieure des abatans 85, 85, s'aílem–
ble
&
s'ajuile dans la charniere des épaltlieres com–
me on voit ai(ément dans la
figure premiere de
l~
meme
Planche.
" ABAT CHAUVÉE,
f.
f. folie de laine de qua–
lité (ubalterne
a
laqueHe on donne ce nom dans l'An–
g0umois, ,la Xaintonge, 1a Marche
&
leLimofm.
ABATEE
Olt
ABBATEE,
f.
f. On (e (ert de ce ter–
me p01U exprimer le mouvement d'un vailfeau en
panne , qui arrive de lui-meme ju(qu'¡'¡ un certain
poinr, pour revenir enCuite atl vento
roye{
PANNE
&
ARRrVER.
(Z)
ABATELEMENT, (. m. terrne de €Onlmerce uíité
..¡.
parmi les Frans;ois dans les Echelles du Levant. Il
íignifie une Sentence du Con(eil portant interditl:ion
de commerce contre les
Mar~hands
&
Négocians
de la Nation qui dé(avouent leurs marchés, ou qui
refu(ent de payer leurs dettes. Cette int¡¡rditl:ion eíl:
fi rigide, CJu'il n'efi pas meme permis
a
ceux contre
qui elle efi prononcée d'intenter aUClme aétion pour
le payement de leurs dettes, ju(qu'a ce qu'ils ayear
fatisfait au Jugement du Con(eil,
&
fait
le~er
I'abate–
lement en payant
&
exécutant ce qui y eíl: contenu,
lJiílionll. dlt Commerce, tome
J.
page
J48.
(G)
ABATEMENT, {. m. étatde foiblelfe danslequeI
(e trouvent les perfonnes qui ont été malades ou
celles c¡ui (ont mena\=ées de maladie. Dans les 'per–
(onnes revcnues de malaclie, l'abatement parlui-me–
me n'annonce aucune (uite facheu(e ; mais c'eíl:, (e–
Ion Hippocrate, un mauvais (ymptome dans les per–
(onnes malades,quand il n'e!!: occalionné par aucune
~vacuation;
&
dans les perfonnes en (anté , c¡uand
il ne provlent ni d'exercice, ni de chaQTin,
ni
d'au–
cune autre caufe de la meme évidence.
o
(
N)
AB~
TIS,
f.
m. Les Carriers appelJent ainíi lespier–
res qll'!lson: abatues dans une carriere, (oit la bon–
ne pour batir, ou celle qui eíl: propre a faire du moi–
Ion. Ce mot (e dit auffi de la démolition
&
des dé.
combles d'un batimento
(P )
. -f\
BATI S, c'efi dans l'Al1.M.ilitaire ¡me
c¡uan~
hte. de grands arbres c¡ue I'on abar
&
que l'on en–
tafie les uns Cm les autres pour e¡;npecher l'ennemi
de pénétrer dans des retranchemens ou daos quel–
que auo'e lieu. On étend ces arbres tout de leur long
le pié en dedans ; on les attache ferme les uns con–
tre les autres,
&
ti
pres, que leurs branches s'entre–
lalfent ou s'embralfent réciproquement.
On (e (ert de cette e(pece de retranchement pour
boucher des défilés
&
pour (e couvru dans les paC.
(ages des rivieres. II eíl: important d'avoÍI c¡uelque
f0t?fi~ation
a la
t~te
du palfage, pour qu'il ne loit
pomt m(ulté par Iennemi ; il n'y a point d'obíl:acles
plus redoutables
¡)
lui oppo(er que les abatis. 011, fe
trouve
a
'Otl
ven de (es coups clerriere
les
bran,hes,
















