
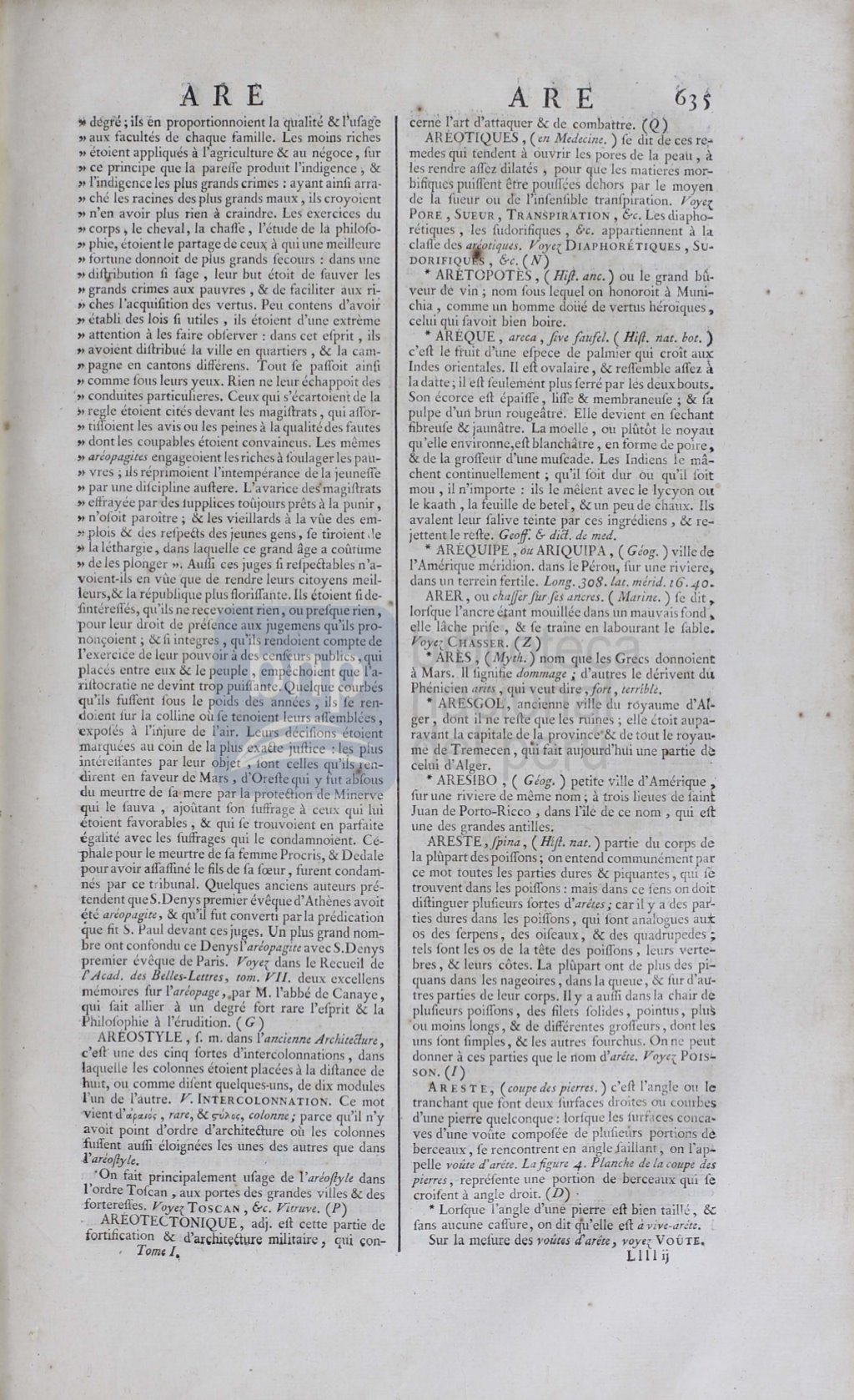
ARE
,. degr"é ;
as
·én proportionnoient laqllalité & llufage
"aux facultes de chaque famille. Les moins riches
" éroient appliqués
a
I'agricultllre & au négoce , fur
" ce principe que la pareífe prodlllt l'indigence,
&
" I'indigence les plus grands crimes : ayant ain/i arra–
" ché les racines des plus grands maux, ils croyoient
" n'en avoir plus rien
a
craindre. Les exercices du
"corps; le
cheval,
la chafle, l'étude de la philofo–
" phie, étoient
le
partage de cem;
a
qui une meillcure
" tarrune donnoit de plus grands fecours : dans une
~,dill¡ibution
/i fage , leur bU[ étoit de fauver les
"grands crimes al1X pauvres ,
&
de faciliter aux ri:
ti
ches l'acqui/ition des vertus. Pel1 contens d'avoir
>,
erabli des
lois
/i utiles , ils étoient d'une extreme
" attention
a
les faire obferver : dans cet efprit , ils
t,
avoient dií!:ribué la
ville
en Cjl1artiers , &
la
cam–
"pagne en canrons différens. Tout fe paífoit ainli
" comme fous leurs yeux. Rien ne leur échappoit des
" conduites particulieres, Ceux qui s'écartoiem de la
;, regle étoient cités devant les magiíl:rats, qui aflor–
" tiífoient les avis ou les peines
a
la
qualité des fautes
t,
dont les coupables éroient convaincus. Les memes
" anlopagil'es
engageoient les riches
a
laulager les patl–
" vres ; ils repnmoient l'intempérance de la jeuneífe
~,
par une difcipline aufiere. L'avarice des'magií!:rats
" efITayee par des lupplices tolljours prets
a
la punir,
~,
n'ofoit paroltre;
&
les vieillards
a
la vue des em–
»
pluis & des refpeéts des jeunes gens, fe tiroient ,le
~
la lethargie, dans laquelle ce grand age a cOlltÍlme
" de les plonger ... Auffi ces juges
f¡
refpeétables n 'a–
voient-ils en Vlle que de rendre leurs citoyens meil–
leurs,& la république plus f1oriífante. lis étoient fide–
fll1téreífés, qu'ils ne recevoient rien, ou prefque rien,
pour leur droit de
pré~
nce aux jugemens qu'ils pro–
nOJ1(ioient;
&
fi integres , qu'ils rendoient compte de
l'
exercice de lem pouvoir
a
des cenfél1rs publics ,ql1i
placés entre el1X & le peuple , empechoient que l'a–
l"iíl:ocratie ne devint trop pl1iífante. Quelclue courbés
qu'ils fu/fent fous
le
poids des années, ils fe ren–
doient ltu la colline
011
fe tenoient leurs aífemblées ,
'Cxpolés
a
l'ilijure de l'air. Leurs décifions étoient
marquées au coin de
la
plus exaéte j1lí1:ice : le.s plus
Íl1télelfantes par
leur
objet , lont celles qu'ils ren–
<lirent en faveur de Mars, d'Orefiequi y fut ab[ous
du meurtre de fa mere par la proteétion de Minerve
~ui
le fauva , ajolltant Con [uffrage
a
ceux qui lui
etoient favorables,
&
qui fe trouvoient en parfaite
égalité avec les fufITages qui le condamnoient. Cé–
-phale pour le meurtre de fa femme Procris,
&
Dedale
pour avoir aífaffiné le Iils de fa freur , hlrent condam–
nés par ce tribunal. Quelques anciens auteurs pré–
tendent queS.Denys premier évequed'Athenes avoit
été
aréopagite,
&
qu'iJ fut converti parla prédication
que fit
~.
Paul devant ces juges. Un plus grand nom–
bre ont confondu ce Denysl'
aréopagite
avec S.Denys
premier éveque de París.
Voye{
dans le Recueil de
i'
Acad. des BeLles-Leures, tomo VII.
deux excellens
mémoires fur
l'aréopage
"par M. J'abbé de Canaye,
qui fait aUier
a
un degré fort rare l'efprit & la
Philof~phie
a
l'érudition. (
G)
.
AREOSTYLE , f. m. dans l'
ancienne A rchiteélure ,
c'eí!:· une des cinq fortes d'intercolonnations, dans
laquelle les colonnes étoient placées
a
la
dií!:ance de
hlllt, ou comme difent ql1elques-uns, de dix modules
l'un de l'autre.
V.
INTERcoLONNATION. Ce mot
vient d'
';Fa.I~{
,
rare,
&
, Ú"O{,
colonne;
parce qu'il n'y
avoit point d'ordre d'architeéture Otl les colonnes
furrent auffi éloignées les unes des alltres que dans
A'areopyle.
'
'On fait principalement l1fage de
l'aréojlyle
dans
l'ordre Tokan
~
aux portes des grandes villes & des
fortere.lfes.
Voye{
TOSCAN,
&c. Vitmve. (P)
A.RE<?TECTONIQUE, adj. efi cette partie de
foruficatLOn
&
d'ar~hi[~a-ure
militaire , qllÍ , on–
,
Tom,/~
A R
E
63
~
c~rne
\'art d'attaquer & de combattTe.
(Q)
AREOTIQUES,
( en Medecine.
)
fe dit de ces re;"
medes qui tel1dent
a
óuvrir les pores de la peait ,
a
les rendre aífcz dilatés , pour quc
les
matieres mor–
bifiqucs puilfent @tre pouífées dehors par le moyen
de la fueur ou de l'infenfible tranfpiration.
Voye{
PORE ,SUEUR, TRANSPIRATION ,
&c.
Les diapho–
rétiques, les fudorifiques ,
&c.
appartiennent
a
la
claífe des
a~ 'ot¡'llles.
Voye{
DIAPHORÉTIQUES ,Su–
DORIFIQU·S,
&c.
(N)
.. ARÉTOPOTES ,
(Hifl.
anc.
)
ou le grand bÚ–
veur de vin ; nom fous leque! on honoroit
a
Muru–
chia , comme un homme doiié de vertus hérolques.
celui qlli favoit bien boire.
• ARÉQUE,
areca,
fiY~
/alifel.
(Hifl.
nato boto
)
c'oí!: le (¡'uit d'une e[pece de palmier qui crolt aux
Indes orientales. Il eí!: ovalaire , & reflemble alfez
Á
ladatre; il efi feulemént plus ferré par les deux bouts.
Son écorce eí!: épaiífe, liífc
&
membraneu[e ;
&
(a
pulpe d'uó brt1l1 rougelltre. Elle devient en fechant
fibteufe & jaunatre. La mocHe, ou pllltbt le noyan
qu'elle environne,eí!:
blanch~tre,
en forme de poire,
&
de la groífeltr d'l1l1e mufcade. Les Indiens le ma–
chent continuellement ; qu'il f<iit dur ou qu'il foit
mou , il n'importe : ils le melent avec le lycyon
Olt
le kaath , la feuille de betel·, & un peu de chaux. I1s
avalent leur falive teinte par ces ingrédiens , & re–
jettent le reíte.
Geoff.
&
diél. de medo
• ARÉQUIPE, ouARIQUIPA ,
(GJog.)
villede
l'Amériql1e méridion. dans le Pérotl, {¡Ir une riviere,
dans un terrein fertile.
Long.
308.
Lat.
mérid.z6.40.
ARER, ou
chafor fur
fes
ancres. ( Marim.
)
fe dit
~
lorfque l'ancre étant mouillée dans un mallvaisfond
~
elle lache prife ,
&
fe tralne en labourant
le
fable.
Voye{
CHASSER.
(Z)
" ARES,
(Mytlz.)
nom que les Grecs donnoient
a
Mars.
II
fignifie
dommage
;
d'autres le dérivent dlt
Phénicien
arits
,
'lui veut dire
,fon,
terríb/~.
" ARESGOL , ancienne ville du róyallme d'AI–
ger, dont il ne reíle que les mines; elle étoit aupa–
ravant la capitale de la province & de tout le royau·
me de Tremecen, qui fait aujourd'hlli une llartie d(!
celui d'AIger.
" ARESIBO , (
Céog.
)
petite ville d'
Américp.le;
fur une riviere de meme nom;
a
tl'Ois lieucs de 1aint
Juan de Porto-Ricco , dans ]'ile de ce 110m, qui
dI:
une des grandes antilles.
ARESTE
,j'pina,
(
Hij!. nato
)
partie du corps de
la plllpart des poiífons; on enrend communément par
ce mot toutes les parties dures & piquantes , qlli fe
trouvent dans les poiífons : mais dans ce fens on doit
difiinguer plu/ieurs fortes d'
aréles;
car il y a des par'–
ties dures dans les poi/fons, qui fonr analogues au*:
os des ferpens, des oifeaux, & des quadrupedes ;
tels font les os de la tete des poiífons, leurs verte–
bres, & leurs cotes. La plupart ont de plus des pi–
quans dans les nageoires, dans la queue, & fm el'au–
tres parríes de leur corps.
1I
y a auffi dans la chair de
pllllieurs poiífons, des filets folides , pointus, plus
Oll mojns longs,
&
de différentes groífeurs , dont les
uns font fimples, & les autres fourchus. On ne peut
donner
a
ces parties que le nom
d'aréte. Voye{
POI5'–
SON.
(/)
A RE
S
T E,
( coup, des pierres.)
c'efi l'angle ou le
tranchant que font deux filrfaces drOlres ou combes
d'une pierre quelconque: lorfqlle lcs iurfaces conca–
ves d'une VOLIte compofée de plulieúrs portions de
berceaux, fe rencontrent en angle faillant, on l'ap–
pelle
voute d'ante. Lajigllre
4 .
Planche de la coupe des
pier,:es,
repréfente
u.neportion de berceaux qui
(e
crol(ent
a
angle drolt.
(D) .
*
Lorfque I'angle d'une pierte efi bien taillé ,
&
(ans aucune cafll.lre, on dit cju'elle efi
a vive-aréte.
Sur
la
me[me
des
youtus d'aréte, voye{
VOUTE,
Llll ij
















