
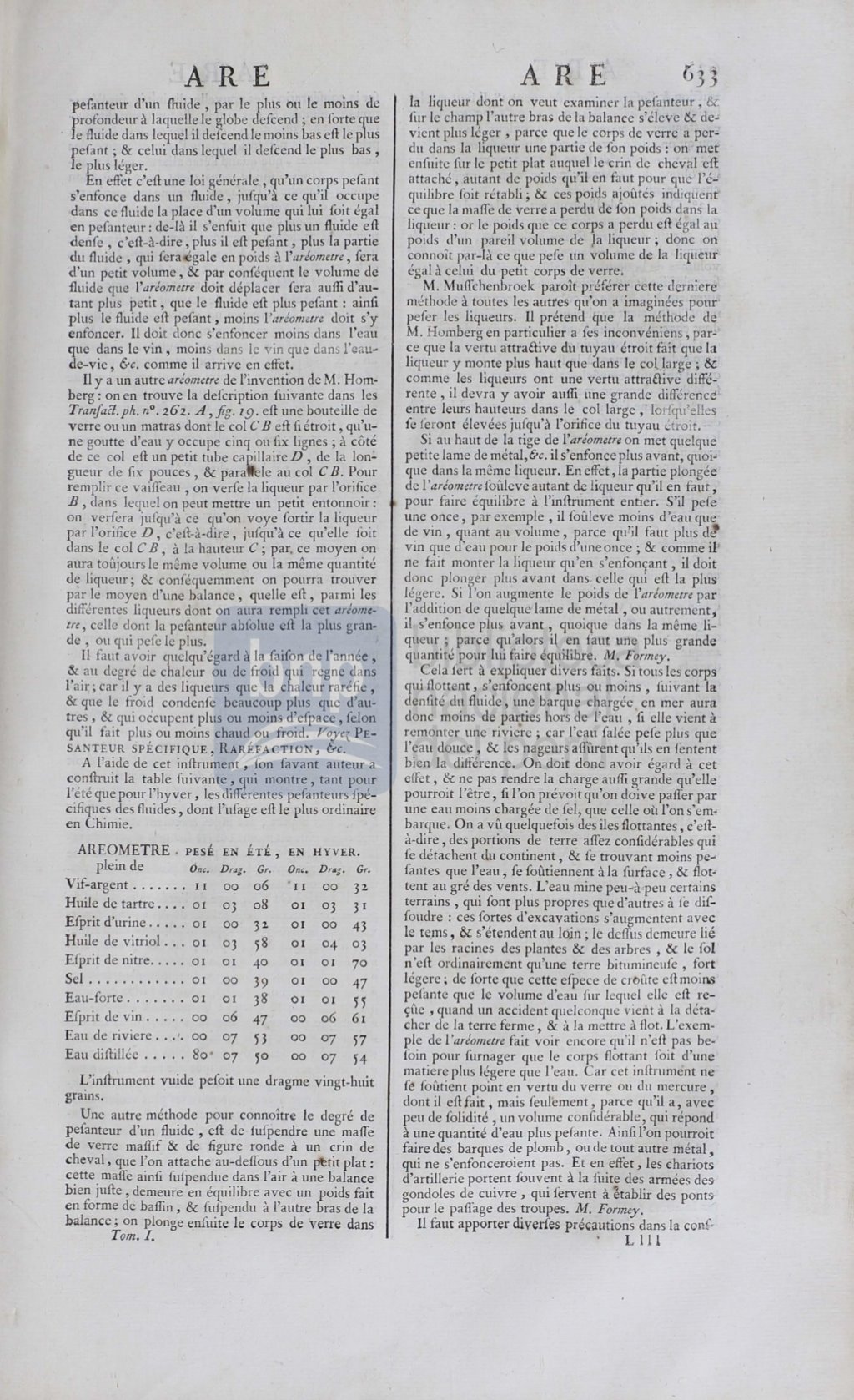
ARE
pefanteur d'un f1uide , par le plus
0\1
le moins de
profondeur a laquelle le
~Iobe
defcend ; en li:>rte que
. le fluide dans lequel il delcend le moins bas
dI:
le plus
pe(ant ;
&
celui dans lequel il de(cend le plus bas,
le
plus léger.
En effer c'ell:une loi générale, qu'un corps pe(¡mt
s'enfonce dans un fluide, ju(qu'a ce qu'il occupe
dans ce fluidc la place d'un volume qui lui (oit égal
en pe(anteur: de-la il s'en(uir que plus un fluide efl:
den(e , c'efl:-a-dire, plus il efl: pe(ant, plus la partie
du fluide , qui (era 'gale en poids a l'
aréometre,
(era
d'un petir volume ,
&
par con(équcnt le volume de
fluide que
l'adomure
doit déplacer (era au/Ii d'au–
tant plus petit, que le fluide efl: plus pe(ant : ainíi
plus le fluide eíl: pe(ant , moins
l'aréormtre
doit s'y
enfoncer. 11 doit done s'enfoncer moins dahs l'cau
que dans le vin, moins dans le vin que dans
l'eau~
de-vie,
&c.
comme il an'ive en effet.
11 y a un autre
aréometre
de l'invention de M. Hom–
berg: on en trouve la de(cription fuivante dans les
TrarzfaCl.ph.
nO.
262.
A
,jig.
19.
efl: une bouteille de
vcrre ou un matras dont le col
e
B
efl: íi étroit, qu'u–
ne goutte d'eau
y
occupe cinq ou flX lignes ; a coté
de ce col ell: un petit tube capillaire
D
,
de la Ion·
gueur de íix pouces,
&
parattele au col
e
B.
Pour
remplir ce vaiífeall , on ver{e la liqueur par I'orifice
B
,
dans lequcl on peut mettre un petit entonnoir:
on venera julclu'a ce qu'on voye (orUr la liqueur
par I'orifice
D,
c'eíl:-a-dire, ju{qu'a ce qu'elle loit
dans le col
e
B,
a la haute!!r
e;
par. ce moyen on
aura toí'ljours le meme volume ou la meme quantité
de liquem;
&
con{équemment on pourra rrouver
par le moyen d'une balance, quelle ell:, parmi les
di/férentes liqueurs dont on aura remph cer
adome–
tre,
celle dont la pefanteur ablolue eíl: la plus gran–
de, ou qui pefe le plus.
II faur avoir c¡uelqu'égard
a
la fai{on de I'année ,
&
au elcgré de chaleur ou de froiel qui regne dans
l'air; car il
y
a eles liqueurs que la chaleur raréfie ,
&
que le froid conden(e beaucoup plus que d'au–
tres,
&
qui occupent plus ou moins d'efpace , felon
qu'il fait plus ou moins chaud ou froid.
Voye{
PE–
SANTEUR SPÉC1FIQUE, RARÉFACTION,
&c.
A I'aide de cet inll:rument, (on (avanr auteur a
confl:ruit la table fllivante, (IUi montre, tant pour
l'.été que pour l'hyver , les di/ferentes pefanteurs fpé–
clfiques des fluides , dont l'ufage eíl: le plus ordinaire
en Chimie.
AREOMETRE . PESÉ
EN ÉTÉ, EN
HYVER.
plein de
Onc.
Drag. Gr.
One. DrtJg.
Gr.
Vif-argent .......
II
00 06
II
00
J2.
Huile de tartre ....
01 03 08
01 03
3
I
E(prit d'urine . . . . .
01 00
3
2
01 00 43
Huile de virriol ...
01 03 58
01 04 03
Efprit de nitre.....
01 01 4 0
0 1
01
7
0
Se! .... ... .....
01 00 39
01 00 47
Eau-fortc .... ...
01 01
3
8
01 01 55
Efprit de vin . . ...
00 06 47
00 06 61
Ean de riviere ... '.
00 07
53
00 07 57
Eau difl:illée .... .
80 07 50
00
07
54
~'infuument
vuide pefoit une dragme vingt-huit
grall1s.
Une autre méthode pour connoltre le degré ele
pefanteur d'un fluide, eíl: de {uípendre une ma{[e
de verre mafTif
&
de figure ronde
a
un crin de
cheval, que l'on attache au-defious d'un
~tir
piar:
c~tte.
mafi"e ainu fulpendue dans I'air a une balance
bien Jufl:e , demeure en équilibre avec un poids fait
en forme de baffin,
&
{ufpendu
II
l'autre bras de la
balance; on plonge enfuite le corps de verre dans
Tom.
J.
ARE:
la liqueur elont on vcut examiner la pefanteur,
&
{nr le champ I'autre bras de la balance s'éleve
&
de–
vient plus léger , parce que le corps de verre a per–
du dans la liqueur une partie de fon poids : on met
en{uite fur le petit piar auquelle crin de cheval
cíl:
attaché , autant de poitls <¡u'il en faut pOUT que l'é–
quilibre (oit rétabli ;
&
ces poids ajoí'ltés indiquent
ce que la ma{[e ele verre a perdll de fon poids dans la
liqlleur:
01'
le poiels qlle ce corps a perdu ell: égal au
poids el'un pareil volume de Ja li'lueur; done on
connolt par-la ce 'lue pefe un volume de la liqueur
égal
a
celui du peot corps de verre.
M. Mu{[chenbroek parolt préf¿rer cette derniere
méthode
a
toutes les atltres qu'on a imaginées ponr'
pe(er les liqueurs. 11 prétend que la méthodc de
M. Homberg en particulier a fes inconvéniens, par–
ee que la vertu attraétive du tuyau étroit fait que la
liqueur y monte plus haut que dans le collarge ;
&
comme les liqlleurs on! une vertu attraélive di/fé–
rente, il devra y avoir aufTi une grande diIFúence
entre leurs hauteurs dans le col large, lor{(!u'elles
fe leront élevées jufqu'a l'orifice du Ulyau étroit.
Si au hauc de la rige de
I'aréometre
on met c¡uelqlle
petite lame de métal,&c. il s'enfonce plus avant, quoí.
que dans la meme liqueur. En effet, la partie plongée
de
I'aréometreíoí'tleve
autant
de
liqueur qu'il en faur,
pOllr faire équilibre
a
l'iníl:mment enrier. S'il pefe
une once, par exemple , iI foí'tleve moins d'eau qlle
de vin , quant
1\U
volumc, paree qu'il fauc plus d!
vin que d'eau pour le poids d'une once;
&
comme il
ne fait monter la liqueur qu'en s'enfonr;ant, il doit
done plonger plus avant dans. celle 'lui eíl: la plus
légere. Si I'on augmente le poids de
I'aréometre
par
l'addition de quel'luc lame de métal , ou aurrement
1
il s'enfonce plus avant, qnoique dans la meme li–
queur ; paree qu'alors
i~
en filUt une plus grande
quantité pour lui faite éc¡ui/.i.bre.
M.
Formey.
Cela fert
a
expliquer divers faits. Si tous les corps
qui flott nt, s'enfoncent plus ou moins , fuivant la
deníiré dll f1l1ide, une barque chargée en mer aura
done moins de parries hors de l'eau , fi elle vient
a
remonter une riviere ; car I'eau falée pefe plus que
l'eau douce ,
&
les nageurs a{[í'trent qu'ils en {entent
bien la diIFérence. On doit done avoir égard a cet
effet,
&
ne pas rendre la charge aufTi O'rande qtl'elle
pourroit l'ett'e, íi l'on prévoitqu'on
el~ive
paífer par
une eau moins chargée de fe!, que celle
011
I'on s'em–
barqueo On a vu quelqtlefois des ¡les flottantes c'efl:–
a-dire , des portions de terre a{[ez coníidérabies 'luí
fe détachent du contÍnent,
&
fe trouvant moins peJ
fantes que l'eau , (e foutiennent
a
la furface,
&
flot–
tent au gré des vents. L'eau mine peuJa-peu cerrains
terrains , qui font plus propres que d'autres
a{e
di(–
foudre: ces fortes el'excavations s'augmentenr avec
le
te.ms,
&
s'étendent au lo,in ;
le
deífus demeure lié
par les racines des plantes
&
des arbres ,
&
le fol
n'eíl: ordinairement qu'une terre bitumineufe , fort
légere; de (orte que cette efpece de croíhe efl:moins
pefante que le volume d'eau (ur lequel elle ell: re–
<tlte , quand un accident quelconqtle vient a la eléta–
cher de la terre ferme,
&
a la mettre
a
flor. L'exem–
pie de
I'aréometre
fait voir encore qu'il n'ell: pas be–
[oin pour furnager que le corp5 flottant (oit d'une
matiere plus légere que I'eall. Cal' cet inll:rument ne
fe fourient point en vertu du verre ou elu mercure,
dont
iI
ell: [ait , mais feulement, paree qu'il a, avec
peu de folidité, un volume confidérable, qui répond
a
une qtlantité d'eau plus pelante. Ainíi I'on pourroit
faire des barc¡ues de plomb, ou de tout autre métal,
qtli ne s'enfonceroient pas. Et en e/ret,
les
chariots
d'artillel-ie portent (ouvent
a
la lilÍte des armées de9
gondoles de cuivre , qui fervent
a
~tablir
des pont9
pour le pafiage des troupes.
M.
Formey.
11 faut apporter diverfes précautions dans la conf.
.
L 111
















