
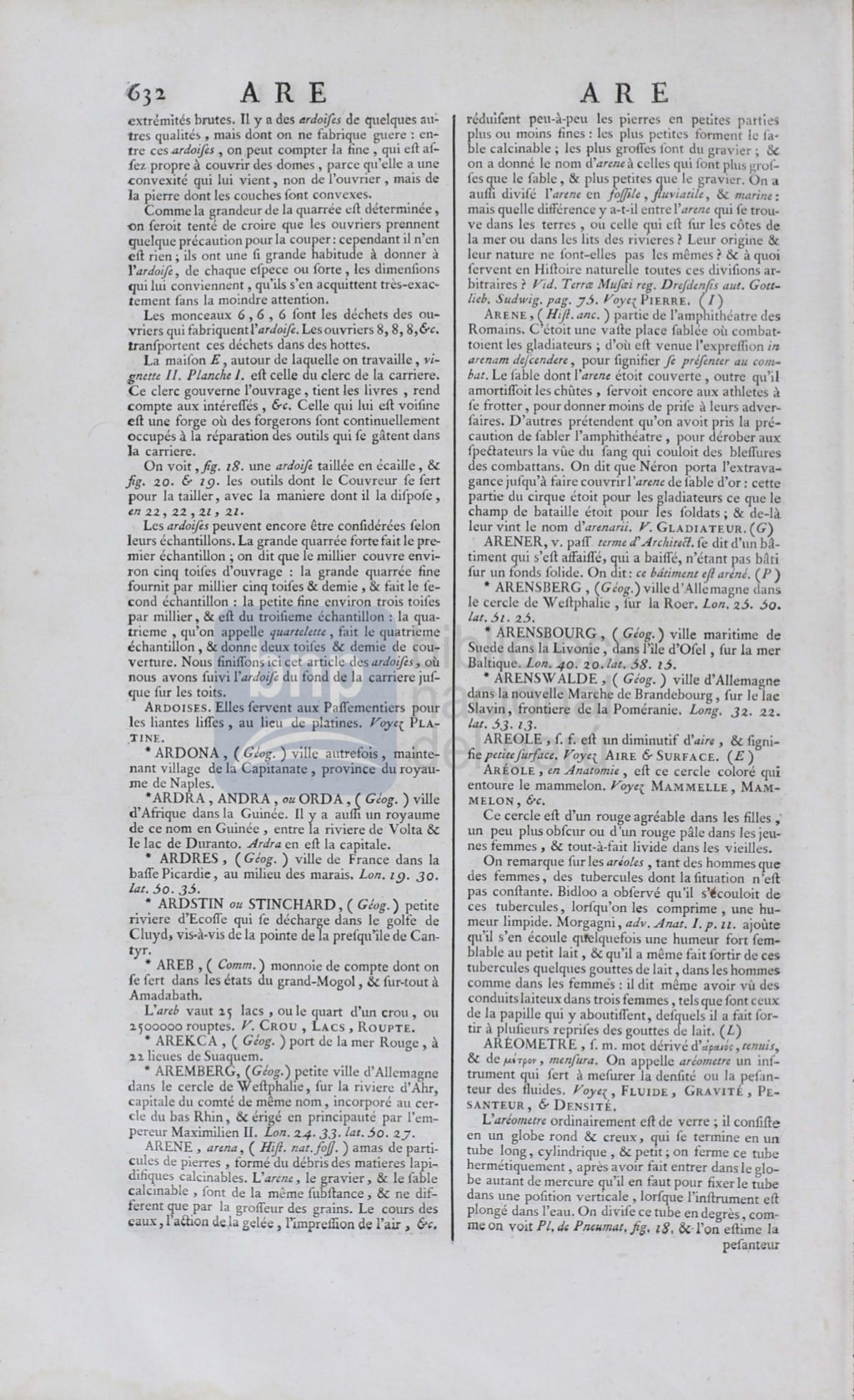
ARE
extn!mltés brutes. Il
y
n des
ardoifls
de quelq1.les
;;1.l~
tJ:es
qualité~
, mais dont on ne fabrique guere : en–
tre ces
.artÚJifes
,
on peut compter la fine , qUl eíl: af–
fez propre
a
couvrir des domes, parce
9
u'elle
<1;
tme
~onvexité
qui lui vient, non de l'ouvner,
m31S
de
la pierre dont les couches font convexes.
Comme la grandeur de la quarrée
eíI:.
déterminée ,
~n
feroit tenté de croue que les ouvners prennent
quelque précaurion pour la couper: cependant il n'en
eíl rien ; ils ont une fi grande habltllde a .donner
a
l'ardoifl,
de chaque
efp~.ce
?u forre? les dll1;enúons
qui luí conviennent , qu
ils
s en acqmttent tres-exac–
tement fans la moindre attenrion.
Les monceaux 6, 6 , 6 font les déchets des ou–
vriers qui
fabriquentl'ardoifl.
Lesouvriers 8, 8,
8,&c.
tranfporrent ces déchets dans des hottes.
.
.
La maifon
E,
autour de laquelle on travaille ,
VI–
gnetú
IJ.
Planche
1.
eíl celle du elerc de la carriere.
Ce clerc gouverne I'ouvrage , tient les livres , rend
compte aux intéreíl'és ,
&c.
Celle e¡ui lui efi voifine
eíl: une forge Ol! des forgerons font continuellement
occupés
a
la répararion des outils qui fe gatent dans
la camere.
On voit
,jig. l8.
une
ardoifl
tailJée en écaille,
&
fig.
20.
&
19'
les outils dont le Couvreur fe fert
pour la tailler, avec la maniere dont il la difpofe ,
en
22,22,
2l, .2.l.
Les
ardoifls
peuvent encore etre confidérées felon
leurs échanrillons. La grande e¡uarrée forte fait le pre–
mler échanrillon ; on dit que le milJier couvre envi–
ron cine¡ toifes d'ouvrage : la grande quarrée fine
foumit par millier cinq roifes
&
demie ,
&
fait le fe–
cond échantillon : la petite fine envuon trois roifes
par millier,
&
efr du troiíieme échantillon : la qua–
trieme , qu'on appelle
qllarteleue,
fait le quatrieme
échantillon,
&
donne deux tOlles
&
demie de cou–
vernue. Nous /iniíTons ici cet article des
ardoifls,
Ol!
nous avons fuivi
l'ardoifl
du fond de la carriere juf–
que fur les toits.
ARDOISES. Elles fervent aux Palfemenriers pour
les liantes liífes, au lieu de platines.
Voye{
PLA–
.:fINE.
" ARDONA,
(Géog.
)
ville autrefois, majnte–
nant village de la Capitanate, province du royau–
me de Naples.
"ARDRA, ANDRA ,
011
ORDA, (
Géog.
)
ville
d'Afrique dans la Guinée. Il y a auffi un royaume
de ce nom en Gllinée, entre la riviere de Volta
&
le lac de Duranto.
Ardra
en efr la capitale.
.. ARDRES,
(Géog.
)
ville de France dans la
baíl'e Picardie, au milieu des marais.
Lon.
19. 30.
lato
.)0.
3.).
.. ARDSTIN
ou
STlNCHARD, (
Géog. )
perite
riviere d'Ecoífe qui fe décharge dans le golfe de
Cluyd, vis-a-vis de la pointe de la prefqu'ile de Can–
tyr.
.. AREB , (
Comm. )
monnoie de compte dont on
fe fert dans les états du grand-Mogol,
&
fur-tout a
Amadabath.
L'areb
vaut
25
lacs, ou le quart d'tm cron, ou
2500000
rouptes.
V.
CROU , LACS, ROUPTE.
.. AREKCA , (
Géog.
)
port de la mer Rouge, a
22
lieues de Suaquem.
.. AREMBERG,
(Géog.)
petite ville d'AlJemagne
dans le cercle de \Veíl:phalie , fur la riviere d'Ahr,
capitale du comté de meme nom, incorporé au cer–
cle du bas Rrun ,
&
érigé en principauté par l'em–
pereur Ma..rimilien ll.
Lon. .2.4-
33.
lato
.)0.
2J.
ARENE,
arena,
(
Hifl. nal.foJl.
)
amas de parti–
cules de pierres , formé du débrisdes matieres lapi–
difiques calcinables. L'
arene,
le gravier,
&
le fable
calcinable, font de la meme fubílance,
&
ne dif–
ferent que .par la groífeur des grains. Le coms des
eaux , l'ailion d la gelée , l'i¡npreffion de l'air ,
frc.
ARE
réduifent peu-a-peu les pierres en petires patti.:s
plus ou moins fines: les plus petites fonnent le fa–
ble calcinable; les plus groíl'es fom du gravier;
&
on a donné le nom
d'armea
c \les qui font
plu~
gro!:"
fes g:ue le fable,
&
plus petites que le gravlcr. On a
a
UiJl
divifé l'
arme
en
fojJiü, fluviatile,
&
f1UIrine:
majs quelle dl/férence y a-t-il entre l'
arme
qui fe trou–
ve dans les terres , ou celle qui eíl fm les cotes de
la mer ou dans les lirs des rivieres? Leur origine
&
leur narure ne font-elles pas les memes
?
&
a quoi
fervem en Hifroue natmelle toutes ces diviúons ar–
bitraires?
Vid. Teme Mllfai reg.
Drefdm~s
auto Gott–
lieb. Sudwig. pago J.). Voye{
PIERRE.
1)
ARENE,
(Hifl. anc.
)
parrie de l'amp lithéatre des
Romains. C'éroit une valle place fablée Oll combat–
tOlenr les gladiatems ; d'oll eíl venue l'exprcffion
i/~
armam deJCenden ,
pour íignifier
fl
prlfincer all
COIII–
halo
Le fable dont
I'arene
étoit couverte, outre qu'il
amorti1roit les chCltes, fervoit encore aux athletes
a
fe frotter , pour donner moins de prife a lems adver–
faires. D 'autres prétendent qu'on avoit pris la pré–
caution de fabler l'ampruthéatre, pour dérober aux
fpeél:ateurs la vue du fang e¡ui couloit des bleíl'ures
des combattans. On dit que Néron porta l'extrava–
ganee jufe¡u'a faire couvrirI
'arene
de lable d'or: cetre
parrie du eirque étoit pour les gladiateurs ce que le
champ de bataille étoit pour les foldats;
&
de-la
leurvint le nom
d'arenarii.
V.
GLADIATEUR.(G)
ARENER, v. paíl'
mme
d'
Arcltitea.
fe dit d'un
ba–
timent qui s'eíl: affaiíl'é, qui a baiífé, n'étanr pas bAti
fur un fonds folide. On dit:
ce bátimenc
ejl
aréné.
(P)
.. AREN BERG, (Géog.)villed'f¡Jlemagne dans
le cercle de \Veíl:phalie , fur la Roer.
Lon.
.2..).
.)0.
lat.')I.
2.5.
*
ARENSBOURG, (
Géog.
)
ville maritime de
Suede dans la Livonie, dans l'iIe d'Ofel , fm la mer
Baltique.
Lon.
40.
20. 1at.
,)8.
Z.).
" ARENSWALDE, (
Géog.
)
ville d'Allemagne
dans la nouvelle Marche de Brandebomg, fur le lac
Slavin, frontiere de la Poméranie.
Long.
32.
.2.2.
lato
.)3. Z3.
AREOLE,
f.
f. eíl: un diminutif
d'aire,
&
figni–
fiepetiteforfoce. Voye{
AIRE
&
SURFACE.
(E)
ARÉOLE,
en
Anatomie,
efr ce cercle coloré <¡ui
entoure le mammelon.
Voye{
MAMMELLE, MAM–
MELON,
&oc.
Ce cercle eíl: d'un rouge agréable dans les filIes;
un peu phlS obfcur ou d 'un rouge pale dans
les
jeu–
nes femmes ,
&
tout-a-fait livide dans les vieilles.
On remarque fur les
ar¡o!es
,
tant des hommes que
des femmes, des tubercules dont la íituation n 'eíl
pas con/l:ante. Bidloo a obfervé qu'il s'écouloir de
ces tubercules, lorfqu'on les comprime, une hu–
mellT limpide. Morgagni ,
adv. Anat.
/ .
p.
ll.
ajoute
qu'i! s'en écoule <¡tfelquefois une humem fort fem–
blable au petit lait ,
&
qu'il a meme falr fortir de ces
nlbercules quelques goutres de lair , dans les hornmes
comme dans les femmes : il dit meme avoir vfl des
conduirs laireux dans trois femmes , tels que font ceux
de la papille quí y aboutiífent, defquels il a fait for–
tir
a plufieurs reprifes des gouttes de lait.
(L)
ARÉOMETRE, f. m. mor dérivé d'
dp"';~,
tenuls,
&
de
",íTpOY, mm/ura.
On appelle
aréometre
un lnf–
trument e¡ui fert a mefurer la denfité ou lalefan–
teur des fluides.
Yoye{,
FLuIDE, GRAVIT ,PE–
SANTEUR,
&
D ENSITÉ.
L'aréometre
ordinauement eíl: de verre ; il confú[e
en un globe rond
&
creux, c¡ui fe termine en un
tube long, cylindrique ,
&
peut; on ferme ce nlbe
hermétiquement, apres avoir fair entrer dans le glo–
be aurant de mercme qu'il en faut pour mer le tube
dans une pofition verticale , lorfque l'infirument ea
plongé
da.nsl'eau. On divlle ce nlbe en degres, com–
me on VOlt
PI.
tlf
Pneumat.
jig. l8.
&·1'on eilime la
pefantellr
















