
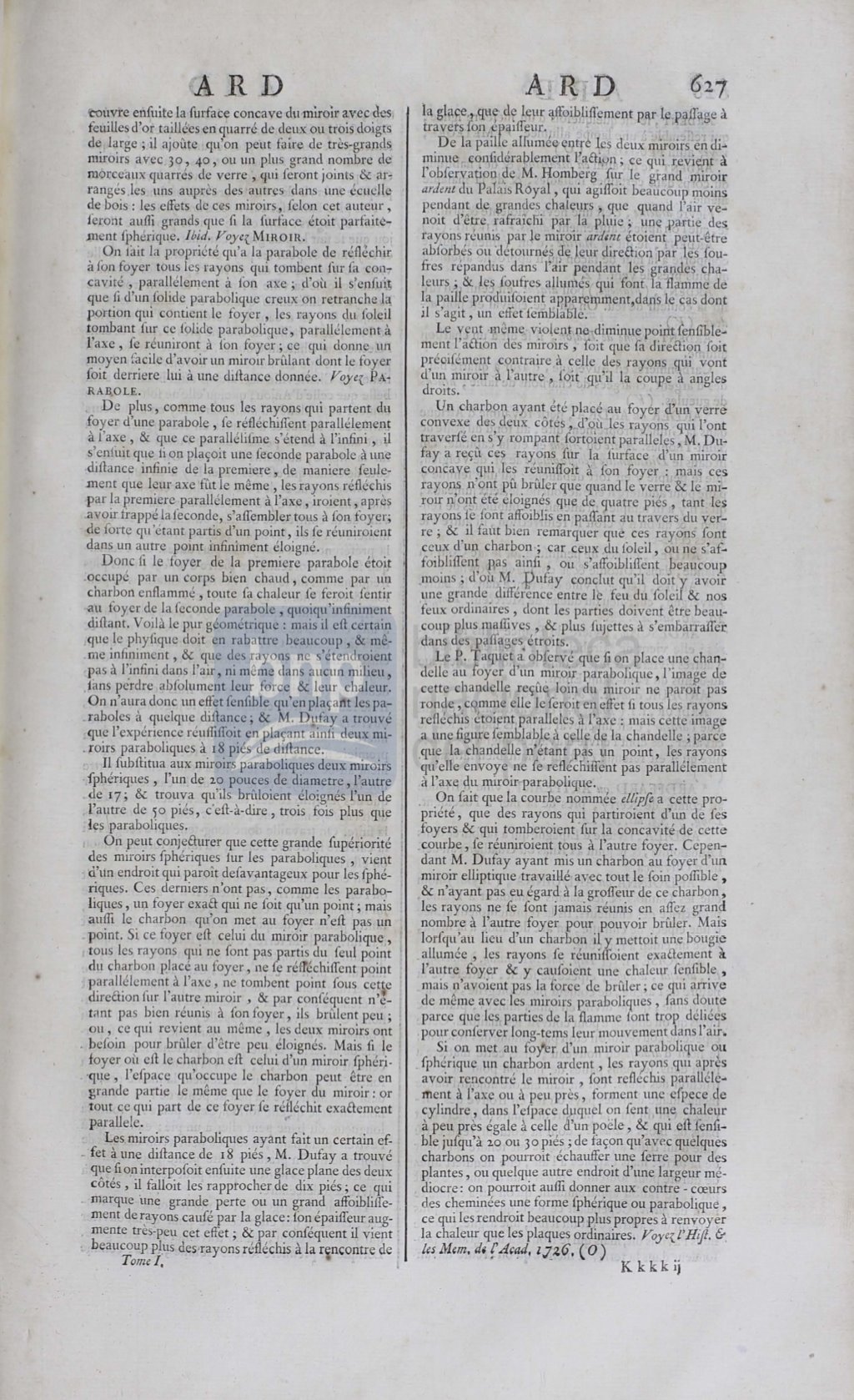
'Couvre enfuite la furface
conc~ve
d\! muolr avec
des,
feuiUes d'or taiUé'es en qnarré de deux ou trois doigts
de large; il ajoute qu'on peut faire de tres-grands
miroirs avec 30, 40, ou un plus grand nombre de
rno(ceaUX quarrés de verre , 'lui feront joints
&
ar–
rangés.1es uns aupres des aUlres dans une écuelle
de bois: les elfets de c€s miroirs, idon cet auteur,
leront auili grands clue fi la illrface étoit parfaite–
.ment {phéric¡ue.
¡bid. Voye{
MIROIR,
On tilit la propriété qu'a la parabole de réflckhir
a
fon foyer tous les rayons qui tombent fur fa con–
cavité , parallélement
a
ion axe; d'olt il
s'enfu~t
que fi d'un folide parabolique creux on retranche la
portion qui contíent le foyer, les rayons du foleil
tombant fur ce 10lide parabolique, patallélement
a
l'axe, {e réuniront
a
Ion foyer; ce 'lui donne un
moyen facile d'avoir un miroir brulant dont le foyer
(oit deniere lui
a
une diHance donnée.
Voye'{
P
A7
RAB,OLE.
De plus, comme tous les rayons qui partent du
foyer d'une parabole , fe réfléchiffent parallélement
a
l'axe ,
&
que ce paralléli{me s'étend
a
I'infini,
il
s'enii.tit que
fi
on
pla~oit
une {econde parabole
a
une
diHance infinie de la premiere, de maniere {eule–
ment que leur axe nlt le meme , les rayons réfléchis
par la premiere parallélement
a
I'axe , iroient, apres
avoir ti'appé la feconde, s'alfembler tOllS
a
fon foyer;
de {orte c¡u 'étant partís d'un point, ils fe réuniroient
dans un autre point innniment éloigné,
Donc fi le foyer de la premiere parabole étoit
occupé par un corps bien chaud, comme par un
charbon enflammé , toute fa chaleur fe feroit fentir
<lU
foyer de la (econde parabole , quoiqu'intlniment
diftant. Voila le pur géoméüique: mais il eft certail)–
que le phylique doit en rabattre beaucoup,
&
me–
me infiniment ,
&
que des rayons ne s'étendroient
pas
a
I'infini dans I'air, ni meme dans aucun milieu, '
Úms perdre abfolument leur force
&
leur chaleur.
On n'aura donc un elfet fenfible qu'en plas:ant les pa–
raboles
a
quelc¡ue difiance;
&
M. Dpfay a rrouvé
que I'expérience réuiftifoit en plas:ant ainli deux mi–
, roirs paraboliques
a
18
piés de dillance.
Il
fubfiinta aux miroirs paraboliques deux miroirs
{phéri.ques , I'un de 2.0 pouces de diametre, I'autre
de
17;
&
trouva qu'ils brl1loient éloignés l'un de
l'autre de )0 piés, c'eft-a-dire, trois fois plus que
les paraboliques.
On peut conjefrurer que cette grande fupériorité
des miroirs {phériques 1ur les paraboliques , vien,t
d'tln endroit qui parolt de{avantageux pour les fphé–
riques. Ces derniers n 'ont pas, comme les parabo–
liques, un foyer exaél: quí ne foit 'lu'un point; maís
auffi le charbon qu'on met au foyer n'eft pas un
point, Si ce foyer eft celui clu miroir parabolique ,
tous les rayons quí ne font pas partís du feul point
du charbon placé au foyer, ne fe réfl'échiffent point
parallélement
a
l'axe, ne tomhent point fous
cet~e
clireél:ion {m I'autre miroir ,
&
par conféquent n'e–
t<lnt pas bien réunis
a
fon foyer, ils brlllent peu ;
ou, ce quí revient au meme , les deux miroirs ont '
. befoin pour bruler d'etre peu éloignés. Mais fi le
foyer oh efi le charbon efi celui cl'uI¡ miroir fphérj.
'que, l'efpace qu'occupe le charbon peut &tre en
grande partíe le meme que le foyer du míroir: or
tout ce qui part de ce foyer fe réfléchit exafremcnt
parallele.
•
Les miroirs paraboliques ayant fait un certain ef–
fet
a
une diftance de
18
piés, M, Dufay a trouvé
que
fi
on interpo{oit enfuite une glace plane des deux
cotés,
il
fa,lloit les rapprocherde dix piés; ce qui
marque 'une grande perte ou un grand affoibliHe–
ment de r,ayons caufé par la glace: ion,
épaiff~m ~ug
mente u'es-peu cet elfet ;
&
par confequent
il
Vlent
beaucoup plus des'rayons réfléchis
a
la ren,ontre de
Tome!,
•
¡
la
glaqellSIt17
d~
leur
~ffo.i~liífement p~r
le
~alfa,ge
a
travets Ion e¡'lali(euf,
De la paillc alIllmée eQtre les deux mÍroirs en di..
~inue c~Qfidéraplement
l:aél:i.¡.¡n ; ce 'luí
reví~t
,a
1
ob{ervatloo:~e
M. Homb,erg,
(u~
le grand ,l)1trOlr
ardent
du
'Pa1alS
Royal, qUl aglÍfoIt beaucoup moins
pendant
d~
grandes chalelJrs ,que quand l'air ve–
noit d'etre rafraí'cru par la pluie; une ,p;mie des
J'ayons réunis par le miroir
ardmt
étoient peut-étre
abforbés ou 'c1étomnés de ¡eur direfrion par les fou–
fres répandus dans l'air pendant les grandes cpa–
leur ;
&
!I¡!,S
foufres alh.¡més qui fonf la, fIamme de
la paille pród'lIifoient appa¡;erpment.dans le cas dont
jI s'agit, un elfet lemblab1e. '
,
Le ve!?t ·meme violen} ne--diminue poid! fenGble–
ment l'afrión des miroirs
v
,
Toit que {¡l direétion foit
P!'éoi[,'~e~l! co~tra\re
a,
c;elle
~es
l'ayoAs gui vont
d
ll~
mlJ'OIT
~
1alltre , Loa
q~lli
la coupe
a
angles
drOlts.
.
Un
charbon ayant eté placé aH foyer d'un verre
convexe d6S deux cotés ,_,d'oll.les I'ayoos quí l'ont
traveríe en s'y rompant
forto~ent
paralleles, M. Du–
fay a
re~tL
ces rayons fuI' la ji.lrface d'un miroir
concave qui les réuniffoit
a
ron foyer : mais ces
rayoQs l1'ont pll bruler que quand le verre
&
le mi–
rotr
J~oni
été éloignés que de quatre piés , tant les
rayons
1(:
font alfoiblis en paffant au travers du ver–
re ;
&
il [am bien remarqller que ces rayons font
ceux d'un charbon,; car ceux duloleil, ou ne s'af–
foibliffent Has ainfi , ou s'alfoibliffent be¡lUcoup
.moins; c1'olJ M, ':¡;>ufay conclut qu'il doit y avoie
une grande dilférence entre le feu du foleil
&
nos
feux ordinaires, dont les parties doivent @tre beau–
COllp plus mailives ,
&
plus fujettes
a
s'embarra!Ter
dans des PílÍlages étroits.
Le P. Tacluet
i..
obfervé que fi on place une chan–
delle au foyer d'un miroi¡ parabolique, I'image de
cette chandelle
reS:('J~
loin c1u miroir ne parolt pas
Tonde, cqmme elle le (eroit en eltet fi tous les rayons
refléchis
étoi~nt
paralleles
a
l:axe : mais cette image
a une figu¡;e femblable
a
celle de la chandelk ; parce
,que la chandeUe n'étant"as un point, les,rayons
qu'elle envoye ne (e reflecnilIent pas parallelement
¡ll'ax~
c\n miroir parabolique,
.
On fait que la combe nommée
ellipfo
a cette pro–
priété, que des rayons qui partiroient cl'tm de fes
foyers
&
qui tomberoient fur la concavité de cette
combe, fe réuniroient tous
a
I'autre foyer, Cepen–
dant M. Dufay ayant mis un charhon au foyer d'un
miroir ellipti'lue travaillé avec tout le {oin poffible ,
&
Il'ayant pas en égard
a
la groffettr de ce charbon,
les rayons ne fe font jamais réunís en ailcz grand
nombre
a
I'autre foyer pour pouvoir br('uer.
Ma.islor{qu'au lieu d'un charbon il y mettoit une botlgte
allumée , les rayons fe iéuniffoient exaél:ement
a.
l'autre foyer
&
y
cau{oient une chaleur
(enfib~e
,
mais n'avoiellt pas la force de brCuer; ce qui amve
de
m~me
avec les miroirs paraboliques, fans
~~IJte
paree que les parties de la fl,amme {ont trop
del:e,~s
pour con{erver long-tems lem mouvement
d~ns
I alr.
Si on met au foter d'un miroir parabolique Olt
(phéri'lue un charbon ardent, les ra10ns qui apres
avoÍr rencontré le miroir , font reflechis paraUélé–
ment a ¡'axe ou
a
peu pres, forment une efpece de
cylindre, dans l'e{pace d,J.Iquel on {ent une chalel)r
a
peu pres égale a celle d'un poete ,
&
qui eft fenfi–
ble ju{qu'a 2.0 ou 30 piés; de fas:on qu'ave.c quelques
charbons on pOlll"l'oit échaulfer une (en'e pour des
plantes, ou quelque autre endroit d'tme largeur me–
diocre: on pourroit auffi donner aux contre - cceurs
des cheminées une forme fphérique ou parabolique ,
ce qui les rendroit beaucoup plus propres
a
renvoyer
la chaleur que les plaques ordinaires.
Yoye'{
t'
Hij!,
&,
¡e~
Mem. di
r
A~f!d,
ll7.6. (O)
-
Kkkkij
















