
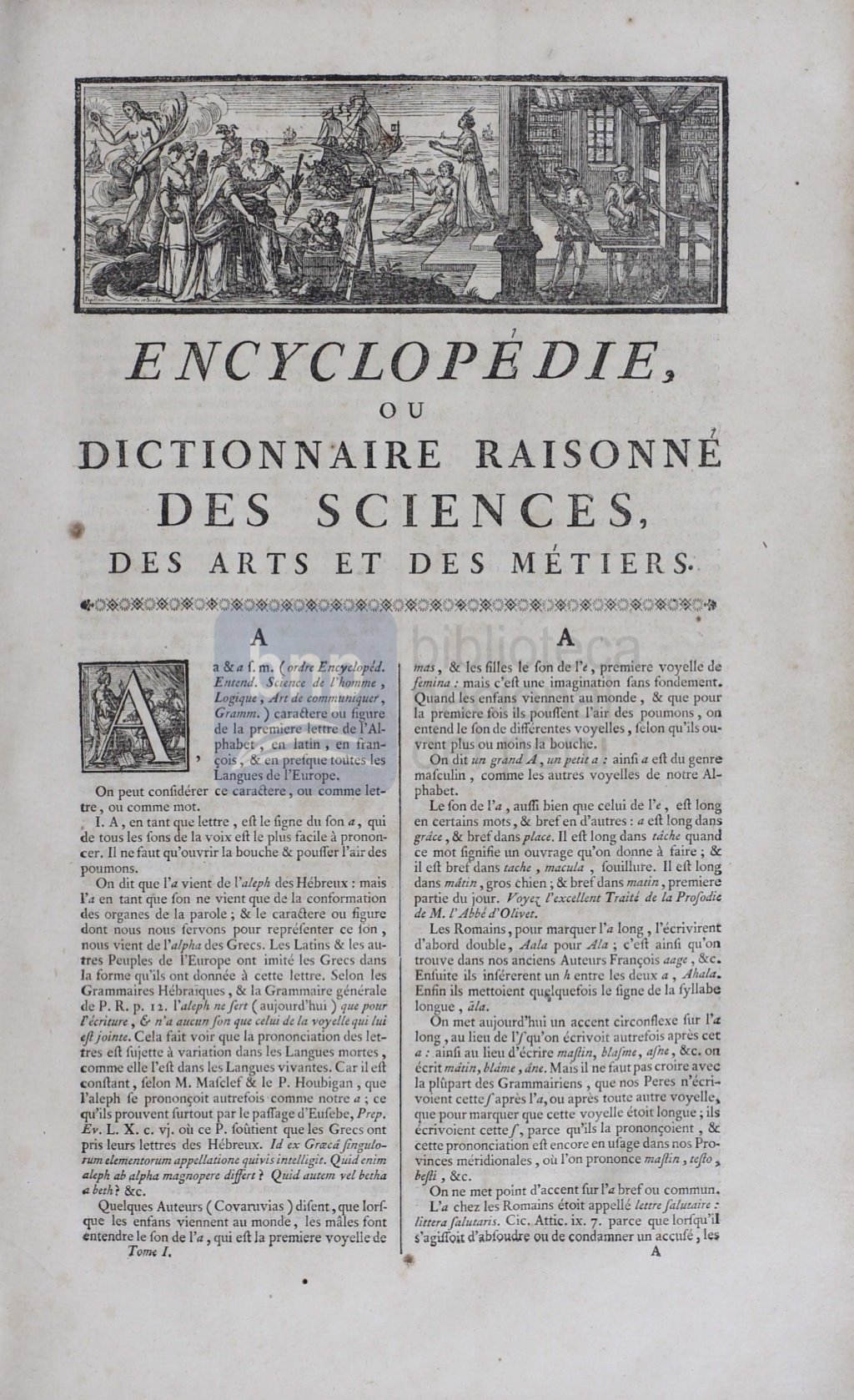
1
ENCYCLOPEDIE:J
ou
1
DICTIONNAIRE RAISONNE
,DES SCIENCES,
DES
AR TS
ET
A
a
&
a
f.
m.
(ordre EncyclopU.
ElUend. Science de l'!zomme,
Logique , Art de commutziquet,
Gramm.
)
caraaere ou figure
de la premiere lettre de l'
Al–
phabet, en latin, en fran-
, <;ois, & en prefqlle todtes les
Langues de l'Europe.
On peut coníidérer ce caraaere, OH comme let–
tre , ou comme mot.
1.
A, en tant que lettre ,
ea
le ligne du fon
a,
qui
de tous les fons de la voix ea le plus facile
a
pronon–
cero
11
ne faut qu'ouvrir la bouche & pouífer l'air des
poumons.
On dit que l'
a
vient de
l'aLep!z
des Hébreux : mais
l'
a
en tant que fon ne vient que de la conformation
des organes de la parole ; & le caraaere ou figure
dont nous nous fervons pour repréfenter ce fon ,
nous vient de l'
alp!za
des Grecs. Les Latins & les au–
tres Peuples de l'Enrope ont imité les Grecs dans
la forme qu'ils ont donnée
¡\
cette lettre. Selon les
Grammaires Hébralques , & la Grammaire générale
de P. R. p.
12.
l'alepA ne firt
( aujourd'hui )
que pour
l'é"iture ,
&
n'a aucun
Jon
que celui de la voyellequi lui
ejl
Jointe.
Cela faít voil' que la prononciation des let–
tres
ea
fujette
a
variatÍon dans les Langues mones ,
comme elle l'ea dans les Langues vivantes, Car il ea
conll:ant, {elon M. Mafclef & le P. Houbigan , que
l'aleph {e pronon<;oit autrefois 'comme nou'e
a
;
ce
qu'ils prouvent {urtout par le paífage d'Eu{ebe,
Prep.
Ev,
L.
X.
C.
vj. 01, ce
P.
{ol,tient que les Grecs ont
pris leurs lettres des Hébreux.
Id ex Grrecajingrtlo–
rum
elem~ntorum
appellatione quivis intelligit. Quidenim
aleph ab alpAa magnope,.e difftrt? Quid autem ve! becha
il
betA?
&c.
Quelqtles Auteurs ( Covamvias ) difent, que lorf.
que les enfans viennent au monde, les maJes font
entendre le fon de l'
a
,
qtIi eíl: la premiere voyelJe de
.Tom~
l.
I
D E S M E TI E
R S"
A
!nas,
& les filies te fon de l'¿, premiere voyeIle de
fimina:
mais
c'ea
une imagination fans fondement.
Quand les enfans viennent au monde, & qtle pour
la premiere fois ils pouífent l'ail' des poumons, on
entend le ron de différentes voyelles , {elon qu'ils Otl–
\Trent plus ou moins la bOtlche.
On dit
un grand A
,
un petit a
:
ainíi
a
efi du genre
mafculih, comme les autres voyelles de nOtre
Al~
phabet.
Le fon de l'a, auffi bien que celui de
l'e,
efi long
en celtains mots, & brefen d'autres :
a
efi long dans
grace
,
& brefdans
place.
11
eíl: long dans
tache
quand
ce mot figniñe un ouvrage qtl'on donne
a
faire; &
il
ea
bref dans
tache, macula,
fouiUute.
Il
efi long
dans
mtÍtitz,
gtos chien ; & brefdans
matin,
premiere
partie du jottr.
Voye{ l'excellent Traiti de la Profodi,
de
M.
l'AbM d'Olivet.
Les Romaiñs, pour marquer l'a long, I'écrivirent
d'abord double,
Aala
pour
Ala;
c'ea
ainíi qu'on
trouve dans nos anciens Auteurs Fran<;ois
aage,
&c.
En[uite ils inférerent un
h
entre les deux
a
,
AAaia.
Enfin ils mettoient
qu~lquefois
le figne de la {yllabe
longue ,
ála.
011
met alljourd'hui
un
accent circonflexe ftlf
I'a:
long, au lien de ljqu'on écrivoit autrefois aptes cet
a:
ainfi au lieu d'écril'e
majlin, blafme, afize
'.
&c. on
écritmdtin, bLdme, áne.
Mais
il
ne fautpas crOlfe avec
la plúpart des Grammairiens ,
que
nos Peres n'écri–
voient eette
f
apres
l'
a;ou apres toute alltre voyelle,
~ue
pour marquer que cette voyelle étoit
10~gl1e
; ils
ecrivoient cettef, parce qn'ils la pronon<;Olent ,
&
cette prononciation efi encore en ufage dans nos Pro–
vinces méridionales , ou l'on pl'ononce
majlin., tej!o ,
bej!i,
&c.
On ne met point d'accent
[ur
l'
a
brefou commun.
L'
a
chez les Romains étoit appelIé
turre
falutaire :
litterafalutaris.
Cic. Attic. ix. 7. paree qt,elorfqu'il
s'agiífoit d'abfoudre
OH
de cond¡¡mner un accu{é ,
le~
A
















