
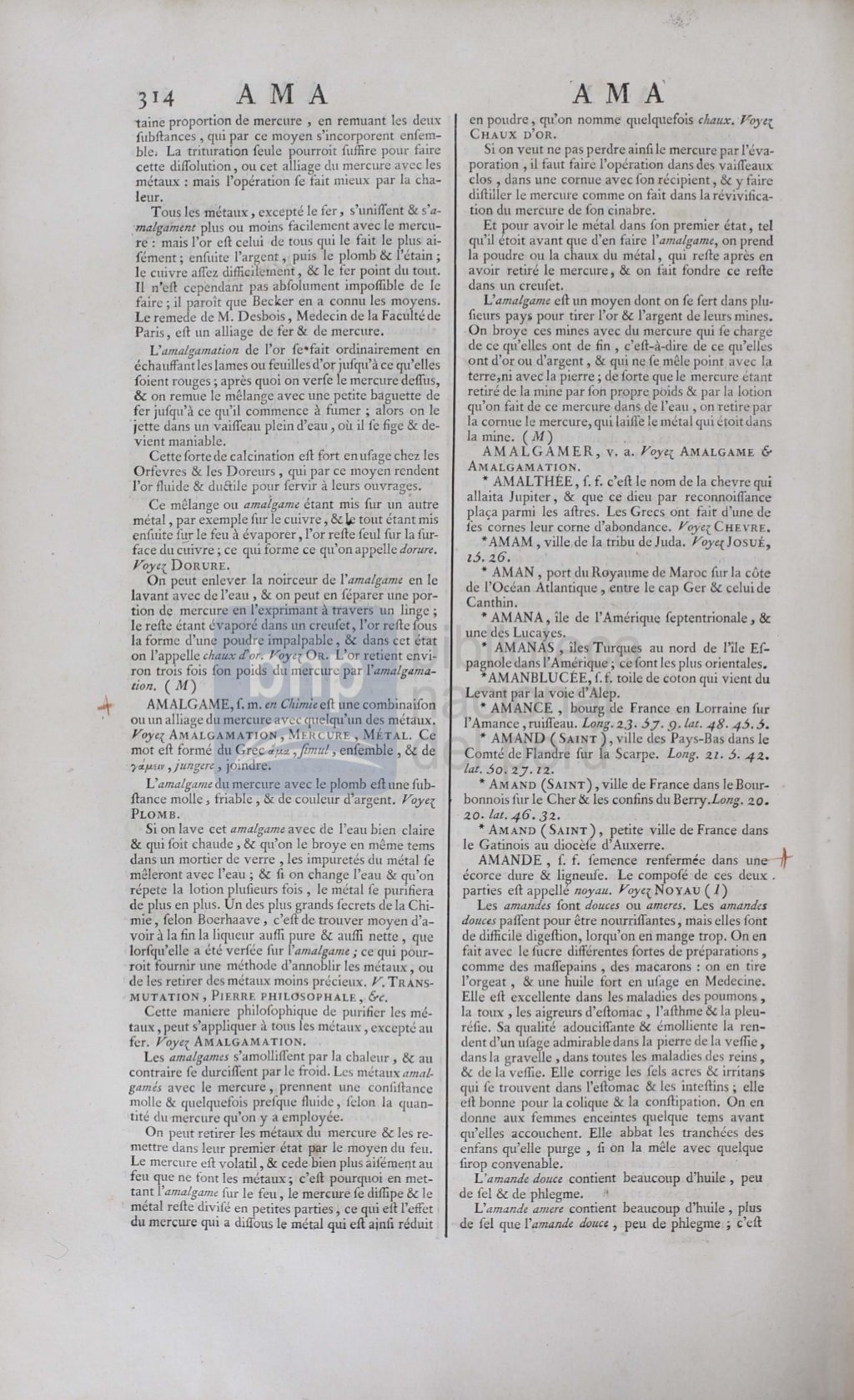
AMA
'taine proportion de mercure , en remuant les detLY
fubftances , qui par ce moyen s'incorporent enfem–
ble, La trituration feale pourroit fuffire pour faire
cette diLfolution, ou cet alliage du mercure avec les
métaux : mais I'opération fe faít mieux par la cha–
leur.
Tous les métaux, excepté le fer, s'uniífent
&
s'
a–
malgammt
plus ou m?ins
facilem~nt av~c
le
merct~re : mais l'or e!!: CelUl de tous qm le falt le plus al–
fément; enfuite l'argent, puis le plomb. & I'étain ;
le cuivre aLfez difficilement, & le fer pomt du tout.
11 n'e!!: cependant pas abfolument impoffible de le
faire ; il parolt que Beclcer en a connu les moyens.
Le remede de M. Desbois, Medecin de la Faculté de
Paris, eft un alliage de fer
&
de mercure.
L'amalgamation
de I'or fe-fait ordinairement en
échauffantles lames on feuíllesd'orl'llfqu'a ce qu'elles
foient rouges; apres quoi on verfe e mercllredeLfus,
& on remue le m&lange avec une petite baguette de
fer jufqu'a ce qu'il commence a fumer ; alors on le
jette dans un vaiífeau plein d'eau, ol! il fe fige
&
de–
vient maníable.
Cette forte de calcinatíon ell fort en ufage chez les
Orfevres
&
les Doreurs , qui par ce moyen rendent
l'or flaide
&
duaile pom fervir
a
leurs ouvrages.
Ce
m~lanae
OL!
amaigam~
étant mis fur un autre
métal, par
e~emple
fm le cL!ivre, &
ú::
tout étant mis
enfuite fu.r le feu a évaporer, l'or relle feul fur la fur–
face dL! cuívre; ce qtÚ forme ce qu'on appelle
dorure.
Yoye{
DORURE.
On peut enlever la noirceur de
I'amalgame
en le
lavant avec de I'eau,
&
on peut en féparer une por–
tion de mercure en I'exprimant a travers un linge;
le re!!:e étant évaporé dans un creufet, I'or re!!:e fous
la forme d'une pOlldre impalpable, & dans cet état
on I'appelle
chaux d'or. Yoye{
ORo L'or retient enví–
ron troís fois fon poids dll mercure par l'
amalgllma–
don.
(M)
AMALGAME,
f.
m.
en Clzimie
eft une combinaifon
ouun alliage du mercure avec qllelqu'un des métallx.
r~e{AMALGAMATION,
MERCURE, MÉTAL. Ce
mot ell formé du Grec:'¡=
,jimul,
enfemble, & de
I'd¡.wv ,jllngere,
joindre.
L'
amalgame
du mercure avec le plomb ell une fub–
!!:ance molle, friable,
&
de couleur d'argent.
roye{
PLOMJl.
Si on lave cet
amalgame
avec de l'eau bien claire
&
qui foit chaude, & qu'on le broye en meme tems
dans lm mortier de verre , les impuretés du métal fe
m@leront avec l'eau; & fi on change l'eau
&
qu'on
répete la lotion pluúeurs fois, le métal fe purifiera
de plus en plus. Un des plus grands fecrets de la
Chi–
mie, felon Boerhaave, c'eil: de trouver moyen d'a–
voir a la fin la Iiqueur auffi pure & auffi nette, que
lorfqu'elle a été verfée fur
l'amalgame ;
ce qui pOllr–
roit fournir une méthode d'annoblir les métatLY, ou
de les retirer des métaux moins précieux.
V.
TRANS–
MUTATION, PIERRE PHILOSOPHALE,
&c.
Cette maniere philofophique de purifier les mé–
taux, peut s'appliquer a tollS les métaux , excepté au
fer.
roye{
AMALGAMATION.
Les
amalgames
s'amolliífent par la cbaleur , & au
contraire fe durciLfent par le froid. Les métaux
amal–
gamés
avec le mercure, prennent une confillance
molle
&
quelql1efois prefque fluide, felon la (¡uan–
tité du mercure qu'on y a employée.
On peut retirer les métallx du mercure & les re–
mettre dans leUT premier état par le moyen du feu.
Le mercure ell volatil ,
&
cede bien plus aifément au
feu que ne fom les métaux; c'eft pourquoi en met–
tant
l'amalgame
fur le feu, le mercure fe diffipe & le
métal refte divifé en petites parties, ce qui ell I'effet
du mercure qui a diífous le métal qui e!!: a¡nfi réduit
en pondre , qu'on nomme quelql1efois
clUZllX.
Vo)'e{
CHAUX D'OR.
Si on veut ne pas perdre ainú le mercure par l'éva–
poraríon , il fam faire l'opération dans des vaiífeaux
e10s ,
dans une cornue avec fon récipient , &
Y
faire
dillillcr le mercure comme on fait dans la révivifica–
tion dl! mercure de fon cinabre.
Et pour avoir le métal dans fon premier état, tel
qu'il étoit avant que d'en faire
l'amalgame,
on prend
la poudre Ol! la chaux du métal, qui relle apres en
avoir retiré le mercare,
&
on fait fondre ce relle
dans un creu(et.
L'
amalgame
eft un moyen dont on fe fert dans plu–
fieurs pay, pour tirer l'or & l'argent de leurs mines.
On broye ces mines avec du merClrre
c¡ui
fe charge
de ce qu'elles ont de fin , c'eft-a-dire de ce qtl'elles
ont d'or ou d'argent,
&
qui ne fe
m~le
point avec la
terre,ni avec la pierre; de forte que le mercure étant
retiré de la mine par fon propre poids
&
par la lorion
qu'on fait de ce mercure dans de I'eau , on retire par
la cornue le mercure, qui laiífe le métal qtÚ étoit dans
la mine.
(M)
AMALGAMER, v. a.
Voye{
AMALGAME
&
AMALGAMATION.
" AMALTHÉE, f. f. c'ell le nom de la chevre qtú
a1laita Jupiter,
&
que ce dieu par reconnoiífance
plas;a parmi les aftres. Les Grecs ont fair d'une de
fes comes leur corne d'abondance.
Yoye{
CHEVRE.
*
AMAM , ville de la tribu de luda.
Yoye{
losuÉ,
2.5.2.6.
*
AMAN, port dl! Royaume de Maroc fur la cote
de l'Océan Atlantique , entre le cap Ger & celui de
Canthin.
*
AMANA, lIe de l'Amériqtte feptentrionale,
&
tme des Lucayes.
*
AMANAS , lIes Turqtles au nord de l"'úe Ef–
pagnole dans l'Amérique ; ce font les plus orientales.
"AMANBLUCÉE,
f.
f. toile de coton qui vient du
Levant par la voie d'Alep.
*
AMANCE, bourg de France en Lorraine fur
I'Amance ,ruiLfeau.
Long.
23 . .57·
9·
lat.
48. 4.5.
J.
*
AMAND (SAINT), ville des Pays-Bas dans le
Comté de Flandre fur la Scarpe.
Long.
22 . .5. 42.
lato
.50.
27. 22.
*
AMAND (SAINT), ville de France dans le Bonr–
bonnois fm le Cher
&
les confins du Berry.
Long. 2.0.
20.
lato
46. 32..
*
AMAND (SAINT), petite ville de Franee dans
le Gatinois al! dioceíé d'Allxerre.
AMANDE, f. f. femence renfermée dans une
t
écorce dure
&
li
9
nelúe. Le compofé de ces deux .
parties eft appelle
noyau.
Y~e{
NOYAU (1)
Les
amandes
font
douces
ou
ameres.
Les
amandes
douces
paífent pour
~tre
nourriLfantes, mais elles (ont
de difficile digeilion, lorqu'on en mange tropo On en
fait avec le fuere différentes fortes de préparations ,
corome des maLfepains , des macarons : on en tire
I'orgeat,
&
une huile fort en ufage en Medecine.
Elle ell excellente dans les maladies des pOllmons ,
la tOllX, les aigreurs d'ellomac, l'allhme &Ia pleu–
réíie. Sa qualité adouciLfante & émolliente la ren–
dent d\lI1ufa"e admirable dansla pierre de la veffie,
dansla gravelle, dans toutes [es maladies des reins,
& de la veffie. Elle corrige les (els acres & irritans
quí fe trouvent dans ['ellomac
&
les inteílins; elle
eft bonne pOlrr la colique
&
la corúlipation. On en
donne aux femmes enceintes quelque tems avant
qu'elles accollchent. Elle abbat les tranchées des
enfans qu'elle purge , íi on la
m~le
avec quelque
(rrop convenable.
L 'amande douce
contient beauconp d'huile, peu
de (el & de ph.legme.
•
L'
amallde amere
contient beaucoup d'htúle , plus
de fel que
I'amand,
JOl/ce,
peu de phlegme ; c'cft
















