
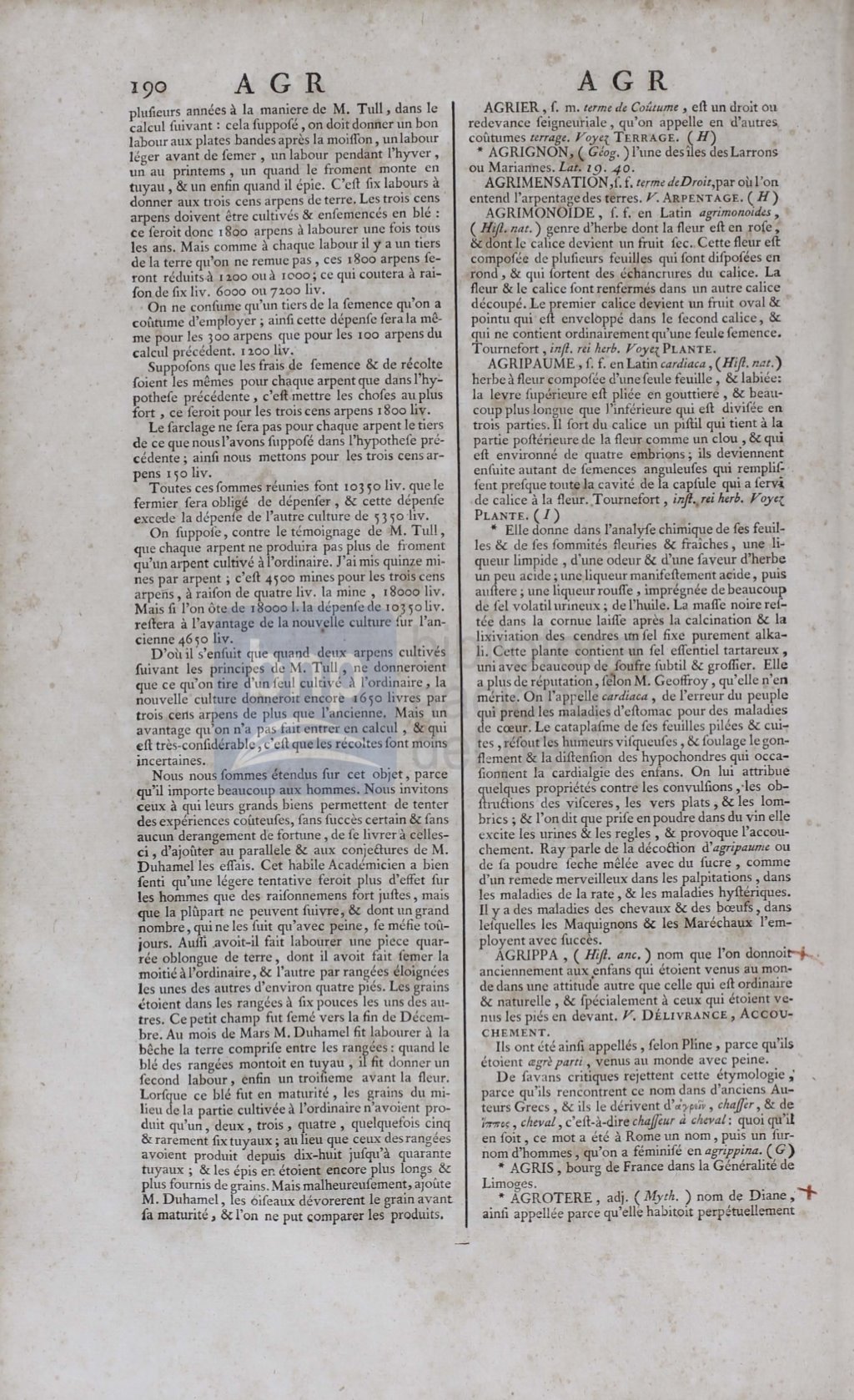
AGR
plufieurs années
a
la maniere de M. Tull, dans le
c.álcul Cuivant : cela CuppoCé , on doit donner un bon
labour aux plates bandesapres la moiffon, unlabour
léger avant de Cerner, un labour pendant l'hyver,
un au printems, un quand le froment monte en
tuyau,
&
un enfin quand il épie. C'eíl: íix lab.ours a
donner aux trois cens arpens de terreo Les trOls cens
arpens doivent &tre cultivés
&
enCemencés
e~
blé :
ce Ceroit done
1800
arpens a labourer une fOls tous
les ans. Mais corome achaque labour il
y
a un tiers
de la terre qu'on ne remue pas , ces
1.800
arpens
C~ront réduits.a
1200
ou a
I
coo; ce qUl coutera
a
ral–
fonde
CIX
liv.
6000
ou
7200
liv.
On ne conCume qu'un tiers de la Cemence qu'on a
COlltume d'employer ; ainíi c.ette dépenCe Cera la m&–
me pour les
300
arpens que pour les
100
arpens du
caleul précédent.
1200
liv.
SuppoCons que les frais de Cemence
&
de récolte
foient les m&mes pour chaqlle arpent que dans I'hy–
potheCe précédente, c'eíl: mettre les choCes au plus
fort , ce Ceroit pour les trois cens arpens
1800
liv.
Le farclage ne fera pas pour chaque arpent le tiers
de ce que nousl'avons CuppoCé dans l'hypothefe pré–
cédente; ainíi nous mettons pour les trois cens ar–
pens
150
liv.
Toutes ces Commes réunies font
103
~o
liv. que le
fermier fera obligé de dépenCer,
&
cette dépenfe
excede la dépen{e de l'autre culture de
5350
·Iiv.
On Cuppofe, contre le témoignage de M. Tull,
que chaque arpent ne produira pas plus de froment
qu'un arpent cultivé a l'ordinaire. J'ai mis 'luinze mi–
nes par arpent ; c'eíl:
4500
mines pour les trois cens
arpeñs,
a
raiCon de quatre liv. la mine,
18000
liv.
Mais íi l'on ote de
18000
L
la dépenfe de
10350
liv.
reíl:era a l'avantage de la nouv:elle culnlre [ur I'an-
cienne
4650
liv.
.
D'Oll il s'enCuit que quand deux arpens cu.ltivés
fuivant les principes de M. Tull , ne donneroient
que ce qu'on tire d'un feul cultivé
a
l'ordinaire, la
nouvelle culture donneroit encore
1650
livres par
trois certs arpens de plus que l'ancienne. Mais un
avantage qu'on n'a pas fait entrer en calcul ,
&
'lui
eíl: tres-confidérable, c'eíl: que les récoltes Cont moins
incertaines.
Nous nous
Commes
étendus Cur cet objet, paree
qu'il importe beaucoup aux hommes. Nous invitons
ceux
a
'lui leurs grands biens permettent de tenter
des expériences coúteuCes, Cans fucces certain
&
Cans
aucun derangement de fortune , de fe livrer'a celles–
ci, d'ajollter au parallele
&
allx con)eétures de M.
Duhame!les effais. Cet habile Academicien a bien
fenti qu'une légere tentative feroit plus d'effet fur
les hommes que des raifonnemens fort juíl:es , mais
que la plllpart ne peuvent ftuvre,
&
dont un grand
nombre, qui ne les fuit qu'avec peine, fe méfie tOII–
¡ours. Auffi .avoit-ü fait labourer une piece quar–
rée oblongue de terre, dont ü avoit fait
Cemer
la
moitié a l'ordinaire,
&
l'autre par
ran~ées
éloignées
les unes des autres d'environ quatre plés. Les grains
étoient dans les rangées
a
fix pouces les uns des au–
tres. Ce petit champ fut
Cemé
vers la fin de Décem–
breo Au mois de Mars M. DlIhamel fit labourer
a
la
b&che la terre compriCe entre les rangées : ql1and le
blé des rangées montoit en tllyau ,
Ü
fit donner un
fecond labour, enfin un troiíieme avant la fleur.
LorCque ce blé fut en matllrité, les grains du mi–
líeu de la partie cultivée a l'ordinaire n'avoient pro–
duit qu'un, deux , trois, quatre, quelquefois cinq
&
rarement
CIX
tuyaux; au lieu que ceux des rangées
avoíent produit depuis dix-huit juCqu'a quarante
tllyaux ;
~
les épis en étoient encore plus longs
&
plus fourrus de grains.Mais malheurenCement, a¡oúte
M. Duhamel, les 6iCeaux dévorerent le grain avant.
fa maturité
J
&
1'on ne put <;omparer les produits.
AGR
AGRIER,
f.
m.
terme de Coutume
,
eíl: un droit ou
redevance Ceigneuriale, 'lu'on appelle en d'autres
coutllmes
terrage. Voye{
TERRAGE.
(H)
" AGRIGNON, (
Géog.)
l'une deslles des Larrons
ou Mariannes.
Lar. 19. 40.
AGRIMENSATION,f. f.
terme deDroit,par
ou 1'on
entend l'arpentagedes terres.
V.
ARPENTAGE.
(H)
AGRIMONOIDE,
f.
f. en Latin
agrimonoides,
( Hiji. nato
)
genre d'herbe dont la fleur eíl: en roCe,
&
dont le calice devient un fruit fec. Cette fleur eíl:
compofé!! de pluíieurs feuiUes 'lni Cont diCpoCées en
rond,
&
qui Cortent des échancmres dn calice. La
fleur
&
le calice font renfermés dans tm autre caJice
découpé. Le premier calice devient un fntit oval
&
pOintll 'lui eíl: enveloppé dans le Cecond calice,
&
qui ne contient ordinairement qn'une feul¡: femence.
TOllmefort,
inflo
rei herb. Voye{
PLANTE.
AGRIPAUME,
f.
f. en Latin
cardiaca, (Hiji. nat.)
herbeil flellr compoCée d'llne Ceule feuille ,
&
labiée:
la levre ClIpérieure eíl: pliée en gouttiere ,
&
beau–
coup plus longlle que j'inférieure qtU eíl: divifée en
trois parties. Il
Cort
dll calice un piíl:ü qui tíent a la
partie poíl:érieure de la fleur comme un clou ,
&
Cflú
efi environné de Cfllatre embrions; ils deviennent
enCuite autant de [emences anguleuCes Cflli remplif–
Cent preCque toute la cavité de la capCule qui a Cerv-i
de calice a la fleur. Tournefort,
inft. rei herb. Voye{
PLANTE.
(1)
" Elle donne dans I'analyfe chimique de Ces feuil–
les
&
de Ces Commités fleuries
&
fraiches, une li–
Cflleur limpide , d'une odeur
&
d'une Caveur d'herbe
un peu acide; une liCflleur manifeíl:ement acide, puis
auíl:ere; une liCflleur roufTe , imprégnée de beaucoup
de Ce! volatil urineux ; de l'hllile. La mafTe noire reC–
tée dans la comue laifTe apres la calcination
&
la
lixiviation des cendres lro fel fixe purement alka–
Ji. Cette plante contient un Ce! effentie! tartareux,
uni avec beaucoup de {oufre Cubtil
&
groffier. Elle
a plus de réputation, Celon M. Geoffroy, qu'elle n'en
mérite. On l'appelle
cardiaca,
de l'erreur du peuple
cjl.u prend les maladies d'efiomac pour des maladies
de creur. Le cataplaCme de Ces feuilles pilées
&
cui–
tes, réCout les humeurs viCqueufes ,
&
Coulage le gon–
flement
&
la diíl:enfion des hypochondres qui occa–
íionnent la cardialgie des enfans. On lui attribue
Cfllelques propriétés contre les convlllfions ,-les ob–
íl:ruétions des vifceres, les vers plats,
&
les lom–
brics;
&
l'on dit que priCe en poudre dans dll vin elle
excite les urines
&
les regles,
&
provoque l'accou–
chement. Ray parle de la décoilion
d'agripaume
ou
de Ca poudre Ceche m@lée avec du Cucre , comme
d'un remede merveü]eux dans les palpitations , dans
les maladies de la rate ,
&
les maladies hyíl:ériques.
11 y a des rna'ladies des chevatlX
&
des brenfs, dans
leCquelles les Maquignons
&
les Maréchaux l'em–
ployent avec fucces.
AGRIPPA,
(Hifl.
tlnc.)
nom Cflle l'on donnoi
anciennement aux .enfans
qui
étoient venus au mon–
de dans une attitude autre que celle qui eíl: ordinaire
&
naturelle ,
&
[pécialement a ceux qui étoient ve–
nus les piés en devan!.
V.
DÉLIVRANCE, Accou–
CHEMENT.
Ils ont été ainíi appellés , felon Pline, parce qu'üs
étoient
(llgre
partí,
venus au monde avec peine.
De favans critiques rejettent cette étymologie,–
paree Cfll'ils rencontrent ce nom dans d'anciens Au–
teurs Grecs ,
&
üs le dérivent d'
d/'P'"
,
chaffir,
&
de
í'7T7T'f,
chwal,
c'eíl:-a-dire
chaffiur
ti
cheval:
quoi qu'ü
en Coit , ce mot a été a Rome un nom, puis un {ur–
nom d'hommes , 'lu'on a
féminiCé
en
agrippina.
(
G)
" AGRIS, bourg de France dans la Généralité de
Limoges.
.. AGROTERE, adj.
(Myth.
)
nom de Diane, ......
ainii appellée paree 'lu'elle habitoit perpétuellement
















