
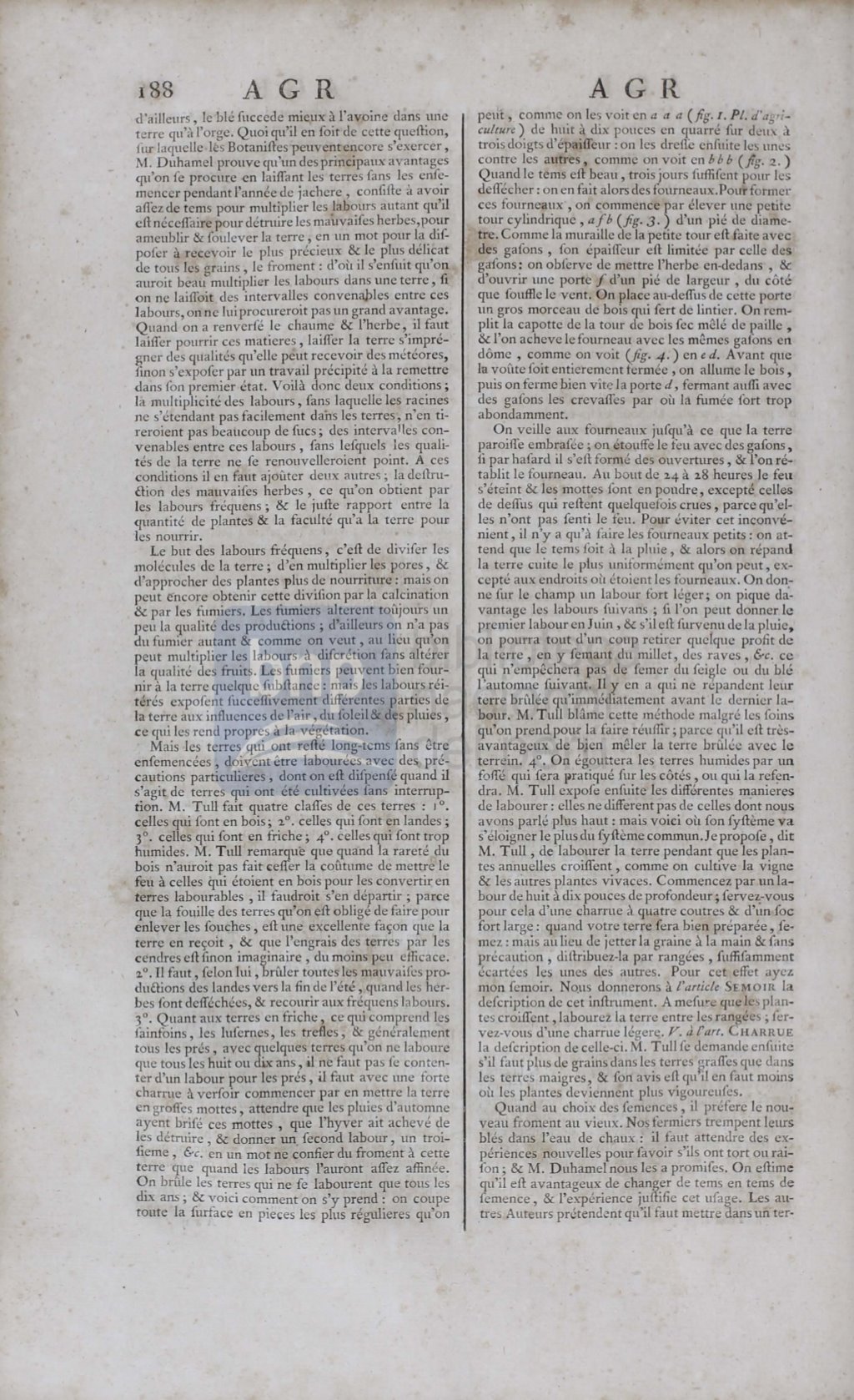
188
AGR
d 'ailleurs, le blé fuccede mieux
a
l'avoine dans lme
terre qu'a I'orge. Quoi qu'il en foit de cette queilion,
{ur lacluelle l!!s Botanilles pellventencore s'exercer,
M. Duhamel prollve qu'un des pnncipaux avantages
qu'on fe procure en lai{fant les terres fans les
en{~mencer pendantl'année de jachere, conhlle
a
aVOlr
aírezde tems pour multiplier les
lab~urs
autant qu'il
ellnéce{faire pour détnúre les mauvalfes
herbes,po~u
ameublir
&
{oulever la terre , en un mot pour la dif–
pofer
a
recevoir le plus précieux
&
le plus délicat
de tons les grains , le froment : d'oü il s'enflút qu'on
¡¡uroit beau mulriplier les labours dans une terre,
íi
on ne lai{foit des intervalles convenaPles entre ces
labours on ne lui procnreroit pas un grand avantage.
Quand 'on a renverfé le chaume
&
l'herbe, il faut
laiífer pourrir ces matieres , laj{fer la terre s'impré–
gner des qualités Cf11'elle peut recevoir des météores,
{mon s'expofer par un travail précipité a la remettre
dans fon premier état. Voila donc deux conditions;
la multiplicité des labours, fans laquelle les racines
ne s'étendant pasfacilement dabs les terres, n'en ti–
reroient pas beaucoup de fucs; des interva1les con–
venables entre ces labours, fans lefc¡uels les quali–
tés de la terre ne fe renouvelleroient point. A ces
conditions il en fam ajoiher dellx autres; la deilm–
aion des mauvaifes herbes, ce Cf11'on obtient par
les labours fréCf1lens;
&
le juile rapport entre la
quantité de plantes
&
la faculté Cf11'a
la
terre pour
les nourrir.
Le but des labours fréCf1tens, c'ell de divifer les
molécules de la terre; d'en multiplier les pores,
&
cl'approcher des plantes plus de nourrinlre: mais on
peut (!ncore obtenir cette divihon par la calcination
&
par les tllmiers. Les fllmiers alterent tOlljOurS un
peu la qualité des produéhons ; d'ailleurs on n'a pas
du fumier autant
&
comme on veut, au lieu Cf11'on
peut multiplier les labonrs
a
difcrétion fans altérer
la qllalité des fruits. Les fumiers peuvent bien four–
nir
a
la terre Cf1lelque fubllance : mais les labolUs réi–
térés expofent fucceffivement difFérentes parcies de
la terre aux influences de l'air ,du foleil
&
des pluies ,
ce cjlú les rend propres
a
la végétation.
Mais les terres Cf1ú ont refté long-tems fans
~tre
enfemencées, doivent
~tre
labourées avec des pré–
cautions particulieres, dont on eft difpen(é Cf1land
i1
s'agit de terres Cf1li ont été cultivées fans intemlp–
tion. M. Tull fait c¡uatre cla{fes de ces terres : ]
0.
celles Cf1IÍ {ont en bois;
2.0.
celles qui font en landes;
3°.
celles c¡ui font en friche;
4°.
celles qui font trop
humides. M. Tull remarque que quand la rareté du
bois n'auroit pas fait ce{fer la coutume de mettre le
feu a celles qui étoient en bois pour les convertir en
terres labourables , il faudroit s'en déparcir ; paree
que la fouille des terres Cf11'on
ell
obligé de faire pour
enlever les fouches , eíl: une excellente fas:on que la
terre en res:oit ,
&
Cf1le l'engrais des terres par les
cendres eíl:{mon imaoinaire , du moins peu efficace.
2.0.
Il faut, felon hú,bri\1er toutes les mauvaifes pro–
duaions des landes vers la fin de I'été, quamlles her–
bes (ont delIéchées,
&
recounr aux fréquens labours.
3°.
Quant aux terres en rnche, ce qui comprend les
fainfoins, les lufernes, les trefles,
&
généralement
tons les ptés, avec quelCf1les terres qu'on ne laboure
Cf1le tous les huit on
dix
ans,
il
ne faut pas fe conten–
ter d'tm labour pour les prés,
il
filut avec lme forte
charrue
a
verfoir commencer par en mettre la terre
en groffes mottes, attendre Cf1re les pluies d'autonme
ayent brifé ces mottes , Cf1le l'hyver ait achevé de
les détruire ,
&
donner un fecond labolU, un troi–
fieme,
&c.
en un mot ne confier du fromenr
a
cette
terre que Cf1land les labolUs l'alUont afrez affinée.
qn
bñúe les terres
qui
ne fe labonrent Cf1le tous les
di"
ans;
&
voici comment on s'y prend: on coupe
toute la filrface en pieces les plus régulieres qu'on
AGR
peut, commc on les voit en
a a a
(jig.
l.
PI.
¿'.1,"·–
culture)
de huit
a
dix pouces en quarré hlr dl!u"
d.
troisdoigts d'épailIeur :on les drelle enfuite les unes
contre les autres, comme on voit en
b b b
(ji{J.
2. )
Quand le tems eíl: bean, trois jours fuffifent pour les
delIécher: on en fait alors des fourneaux.Pollr former
ces fourneaux, on commence par élever tlne petite
tour cylindrique,
afb
(jig.
3. ) d'un pié de diame–
treo Comme la muraille de la petite tOlU eft faite avec
des gafons , fon épaiffeur eft limitée par celle des
ga{ons: on obíerve de mettre I'herbe en-dedans ,
&
d'ouvrir lme porte
f
d'un pié de largelU , du coté
que foume le vento On place au-defrus de cette porte
un gros morceau de bois Cf11Í fert de lintier. On rem–
plit la capotte de la tour de bois fec m&lé de paille ,
&
I'on acheve le fourneau avec les
m~mes
galons en
dome , comme on voit
(lig.
4. ) en
e
d.
A
vant Cf1le
la VOlite {oit entierement fermée ,on allume le bois ,
puis on ferme bien vite la porte
d,
fermant auffi avec
des gafons les creva{fes par Ol] la tllmée fort trop
abondamment.
On veille aux fourneaux jufqn'a ce que la terre
paroilTe embrafée ; on étouffe le feu avec des gafons,
íi par hafard il s'eíl: formé des ouvertures,
&
l'on ré–
tablit le fourneau. Au bout de
2.4
a 28 heures le feu
s'éteint
&
les mottes font en pondre, excepté celles
de delIus qui reíl:ent quelquefois crues , paree qu'el–
les n'ont pas fenti le teu. POlU éviter cet inconvé–
nient, il n'y a qu'a faire les fourncaux petits : on at–
tend cfue le tems foir
a
la pluie,
&
alors on répand
la terre cuite le plus unifornlément qu'on peut, ex–
cepté aux endroits Oll étoient les fourneaux. On don–
ne fur le champ un labour
tort
léger; on pique da–
vantage les labours fuivans ;
[¡
I'on peut donner le
premier labouren Juin,
&
s'ileft furvenudela pluie,
on pourra tout d'un coup retirer Cf1lelque profit de
la terre, en y femant du millet, des raves,
&c.
ce
Cf11Í
n'emp~chera
pas de femer du
fei~le
ou du blé
1'automne fuivant. 11 y en a cjlli ne repandent lelu
terre brlllée ql1'immédiatement avant le dernier la–
bour. M. Tull blame cette méthode malgré les foins
qn'on prend pou>." la faire réuflir; parce qu'il ell tres–
avantageux de bien
m~ler
la terre brülée avec le
terrein.
4°.
On égouttera les terres humides par 1m
folfé qui fera
l~ratiC¡llé
fur les cotés , ou qui la
ref~n
dra. M. Tull expole enfuite les diffórentes manieres
de laboltrer: elles ne different pas de celles dont nous
avons parlé plus haut : mais voici Ol! fon fylleme va
s'éloigner le plus du (yfteme commun.
J
e propofe , dit
M. Tull , de labourer la terre pendant que les pIan–
tes annuelles croiffent, comme on cultive la vigne
&
les autres plantes vivaces. Commencez par un la–
bour de huit
a
dix pouces de profondeur; fervez-vous
pour cela d'une charrue
a
qtlatre COlltre
&
d'~m
{oc
fort large: quand votre terre fera bien préparée, fe–
mez: mais aulieu de jetter la graine
a
la main
&
fans
précantion , diíl:ribuez-la par rangées , fnffifamment
écartées le unes des autres. Pour cet effet ayez
mon femoir.
No.usdonnerons
a
l'anide
SEMOlR
la
defcription de cet inftrument. A
mefu~e
que les plan–
tes croifrent , labourez la terre entre lesrangées ; fer–
vez-vous d'une charrue légere.
r.
afan.
CHARRUE
la defcription de celle-cí. M. Tull fe demande enfuite
s'il faut plus de grains dans les terres graíles que dans
les terres maigres,
&
fon avis eíl: Cf11'il en faut moins
011 les plantes deviennent plus vigoureufes.
Quand au choix des femences , il préfere le nou–
veau froment an vieux. Nos ferrniers trempent leurs
blés dans l'eau de chaux:
il
faut attendre des ex–
périences nouvelles ponr favoir s'ils ont tort ou rai–
{on;
&
M. Dllhamelnous les a promifes. On eíl:ime
Cf11'il ell avantageux de changer de tems en teros de
femence,
&
I'expérience juftifie cet ufage. Les atl–
tres Auteurs prétendent qu'il faut mettre dans un ter-
















