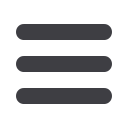
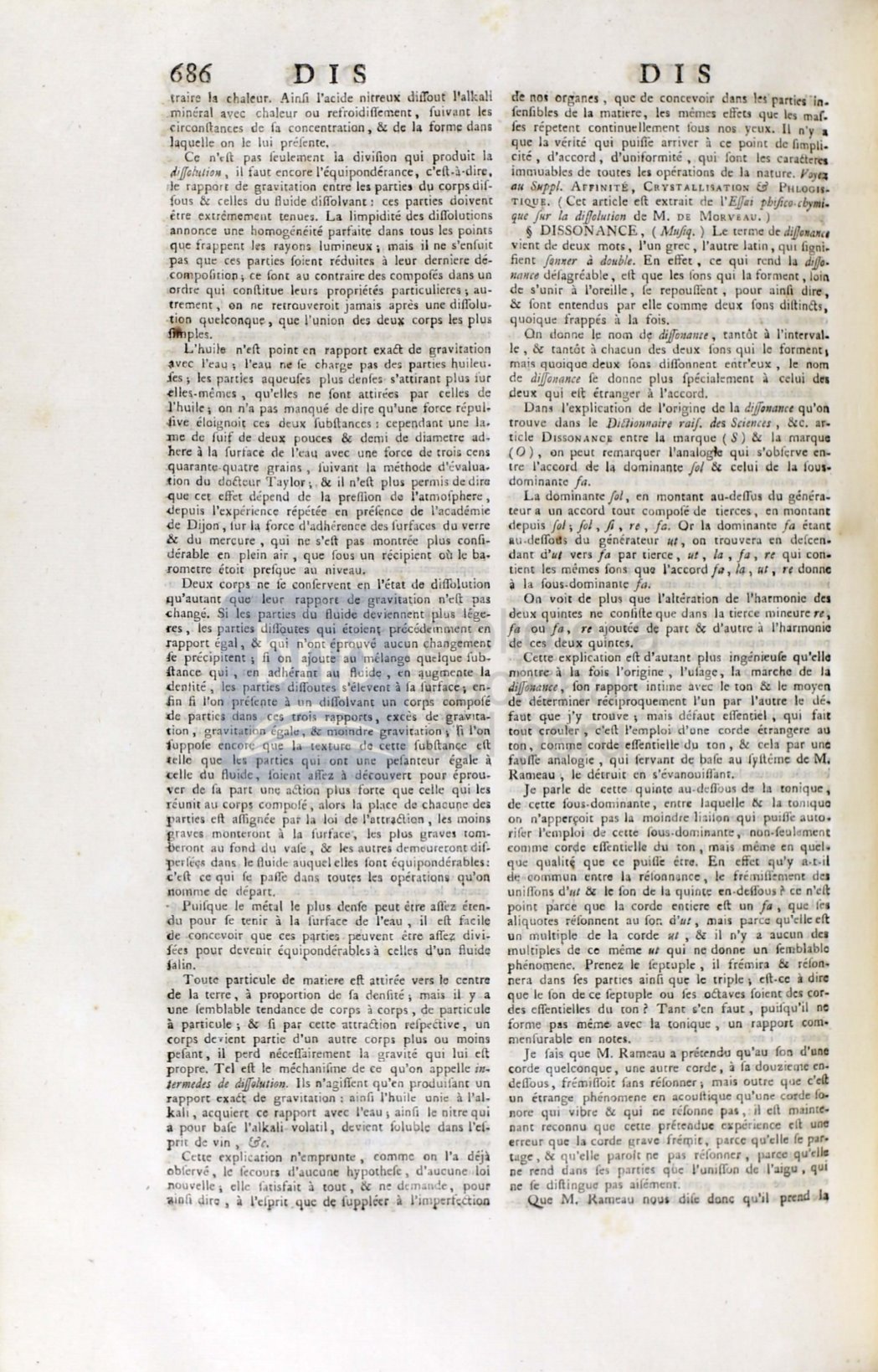
686
D I
traire
la
chaleur.
A
inli l'acide nitreux difi"out Palkall
mineral avec chaleur ou refroidiffement , fuivant ks
circonO:ances de
fa
concentration ,
&
cje la formt: dans
!~quelle
on
k
lui prefrnre.
Ce
n'rO: pas feulement la divilion qui produit la
ilif!oiution,
ii fauc encore l'equipondcrance , c'dl-ii·dir ,
le
rapport de gravitation entrc Jes parties d11 corps dif–
fous
&
celles du Auide dilfolvant : ces parties doivent
eire extrcmcmenc tenues.
La
limpidite 1ks dilfolutions
;innonce une homogenfoe parfaite dans cous les poinrs
que frappenr
l~s
rayons lumineux; mais ii ne s'enfuic
pas que ces parties foient reduires
a
leur derniere de–
compolicioii; ce font au contraire des compofes dans un
ordre qui conO:irue leurs proprieres particulieres; au–
tremem, on ne rerrouveroit jamais apres une dilfolu.
tion quelcqnque , que l'qnion des
deu~
corps Jes plus
flliples.
L'huile n'ell: point en rapport exaCl: de gravitation
~vec
l'ea11; l'eau ne fe ch;irge pas des parties huileu .
.fes; !es parries aqueuf(s plus denfes s'arrirant plus fur
~lles-menies
, q\l'dles ne font
attir~e•
par cdles de
J'huile; on n'a pas manque de dire qu'une force repul–
.flve eloignoit ces deux fub{bnccs
1
cependanr une la,
;me de fuif de
<leux
pouces
&
demi de diamem: ad–
here
a
la furface de l'eal1 avcc une force de trois cens
.quaranw.quatre grains • fuivanr la methode d'e,•alua.
tion du
docc~ur
Taylor;
&
ii n'e!l: plus permis de dire
-que cet elfct depend de
la preffion de l'atmofphm:,
<lepuis )'experience reperee en prefence de !'academic
de Dijon-, fur ll\ force d'adhfronce des furfacus du vem:
&
du mercure , qui ne s'e!l: pas montree plus conli–
derable en plein air • que fous
Un
recipient OU
le
ba–
rometrc 6toit prefque au niveau.
Deux corps ne
fe
cqnfervent en l'etat dfl difiblution
,:iu'autant que
leur
rapport de g1'avitation n'eO: pas
c hange. Si les parties du fluide deviennent plus ltge–
f"CS ,
Jes parties diffoutes qui
etoien~
precc\demment en
rapport egal,
&
qui 11'ont eprouvtl aucun changernent
fe precipiren.t ; fi on ajoute au melangfl quclquc fub–
itance qui , en adherant all Al.lido , en
~ugmente
la
den lite' !es parties diffoutes s'ekvenr
a
fa
furface; en–
Jin
fi
l'on prffe(lte 3 un diffolvant un corps compofe
'<le
partic• dans ces troi. n1pports, exc2s 9e gra.\11ta–
tion
>
gravitation egalu.
&
moindre gn1vitation;
'Ii
l'on
fuppofe encore que la texture de cette fub!l:an<;e ell:
tellc que
ks
parties qui ont une pefanteur egale
~
celle du fluide . foienr atrez
11.
decouvert pour eprou–
ver de
fa
part une aCl:ion plus forte que celle qui
ks
rcunit au corps compofe , alors
la
place de chaoupe de•
p arties eft affignee par
I
loi de
l'orrr~CliQn
, les moins
graves monteront
a
la
furface", ks plus graves tom–
-beront au fond dl1 vale,
&
les auires demoureronr C:if–
!pcrfe\.s dans le Auide auquelelles font equiponderables :
<:'ell:
Ce qui
fc
paffo dans
[QU[~S
ks
operatiqng
CjU'On
nomme de depart.
- Puifque le metal le plus denfo peut erre affez eren–
du pour fe tenir
a
la furface de l'eau ' ii
di:
fac ile
de
concc"oir que ces p:irties peuvent
' rro affe?: divi–
fees pour devenir equi(>onderablts
a
celles d'un
fluid~
Jalin.
Toure particule de matiere
efl:
attiree vers lo centre
de la terre'
a
proportion do
fa
denlire ; mais ii
y
a
une femblable trndance de corps
a
corps, de parricul6
a
particule;
&
fi par
CCtte
-am a{tioo FCfp<"
ive, un
corps de ient partie d'un autre corps plus ou moins
p efanr . ii pcrd necdfairement la gravite qui Jui ell:
propre. Tel
ell:
le mechani me de cu qu'on appelle
in.
Jermtdts dt di.ffel111ion.
I
ls n'agiffent qu'en pro<lmfanr un
rapport exact de grav1racion : ainl'i l'huile unie
a
l'al–
k ah, acquierc cc rapport avec l'eau; ain(i le oicre qui
a pour bafe l'.1lkali vol til, dc\·icnt foluble dans l'ef–
prit de vin ,
&c.
etrc t'xpli acion n'empruncc: , comme on l'a deja
obfervc! , le frcours
cl'
ucunc hypocherc, d'aucune loi
'
n~uvelle ;
el k
facisfaic
a
tour.
ne dcmanc!c ' pour
(llD!i
ire
>
a
l'c pric que de fop le r
a
l'1m erfxdioo
DI S
cTe nos or anes , que de concevoir
ans ks parties in.
fenfibles de la matirre
>
ks
memes clfcu quc les ma(.
fes repctent continucllement IOus nos
eux.
II
n·y •
que
b
verite qui puilTe arriver
a
ce point de limpli.
cite, d'accord, d'uniformite , qui font lcs
CJrJ
tcr<"S
immuabks de toutes !es operations de
la
nature.
Poyq
a11
11ppl.
ArFINJTE,
CR
YSTALL15ATION
& P11Loo1s.
TIQ..Y E. (
et article ell: extraic de
l'Effa1
pbtjico.cb)'mi.
que fur
la di.flol111ion
de
M.
DE
MoR
EA
. )§
DlSSO
A CE, (
Mujiq.
)
Le termd de
diffo1111J1,
vi nt de deux mots, l'un grec, l'autre lnrin, qlll
Ii
ni.
fient
famttr
a
doublt.
En elfet , ce qui rend
IJ
diflo·
1in11c6
defagreable , ell: que les IOns qui la ferment,
I
in
de s'unir
a
l'oreille.
(e
rcpoulfent ' pour ainli dire .
&
font entendus par die comme deu:<
fons diltincts,
quoiquc frappes
a
la fois.
On donnc:
Ii:
nom d9
di.flimame,
tantot
ii
!'interval.
Je ,
&
tantot
a
chaclln des Jcux fons qui
(e
forment \
mais quoiquo deux fons diffonnent entr'cux , le nom
de
dijfo11ance
re
donne plus fpecialement
a
c
lui
d~a
deux qui
ert:
erranga
a
l'nccord.
Dan' l'explicarion de l'origino de
In
dijfona11ct
qu'on
trouve dans le
D1lliom1niro
roif.
des
Scieucts
,
•c.
ar–
ticle D1sso>1ANCE
~ncre
la marque: (
S)
&
I
marque
( 0),
on peur rem:irquer l'analoglc qui s'obferve en–
rre !'accord de
la
dominance
fol
&
cclui
de la
fous–
dominanre
fa.
La
dominanrc
fol,
en montant au-ddTus du gcncra–
teur a un accord tour compofe de
ticrces, en moncant
depuisfol; fol,
Ji ,
re,
Jc.
Or la dominante
fa
etant
au.de!fods du gcnerateur 111, on trouvera en ddcen.
dant
d'u(
vcrs
fa
par tierce,
ut, la
,
fa, re
qui con.
ticnt les memes fons qua )'accord
f
fl
1
/4
1
UI
1
re
donnc
~
la fous.dominante
fa.
On voit de plus que ('alteration de !'harmonic des
deux 9uintes ne conlifle que dans la tiercc mincure
re ,
fa
Oll
fa, re
ajoutec de part
&
d'autrl:
a
l'hannonio
de ces deux quinces.
ette
e>eplication ell:
d'aur~nt
plus ingiinieufe qu'cllo
montre>
a
la foiG )'origine , f'ufagc, la marchc de la
Jijfo11a11ce,
fon rapport inrirne avec
le
ton
&
k
moycn
de determiner rcciproquement l'un par l'autre le
de.
faut que j'y trouve ; mais dcfaut cffentiel , qui fair
tout crouler , c'eO: l'emploi cl'une corde ctran ere
au
con, comme corde e!fentidle du ton ,
&
ccla par unc
faul{l: analogie , qui fervam de
\Jafc
au fyficme de
M.
Rameau ,
le:
de~ruir
en s'evanouilfan<.
Je parle de cette quintc au.ddTous de la tonique,
de cerre fous.dominante, enrre laquelle
&
la toniquo
on n'apper1=oit pas la moindre
li~iton
qui puilfc uto–
rifor l't:mploi de ce1ro fous.dominanre,
nun-fcul~mcnt
comme corde effenridle dtj ton, ma is mt!me en quel.
que
qualit~
quc ce puilfe crrc. En effcc qu'y a.1.il
cle eommun entre la refonn nee,
k
frcm11fcment deJ
uniffo ns d'111
&
le
fon de la quince en-delfous
~
cc n'e!l:
point p'arce que la cordo cnciere
di:
un
fa
,
que
fes
aliquores refonncnt au for. d'111, mais par
qu'clle ell:
un multiplo de la corde
ut
,
&
il n'y a aucun dc1
multiples de ce meme
ut
qui no donne un fernblablo
phfoofllene. Prencz le fepcuple , ii fremira
&
rHon–
nera dans fes pames ainli quc le triple
1
cO:.cc
dire
que le fon de Ce feptuple OU
fos oCJ:aves foicnt des Cor–
des e!fcntielks du ron
?
Tant s'cn faut, puifqu'il no
forme pas mcmc- a9cc la toni9ue , un rapport com·
menfurable on notes.
Je fais quc M. Rameau a pretendil qo'au fon d'une
corde quclconque, une aurre cordc,
a
fo
douziemc cn–
de!fous , frfm1ffoic fans refonner; mliS OUtre qoe c'eft
un etrange phenomcne en
coufiiquc qu'unc
cord~
(o–
norc qui
ibrc
&
qui ne r'fonne pas,
ii
ell mamre–
nant reconnu que ccue
rercnduc
cxpert~nce
ell uoc
erreur que
I
corde gr ve frefl1it , parce qu'dlc fe par–
tJge ,
&
qu'elle parole ne pas rHonncr, parce qu'cll7
ne rend dans fcs parties qoc l'um(fon de
I'
igu , qui
ne
fc:
difiinguo pas a1fement.
uc M. Rameau nQus d. c done qu'il prcnd
fa
















