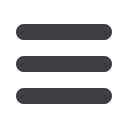
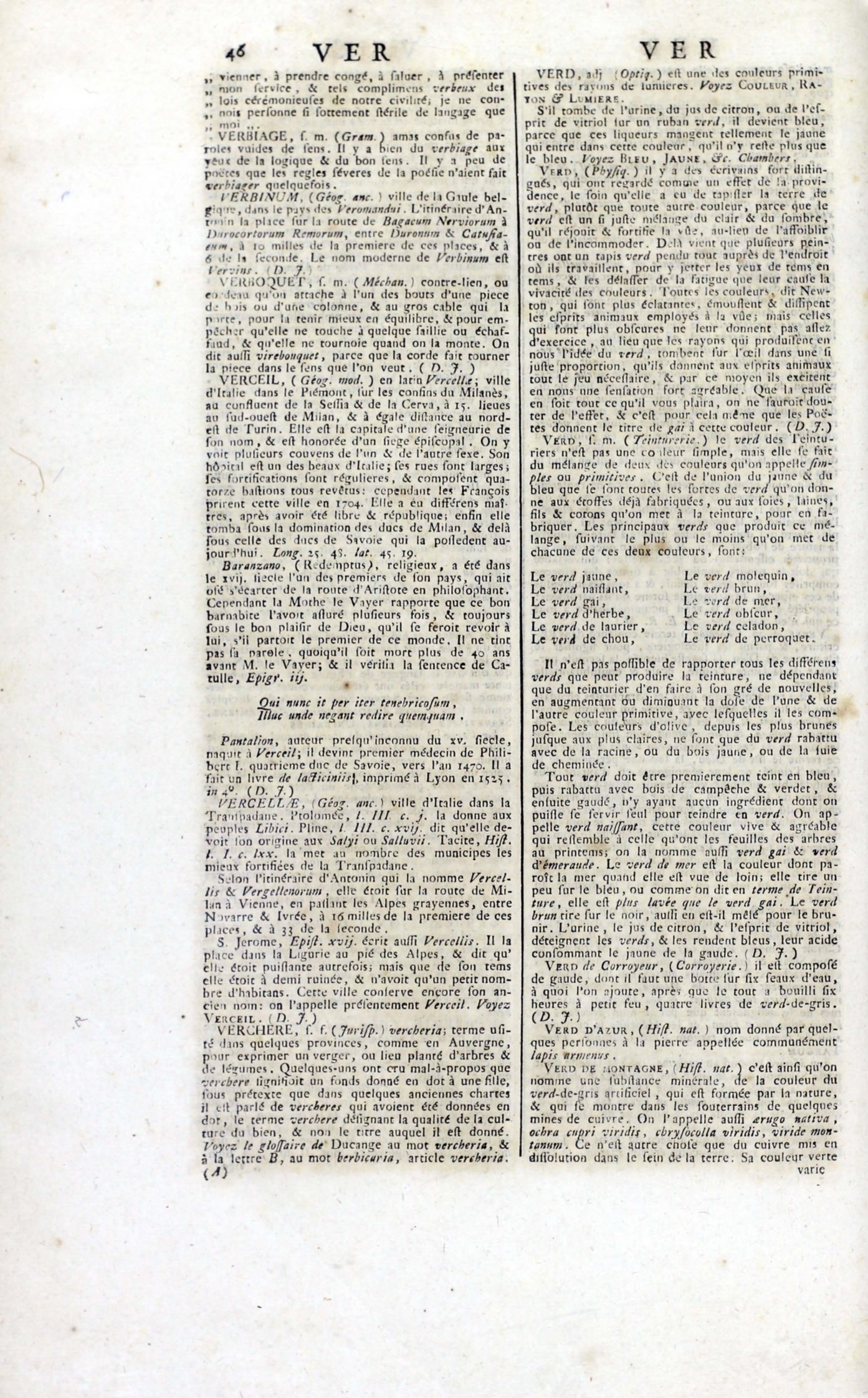
.?:-
VER
'
Y IC:O
~r
,
a
pr~odre C'Ong~,
f.1f
r
1
~ f'rl!f~nter
., 1'\1 O
(._.r
ÍC'e ,
&
teJ
ompJim,·n
':."trP(II.Y
des
" lois wémonieufes rle oot re civdlté¡
jc:
ne con·
~·
nni s perfonne G fo rtemenr flérile de bn
J
e que
u rnoi
., .
ERH
1
E,
f.
m.
(
Gr11m.
)
a
m
s
confus de pa-
Je
v
ides de feo .
Il
y a bten du
·ubiagt
au~
U(
de la fO .. ·'IqUe
&
du bon fen
.
ll
·
:1
peu de
pn~c
5
que le
re les féveres ue 13 pot'lie n'aient fait
"·rrbia(tr
quelquefois.
I 'E
RBINUM ,
(G¿o_!. •nc.
villc efe
l.t
Gtule bd–
g i
• ::
1
d.tnle
J'JY'
tfe
V rriJI/Jandui.
L' itinérJire d' An–
r rq
ll
1;¡
ltCC fur 1.1
route de
8fi_({DC/If/J
'~"
ÍOrllln
a
1
·¡rocortorum Rrmorum,
entre
Vuro11mn
&
CatNjia–
t
,, .
.)
1o
mil
le
dt:
la premiere de ce piJces'
&
a
d..: 11
fc:con le. Le nom moderne de
Vrrbinum
efl
f
a:·ÍIII.
D.
J .
j
\ '
~ RI
• UET,
f.
01.
(
Mhhan.)
cooere-lien, ou
e >
..:1
q·1'un arc:1che
l' un des bours d'une piece
d..:
h
)j~
ou d'uroc col nne,
&
au
~ros
cable qui
1.t
r
lf'[C:
'
pou r 1· tenir mie ux en éqUJiibre,
&
pour em–
p ~
h
· r
qu'ell~
ne rouche
;¡
quelque faillie ou
éch:~f
fJ u ,
&
qn'elle oc rournoie quand on la monte. On
dir auiii
virtbouqurt,
paree que la carde fa ie tourner
la r>iece darJS le
r ...
ns que l'on veue. (
n. J.
)
VERCEIL,
( Grog. mod.)
en
latinf/ercel/.e;
ville
d'ltJi ie daos le P1émon.r, l'ur les confins du Milam!s,
Rll
confluene de la Sel1¡a
&
de la Cerva,
a
I).
licues
au Cud-ouefl de Mlian,
&
a
égale di!tance au nord–
ell cie Turin. Elle efl 1:1 capi cal e ci'une l'eigneurie de
fi
n nom
1
&
efl honorée d'un fi cge
~pi(.cupal
. On
y
vnic
plulieurs couvens de l'un
&
d.!
l'aucre texe. Son
htn ic31 c:ll un des beaux d'lrJiie; fes rues fonr larges¡
fe
furcificacions tone
ré~ulieres,
&
C'Ompofene qua–
rorze ballions tous
rev~cus:
ccpemi:Jnt
le:~
Fcancois
pnren t ('CCCe ville en
1704·
Elle a éu diffé'ren'S
mai·
tres,
apre~
avoir
~té
libre
&
r~publique;
en fin elle
tomba ro,ts la dominacion des ducs de Mdan,
&
del
a
fou s ceJie
d~s
liCS
de
S~voie
qui la pofledent
3U·
joud'h ui.
long.
le¡.
4 ~·
lot.
4) ·
19.
Bor11nzano,
( R demptus), rcligieux, a écé daos
le xvij. ti ele !'un des premiers de ron pays, qui aie
ol~
s'écarter de la roure d' Arillore en philolophanr.
Cependane
Id
Moch e le Vayer rapporre que
ce
bon
b arnabice
l'avo1r afluré plufieurs fois,
&
roujours
fous le bon plailir de D ie u, qu'il re feroir revoir
~
Jui,
'il parroit le premier de ce monde.
ll
ne ti oe
pas
fa
oarele. quoiqu'il foir mure plus de
-40
ans
avant M. le Vayer;
&
il ve'rili:t
la fenrence de Ca-
tulle,
Epig1'.
iij.
·,
Qui
nunc
it
p~r
iter
t~nebricofom
1
Jlluc
tmde
~~~gant
redirr
qu~f/1<[114111
,
Pnntalion,
allteur prelqu' inconnu du xv.
fiecle,
n:~q ~Jit
a
v~rctil;
il devine premicr médecin de Phiti–
h<:rr
l.
qu:~rri eme
duc de
Savoie~
vers l'an
1470.
11 a
f:tit un ftvre
de
lnfliciniisl,
imprimé
a
~yon
CII .Ip.),
in
-fu.
(D. } .
)
VERCELLIE, (
Géog. tmc.
l ville d'Tulie daos la
Tranl ·pauane. Pcoloméc, /.
111.
c.
j.
la donne aux
peuph>s
Libici.
Pline,
l.
/11.
c. xvij.
die
qu'~lle
de–
voi
Ion ongine nux
Sa~yi
ou
Salluvii .
Taciee,
Hifl.
1. J.
c.
lxx.
la ·mee au nornbrc de municipes les
miem forrifiees cie
1:1
Tr:lllrp:~danc .
d on l'icinéraire d' Antonio qui la nomme
Vncei–
JiJ
&
Vergellc110i'IIIIJ
, ell-e
~roie
fur la route de Mi–
l ~ n
a
Vicnne, en pJII:we les Al pes grayennes, entre
N ll'arre
&
Ivrée,
ii
16
milles de !J premiere de ces
pl dces,
&
ii
33 de la lecondc .
S . J erome,
Epifl.
xvij.
écrit aufli
1/ercc/ii.-.
Il la
p lace dJns la L1gurie au pié des Alpes,
&
dit qu'
el!.:
~roir
puillanre aurn:fois; mais que cie fon rems
elle
~toic
a
demi ruinée,
&
n'avoit qu'un petit nom–
bre d' h:tbicans. Cerro;: vil fe conlerve en(:ore fon an–
cien nom: on 1':1ppelle prélenrement
J7~rccil.
Vo_yez
\
.E R EIL.
( D . ] . )
ERCHERE,
f.
f.
(Jurij'p.
l
vtrcheria;
terme uíi–
t.! d.t ns quelques provinccs
1
comme ·en Auvergne,
p nu r ex primer un ve rger, ou lieu
f>lanr~
d'arbres
&
d<' Jé:;umes. Quelques-uns one
C'I'U
mal-:1-propos que
?t'l't'bere
ti gni ti<Ji t un
f¡
nds donné en dora une f!Jle,
fous prérexce que dans quelques ancieunes charres
il
tlt parlé de
vrrcb~res
qui avoíenr
~cé
données en
d n , le rerme
-::erchere
d¿frgnanr la qualirt de la cul- ·
w rc
du bien
1
&
non le mre auquel il efl donné .
l/o_ycz
/~
gloj[ai;c dt
Duca':lge _au mot
tJtrcheri•,.
&
a
la lenre
B
1
au mor
babmn·1n,
article
wuhtna.
(A)
VER
\
RO , , ,
j
' Optiq.)
fl
unl' d
s
e ult>urs primi·
ti es
de
rJylll)
dc:
lunucrc .
Voye~
e
ULEVR'
RA–
Y\H-1
&
L L
MI.ERE.
S'il r mbe de l'urine, du
ju~
de ci tron,
u de 1'
f..
pri t de
itrio! lur un ruban
~·
r.l,
il d •viene blcu,
p:~rcc
que ces liqueurs mn n!!enr rellemcnr le jaune
qui entre dan
cecee couleur ,
qu'il o'·
retk plus que
le bleu.
o_yez
Bu:
u
1
jAU·
r ,
&c.
Cbambrrs.
\ FRO, (
Plyjiq.)
il
a dc:s
é~·riva1n
fort ilitlin-
ga~s,
qui onc
n•!!3rd~
com01e uu
dfo::t de !:t -pro i–
dence, le
(o
in qu'clle a
u de
t~
•
f1
er
13
e
erre
de
wrd
1
plutór que cauce aucre couleur, paree que le
wrd
ell un li julle mél:tnCTe du ci:Jir
&
du
(omhre,
qu'tl réjourt
&
forcil'ie
1:1
va ~ .
an -lie\1 de l'affoiblir
oa de l'lncommoder.
D .-l.\
viene que plufieurs pein- .
eres OlJt un tapis
erd
pendu rout aupn! de l'endroie
ol) ils travailknt, pour
y
jerrcr le
yeu x de rem en
rems,
&
les
délatTer de '" f:ttigue que leur caul'e la
vivacic~
des couleurs. Tour
s
k
couleur•. die
N
w –
ron' qui
tone
rlu
~clac;~nrc•.
émuu flent
&
dillipent
les cfprits aninJJux employ¿
a
la vOe ¡ tnais celles
qui fonr plu s obrcures nc
lenr <fonnene pas
:~flez
d'exercice , au lieu que
les
r;1y ons qui produit"Cnr en ·
nou's l'idée du
t·erd,
tombenc rur l'a: il dans une li
julle proportiun, qn'ils donnC'nt an
ei'pri cs
:~nimaux
rout le
J
u
oécefl:Jire
1
&
par ce
nJO}'Cil
ils exéirent
en nous une fenracion
forr :I!!réable . Que l.t
aure
en f'Oir rour ce qu'il
ous pldl ra
1
on nc lauro:r dou–
eer de l'efret,
&
c'ell pour cela m<!'Tle que
le~
Poc·
tes i:lonnenr le titre de
gni
a
cetre couleur. (
D,
J.)
VEri.o,
t:
m.
( T cin flrui ,· . )
le
wrd
de T eincu–
riers
'l'e!l
pas un e
e
o tleu r limpie, m:t is elle fe f:tit
du mélange de deux d · couleurs qn'on
:~ pp e llc
jim–
plu
ou
primitiveJ· .
C'ell de l'union du jHJne e du
bleu que
fe fonr
coure~
les torres de
wrd
qu'on don-
' ne aux
~roffes
déja fabriquécs, ou aux !oic ,
lainc~ ,
fils
&
corons qn'on mee
a
1 ~
rcinrure, pour en fa–
briquer . Les princip3ux
wrds
que produic ce mé–
lange, fuivanc
fe plus ou le moins qu'on mee de
chacune de ces deux couleurs, ronr:
'
Le
wrtl
janne ,
Le
vtrd
naifl~nt,
Le
v~rd
g-ai,
Le
verá
a•herbe,
Le
'IJcrd
de laurier,
Le
wrtl
de ehou,
Le
'l.:crd
m~lcquin.
Le
'l.'ertl
brun,
Le
•.:.:rd
de mcr,
Le
'r:crd
ob!cur,
Le
verd
celadon,
Le
verd
de
perroqt:~er .
ll
.n'ell p:ts pelfible de rapporrer rous
les
difféi·en~
wrds
qóe peur produire la reinrure, ne dépendant
que du reinrurier d'en fairc
a
fon gré de nouvellesl
en augmentant Óu ciimiouanr la doíe de !'une
&
de
l'autre coulcnr primirive
1
avec
lefquell~s
il. les com–
pofe. Les coule\Jrs d'olive, depuis les plus brunés
jnfque aux plus .claires, ne rc)IJt que du
wrd
raha'rtu
avec de la racine , oú du bois jaune
1
on de la fui e
de cheminée.
Tout
tJerd
doit
~ere
prenJierement icínt en bleu ·,
puis rab:utu avec bois de campeche
&
verdee,
&
enluice gaudé,
n'y
ayane aucun ingrédienr donr on
puille fe fervir f'enl pour reindre en
verd.
On ap–
pelle
verd
naijfl111t,
cerce couleur vi've
&
agréab!e
qui reflemble
a
cclle qu'onr les feuilles des arbres
au printems; on la nomme aufli
verd gai
&
'ttrd
d'émerallt!e.
Le
"Jerd
dt mcr
etl' la couleur done pa–
roic la mer quand elle ..:ll vue de loin; elle tire un
pe u fur le bleu, ou comme·on die en
urm~
de Tein–
ture,
elle ell
plus
lavre
q11e
le
v.erd gai.
·Le
v~rd
brtm
tire rur le noir, autli eu efl-il
m~lé
pour le bru·
nir. L'urine, le jus de cirron
1
&
l'efprit de vitriol,
déteignent les
verás,
&
les rendent bleus, leur acide
conrommane le jau ne <le
la gaudc.
( D.
J.)
V
~[1,
o
de
Corroyeur,
(
Corroyerie .)
il
en
comporé
de gaude ' done
il
fa ue une boice rur fi x feaux d'eau,
a quoi l'on njo ure
1
apre> guc le tour a bouilli tix
líeures
il
pecit fcu
1
lJU"' tre livres de wrr/-de·gris.
(D.
J.
J
Vuo n'A zuR, (
Hift.
nflt. )
rrom donné
p:~r
quel–
.que~
perfonncs
a
la pierre appellée
comrn~nérnent
lapu armenus
.
. ·
VERD
Df:
r.t~NT AGNE,
(Hift .
11at. )
c'ell ainfi qli
1
on
nomme une 1ubllancc.-
rninérafe
1
de la couleur du
verd-de-gns
arc ificiel , qui ell formé.e par
1:~
nJture,
&
qui
fe
mon~re
dans les roucerrain5 de quelqu es
mines de cuívre, On l' appelle auffi
.er11go
tJntiva
1
o,·hra c11pri ".Jiritli.r , cbryjocolla vlridis, viride
111011·
tan11m.
Ce n'ell :¡ uere chot'e que du cuivre m1s en
SJfiolution dan
le fein de la terrc . Sa couleqr verre
vane
















