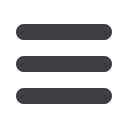
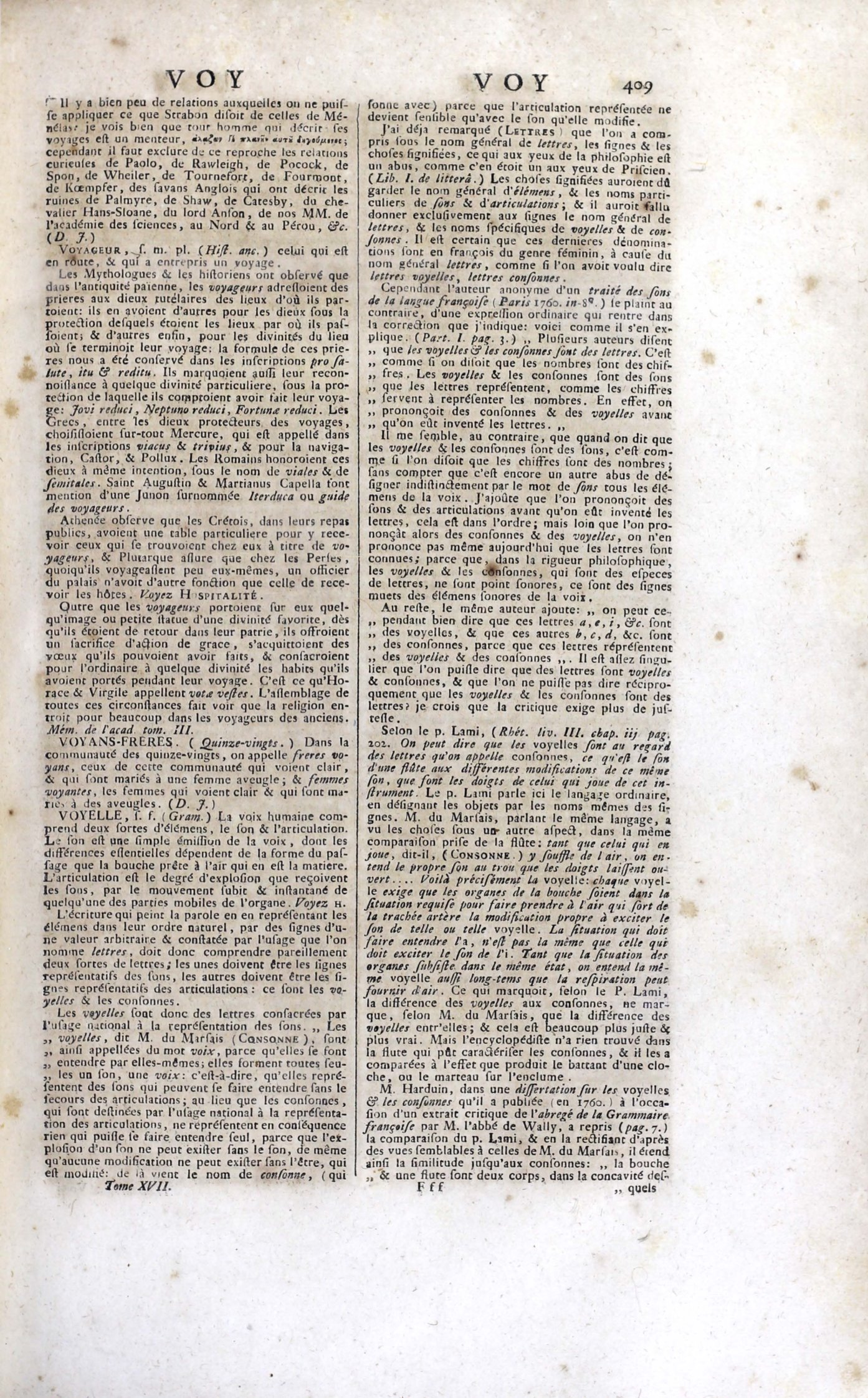
VOY
r'-
ll
y
a
bien pe.u de relations auxqueile5 on ne puif–
fe
appliquer ce que Scrabon difoit de celles de Mé–
néla~:
je vois b1en que
rour ho rnme
qui décrir · fes
voyages efi: un menreur,
&~.~.,, r~
.."•••·
auTv
l.,.~P'"';
cependanr
ji
faur exclure d • ce reproche les re l.t rJons
curieu{es de Paolo,
de
Rawleigh, de Pocock, de
Spon, de Wheiler, de
Toutnefo,r~,
de Fourruoot,
de Kcempfer, des íavans Anglois qui ont décrit le_s
ruines de Palmyre, de Shaw, de Caresby, du
che–
vaiier Hans-Sioane, du lord Anfon, de nos
~M.
de
l'acldémie des !Ciences, au Nord
~
au Pérqu
1
&c.
(D.
J.)
VoYA(>EUR ,
..
f.
01.
pi. .(
Hif/.
af1c.
)
celui qui eft
en
r~ute ,
&
qlll a entrepris un .Yoyage.
Les .\1ytholog ues &
l ~.s
hifl:oriens oot obfe,rvé qu.e
dans l'anciquic¿ pa·ieoóe, les
'Pf!'Y4gfi!Tf
adrefioient des
prieres aux dieux
~uc~laires
des li.eux
d'o~
ils
p¡¡r–
toienc: ils en lJVQienr d'aurres pou.r Jes dieux íous la
proceélion defquels étoient les lieux par ot)
i~s
paf–
foient; & d'aurres eo6n, pour
le~
di,vinit,és du Jie¡.J
ot't
fe termin'oit leur ,vqyage: la forl)'lule de ces prie–
res nous a éré coofervé daos les jnícripcions
pro
.fa–
tute, itu
&
retfitt~.
I.ls . ~¡ar1
quqj~nt
.íluffi leur re·coo–
noiOaoce
a
quelque
diVI OI.tépartiCUIJere, fous la
pro~
teétion de laquelle il
s CQfl'lptoieot avoir fait leur voya–
ge:
Jovi ru!r1ci, JYepttmo reduci, f'ort11n.e
~·edt~ci. ~es
Grecs , . entre les aieux proteéleurs. des voyages,
~hoifi.Ooieot
fur-tout Mercure, qui
efl appellé daos
les infcríptlons
JJiaCfl!
&
trÍfJÍtlf,
&
po.urla naviga–
tion, Caflor,
~
Pollux, Les RomaiJ
Jshonoroien~
ces
dieux
a
m~
me intention' fous le nom de
viales
& <le
fimitllle.r.
~ainc
l}.uguflio & 1\'lartianus Ca pella
f~nt
m enrion d'une
juno~J furnorptn~e
lterduca
QU
gmd~
{les voyageurs.
~thenée
obíerve que les Crétois, dans leurs repas
publics, avoient \)ne cable particulic;re pour
y
rece–
'Voir ceux qui fe crouvoicor d¡ez eu"
a
ticre de
vo•
yaget~rf.
&!.
Plutarque aflure
que
chez lea Perft:.s ,
<¡uoiqu'ils voyageaflent pe u eu¡;-memes, un officu:r
du palais n'avoit d'autre fonébon que
cell~
de
rec~voir les hOte$.
"0Jyez
H
>SPITALITÉ.
Qutre qne les
v.o¡y¡zgeur.~·
portoient
fur eux quel–
qu'image ou petire ·nacue d'une di lo'i nité favorite, .des
qu'ils étoient de retour dans leur patrie, ils offrou:nt
un
íacrific~
d'
.Iélion de grace ,
s'acquictoi.eot des
vreu~
qu'ils ponvqient ¡¡voir fairs,
&
¡:onfa"Croie~t
pqur !'ordinaire
a
quelque diviqité
l~s
babits
~u'lls
avoient portés per.!dant leur voyage.
C'ell:
ce qu Ho–
ra
ce & Virgile appellenr
vot.e vejles.
L':tfiemblage de
toures ces circpn{\ances fait voir que la religion eo–
troi~
pqur beaucoup dans les voy.ageurs de5 ancien$.
1
Mhn.
de J'acad. tu111.
Il/.
· VOY.
ANS-FRERE~.
(
Quinze-vingts.
)
Dans la
co rwuun11uté des quinze·vingts, on app
elle freres 'llp–
"-ans,
ceux de c:;erce communauté qui
voiP.otel
air,
&
qui íont
m~riés
a
une femme aveu
gle; & fe.mme.s
~oya11tn,
les femmes qui voient clair
&
qui font ma·
t•e,'
a
des aveugles.
(D.
J.
l
VOYELLE,
f.
f. (
Gram..)
-La v·qix QU!llaioe com·
prend
deq~
íortes d'élémens ,
1~
fon & t:articulatioo.
L e ton ell pqe limpie émiffiqn de la vo1" , done les
ditférenues eflentielles dépendent de la forme du paí–
fage que la bquche prche
~
l'aír qui en ellla matiere.
L'arriculation efl: le degré d'explofioo que re<;oiv.ent
les fons, par
1~
mouvement fubit
&
inflantané de
<JUelqu'une des parcies mobiles de l'organe.
17oyez
H.
L'écricure qQi peine la p.arole en
en repréfentánt les
élémens dans leur ordre
aarur~l,
p.ardes lignes d'.u–
ne valeur arbitraine
&
conllatée
par i'uíage que l'on
nomrne
lettres,
doit done comprendre pareillement
deQx forres de lettl"es; les unes doivent tcre les lignes
reprtH'enrarifs des funs, les autres doivenc
~ere
les
fi–
gn
s
repréfentacifs des ar.tic.lilations: ce font les
'{IQ.–
'elies
&
les .confonnes.
Les
v•y el/u
foat done des le.ttres confacrées pa.r
l'u fage
o.o~riqnal
a
la
(epréfentation rles fons . , Les
,
wyelles'
die
M .
du M arfais ( Ca.NSQ,NNE ) • fo l\t
~·
ainli appellées du mot
voix,
paree qu 'elles fe font
, encendre pl\r
el1es-m~mes;
elles fo n nent
toute~
feu–
,, les un fon, une
vo~x:
c'efi:-3.-dire, qu'ell es repré–
fentent des íons qui peuvent íe faire eritlendre fans le
fecours
de~
a.niculacians;
a.
u . lieu
q.ueles confonoes ,
qui íont dell:ioées par l'ufage
na~i
ona la
la rep.réfenta–
tion des arriculations , ne répréfentent en
coo(~quenée
ríen qui puifle
re
faire. encendre íeul' paree que l'et–
plo~on·
d' un fon ne peut exiil:er fans le fon, de meme
qo'aucuoe modification. ne peut exi(ler fam l'c!cre, qui
efi: moJtlié: de
a
v1 ent le nom de
eon{onn~,
(
qui
't'tJme
XVJ{.
VOY
4G9
(ooue
avec-) pa ree que l'arriculation repréfencée ne
deviene feolible qu'avec le fon qu'olle modifie.
J'ai déja
remarqué ( Lnrus
l
que
l' on a com–
pris (ou s
1~
?om
géné.ral de
lettres,
le5 fi gnes
&
les
chafes figmfiees, ce qut aux ;yeux de la phflofophie e!l
un abus, eomme e' en éroir un aux yeux de Priícien.
(Lib.
/.
de littertÍ.)
Les cbofes fignifiées auro1enc d'd
gar~er
le nom
génér~l d:élém~ns,
&
l~s
noms parri–
cullers de
.fo11s
&
d
t¡~rttculatlons;
&
JI
auroit fallu
donner ext:lu(lvemel)t aux (ignes le nom général de
lettres,
~
les nQms fpécitiques de
'!JOyel/es
&
de
con·
jot¡nes.
ll
e!l:
certain qu e ces dernieres dénomina–
tions font en
fra n.~ois
du genre féminin'
a
ca ure dtt
norn généra l
lettrN,
comme
fi
l'on avoit voulu dire
/,e
tres
voyeile.r, iettres con.fonnes
.
Ce pendant l'auce_ur
a no1~yme d'~n
traité des
j01u
tle
!11
la11gt1e ftanfoifi ( Paru 1760. tn-8<1 . ) (e
pl ain r au
concraíre, d'une ex:preffion ordinaire qu1 rentre daos
la corr.eélion que j'indique: voiei comme il s"en
ex~
plique. (
Pa:rt.
/ .
pa(.
3·~
, Plulieurs auteurs difenc
, que
les
voyelles& ·l~s conflnnesflt~t
des /ettres.
C'efl:
" comme li
011
difoit que les nombres Íont des
chif~
,
fre~
.. Les
'lloyeltes
& les coníonnes .íont des fons
,~;
qQe Jes lettres rept:éfencent, comme les chiffres
.. ferve•¡t
a
repréíenter le.s nombres. En effet'
Of\
, pronon<Joic des confonnes & des
voyelies
avant
, qu'on eut inventé les lettres ...
ll
rne
f~Q)ble,
au con.traire, que quand on dit que
les
voyelles
~
les conftorllles íonr des fons, c'e!l com-
11}_e
fi
l~pn
difoit que l<!s chiffres font des nombres
t
íaos compter que c'efi: encqre uo aurre abus de dé–
ligner indiflin4ément p:¡.r le mot de
flns
tous les
él~mem de la voix . J'ajoute que l'on
pronoo~oit
des
fons
&
des articularions avant qu'on edt invente les
lettre~,
cela e!l daos l'ordre
¡
mais loio que l'on pro–
non<Jar alors des confonnes
&.
des
voyeJ/es,
on n'en
prqnonce pas
m~me
aujourd'hui que les lei:tres íqnt
connues; paree que, daos la rigu'eur philofophique,
les
voyelles
&
les
fonnes, qui font des efpeces
de letcres, ne íont poinr fonores, ce íont des lignes
rpuets des
élémen~
íonores de la voix ,
Au refi:e, le meme autellr ajoute: , on peur ce–
!'
pendant bien di re que ces le erres
a,
t,
i,
&c.
fonr
, des voyelles, & que ces autres
b,
e,
d,
&c. íont
,, des confonnes, paree que ces lec eres rópréfentent'
, des
voyelie.s
& des cooíonnes , .
Il
efl: aOez
lin~u
lier que l'on puifle dire que des lettres font
'!Joye/les
& coníonnes, & que l'on· ne puifle pas dire récipro–
quemenr que les
voy.ellu
& les confonnes' íont des
lettres
~
je- erais que la critique exige plus de juf-
relte.
·
.
Seton le p.
L~mi,
(
B.hét. li'V.
111.
cbap..
iij/
pag:
102..
On petlt
dtr~
r¡ue.
les voyelles
flnt au re{arll
des lettres qu'on
appetle.
confonn.es,
ce qu'efi
¡.,
{ot~
(l'rme flate attx.
d~ffé!ent
es modifi~·at~on_s
de ce
mh»t
(on, que. font les dotgts
tk
celttt qtil JOIIe de cet in–
flrument .
Le
p.
Lami parle ici le ·tant{a¡.{e ordrnaire,
en délignanr les objets par les noms
m~mes
d es
fi–
goes .
.M.
du .Marfais, p:klant le m
eme
langage'
a
vu les c!lofes fous ua- autre afpeél, daos la meme
compáraiíon prife de la ' flOte;
tant qtle celui qtú en
joue,
dir-il,
~
CoNSONNE . )
y fluffte
d~
1air,
fJII
m·
tmd le.
propr~
jQ11
au trou cp1e le.s doigts laiffmt ou.J.
vert ....
Poi/~
préciflmmt
/.a
v.oyelle:
chalf'l~
voyel–
le
exig~
que les organu
dt
la bouch.e fi.ient
dr~ns
111
.fi.tuation requi{e pour fair.e prendrc
a
,.
air qpi fort
d~
/11
tr11chh artere la modi/icfition propre
a
exciter le
fon
de
te/le ou te/le
voyelle.
La .fitulltion qui doit
(aire entendre
J'a,
tJ"efl pas la mémr: que u/le qui:
·
doit exciter le fin de
/'i.
-¡:ant q11e la jituation du
orglln.tsjit/ljifle. dans le m;me état, on
e~Je"f'
la mé–
fl'C... voyelle
au(Ji long-tems q11e. la rejptoJ<&teon pe11t.
fourn,ir d! air.
Ce qui marqupic, felon
le P. L ami,
la différence des
vo:yel/es
aux confonnes,
tte
mar~
que, felon
M.
du Marfais, qué la différence des
fllyellu
entr'elles; & cel3 efi: beaucoup plus juíle
~
plus vrai. Mais l'encyclopédille n'a rien tl!ouvé <hns
la flute qui pdt caraaérifer les confonnes'
&.
il les a
comparées
a
l'effet que produit
le
b_attant d'une cto..
che, ou le marcea u fur l'enclume .
M;.
Harduin, dans. une
d-iffirtation ji1r ler;
voyelles.
&
les confonnu
qu'il a publfée ( en
1760. )
a
l'occa–
fi on d'un extrait critique de
1'
a,breg¿ de
/11
Grammaire.
fra11f'ift
par M. l'abbé de Wally, a repris
(pag.
7·)
la comparaifon dup. l..!mi, & en la reélifiam d'apres
des vues íemblables
a
celles de M. du M.arfa b , il érend
.Jlirlfi la limilicude jaígu'aux confonnes:
,
la bouche
,.· & une fl.ute font deux corps, daos l.a
con
ca vi té
d~["
-
~
ff
-
,
quets
•
















