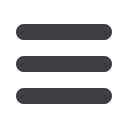
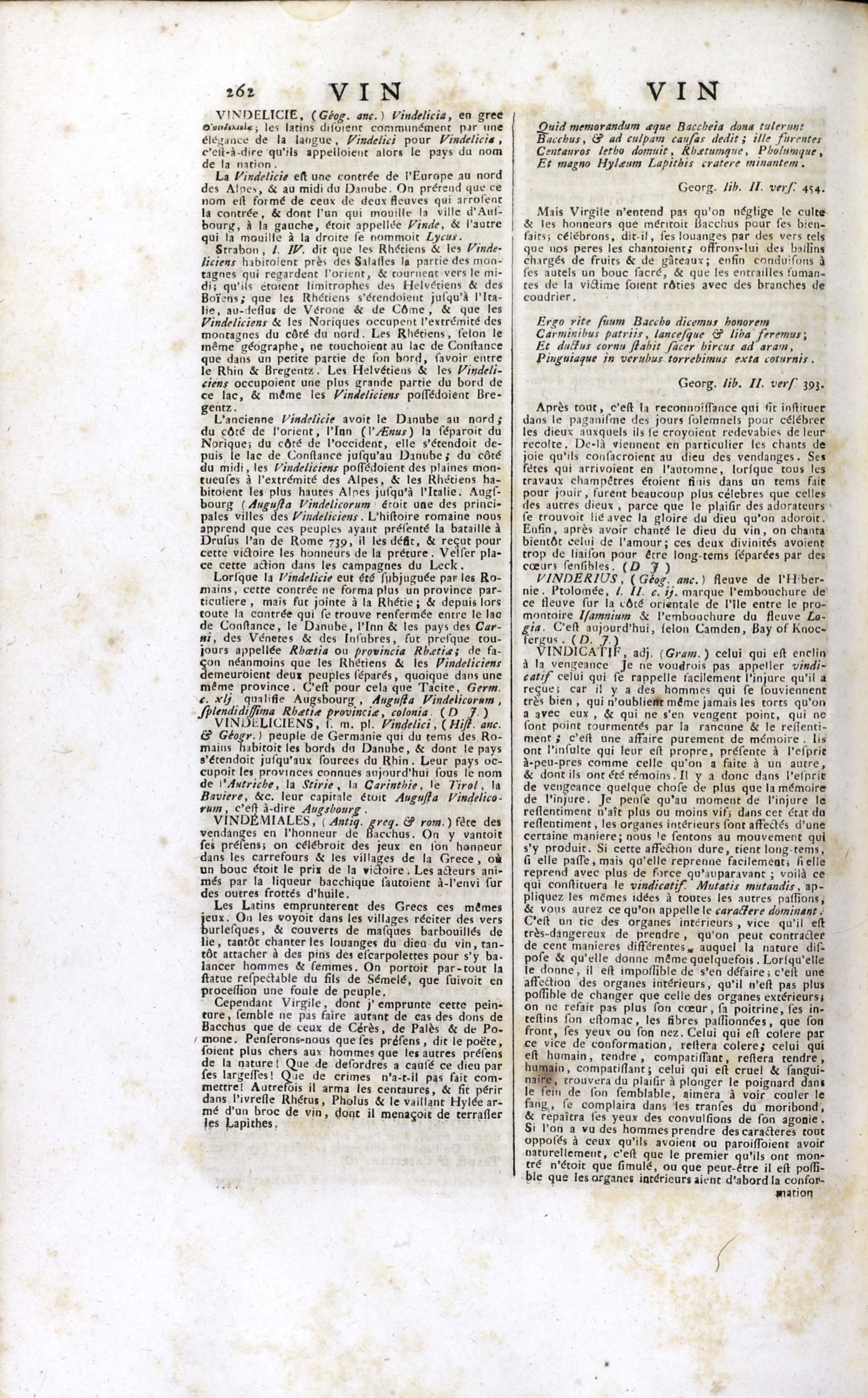
/
• 1
VIN
V ! DELICIE,
(Géog. onc. ) Vindtlicia
1
en
gree
o·u.,l•~•"l~;
les latins difoienr communémen r pJr une
élé11ance de
la
laoa ue,
f/indeliú
pour
Vindelici6,
c'ell· a-dire --qu'ils appelloieur alors le pays du nom
de la narion .
La
1/indelicit
en: une conrrée de I'Europe .a u nord
des Aloes
&
au mi di du
Da
nu be .
Oo
prérend que ce
nom eÍl
f~rmé
de ceu-x de deux fi euves qui
arro f'eo~
la conrrée,
&
done l' lln qui mou ill e
!a
ville
~·
Alll–
bourg ,
a
la gauche, étoir appe ll ée
~mde,
&
1
autre
qui la mou il le
a
la droire fe nommolt
Lyt'IIJ'.
.
Strabon ,
J.
IV.
dit que les Rhétiens
&_
les
Vtnde·
ticiens
habíro ienc prt!s des SaJ¡¡lles
111
parne des
mo~tagne s qui regar dent l'ori ent, & wuruent _vers le m1·
di; qu'ils étoient limitrophes de s
Hel-v~tJens
&
des
-Bolens ; que les Rh érie ns s'étendoi eut )ufqu'a l' lta–
lie
au-de flu& de
V
érone
&
de Cóme ,
&
que les
Vi~deliciens
&
les Noriques occupen t l'exrrémité des
moncagnes du
c~ré
do nonJ . Les E,héciens, felon le
m~me
géógraphe, ne rouchoieor
a
u la e de (:onllance
que dans un perite parcie de fon bor9, favoir .enrr_e
le Rhin
&
Bregenrz. Les Helvétiens
&
les
Vmdt/J–
&Íens
occupoienr une plus grande parrie du bord de
ce lac,
&
me!
me
les
Vintieliciens
poífédoient Bre·
gentz.
L'and~nne
Víndelicit
avoit
le Danube au nord;
du córé de l' orient, l'lnn (
1'./Enus)
la féparoit du
Nor ique; du córé de l'occident, elle s'étendoit de–
puis le la
e
de Con llanee jufqu'au Danube
¡
du coté
du midi, tes
Vindeiíoitns
poífédoient des plaines mon–
tueufes
a
l'extrémité des Alpes,
&
les Rhétiens ha–
bitoient 'tes plus ha ures Al r es jufqu'a l'lcalie. Augf·
bourg
(
At~gtif/a
Vindeiicorum
1
écoit une des pri11ci·
pales villes des
f/i¡zdeiiciens .
L'hilloire romaine nous
apprend que ces peupl es ayaut préfenté la baraille
a
Drufus l'an de Rome
739,
il
ks déftt,
&
rec;ur pour
cette viéloire les honneurs de la précure. Velfer pla–
ce cette aélion dans
les
campagnes du Leck.
Lorlque la
Vindeiide
eut
~t~
l1-1bjuguée pal' les
Ro–
mains, cerre contrée ne forma plus un province par–
ticuliere ,
mai~
t'ut jointe
a
la Rhérie;
&
depuis lors
toare la contrée qui fe crouve renfermée entre le tao
de Con llanee, le Dan
u
be, l'lnn
&
les pays des
Car–
Hi,
des Véneres
&
des [n fu bres, fot pre!'que rou–
jours appellée
Rha:tia
o u
pr()flincia
~b.etit~;
ele fa–
c;on néanmoins que les Rhériens
&
les
Pi11fieiíciens
oemeuroient deUI peuples féparés, quoique dans une
mt!me province. C'ell pour cela que Tacite,
Germ.
e.
xlj
qual itie Augsbourg,
tft~gt1[ia
P.indtlicorNm,
fpitndidifl!ma ,Rh.ett.t f!Yovinci.e,
~oion~a.-
(D.] . )
'
V
INDELIClENS,
l.
m. pi.
Vu1(/el~et,
(
Hift. anc.
&
Géogy.)
peuple de Germanie qui du tems des Ro–
mains habiroir les bords dtl Dan ube,
&
done le pays
s'érendoit jufqu'aux fourees du Rhin. Leur pa--ys oc–
cupoit les prov1nces connues anjourd'hui fous le nom
de
1'
tfutriche,
la
Stirie,
la
Carinthie,
le
Tiro/,
la
Baviere,
&c. leur ca pirale éroit
Augtifja
f/imfelico–
rum,
~·etl-<1-dire
A t1gsbot1rg.
VlNDÉMIALES,
(
A1ztiq. greq.
&
rom . )
fece des
vendanges en l'honneur de Bac,;hus. On y vanroit
fe~
pré(ens; on célébroit des jeux en Ion hGnneur
daos les carrefours
&
les villages de la Grece , o.
un bouc étoit le pris de la Yiéloire \ Les aéleurs llni·
més pa r la
liqueur bacchique faucoient a-l'envi fur
des outres frottés d'huile.
Les Latins empruntereot des Grecs ces mc!mes
jeux : On les voyoit daos les villages réairer des •vers
1>urlefques,
~
couverrs de mafques barbouillés de –
-lie, tanrót chanter les
louange~
du dieú du vin, tan–
tót artacher
il
des píos des e(carpoleqes pour s'y ba–
Jancer hommes
&
fe
mmes. On portoit par- tour la
fiatue refpeéhble du fils de Sémelé, que fuivoit en
proceffion une foule de peuple.
.
Cependan r Virgile, dont j' emprunte eette pein·
ture, femble ne pas faire autant de <?as qrs dons de
Bacchus que de ceux de Ceres, de ·Pales
&
de Po.
1
mane.
Penferons~nous
que fes préfens, die le poere,
foient plus chers aux hommes que le& autres préféns
Qe la !!atore! Que
d~
defordres
a caufé ce dieu par
fes largeífes! Q ue de crimes n
'a-t.llp~s
fait com–
mettre! .1\.utr.efois il arma les ce
ntaures,
&
fit périr
dans ,l'ivrefle
Rh~ru_s,
Ph0lus
&
le
vail l~nt
J:--Iylée ar–
mé d un broc de vm , QOI}t
il
mena~oiE
de terrafler
J~s J,apit~es
1
-
-
·
·-·
' ·
VIN
Quid mtmorandum
t~que
Baccheia donfi tulerm;t
B acchus,
&
ad culpa''? caufizs dedit ; ille Jin'f'lttn
Cmtarwos /etho dormut,
ll.b~wmque, Pholt~mqut,
/!.t
magno Hyi.eum Lapitbis cratere minantem.
Georg.
Jib. JI.
wrf.
4'i-4·
Mais V irgile n'entend pas qu'on nég lige le cultct
&
les honneu rs que ménroit Uacchus po ur fes bien–
faits; cé lébroAs, dit-il, fe s louanges par ?es vers
r~ls
que nos peres les
chantoi~nr;
offrons-lu1
cles
_b~fhn~
chit rgés de fruirs
&
de garea ux ; enfin condu:fons
:J.
fes autels un bouc facré,
&
que les encra illes fu man–
ces de la viélime foient r&ries avec des bran ches
de
eoudrier ,
Ergo ritt
fimm
B.u.·ho dicemru honortt11
Carminibus pat1·iis, iancefl¡ue
&
liba firmuu;
Et du{/ru eornu ftabit .facer birctJS ad arom,
pj,;¡uiar¡tle i n verr1bus- torrehimus txta ,·owrnis.
Georg.
lib.
//.
ver{
393·
Apres tour, c'ell la recoonoiffance qui
flt
inflituer
daos le paga nifme des jours folemnels pou r célébrer
les
dieu x aux quels ils re croyoienr redevable-; de leur
recolte , De· la viennent
eh
parriculier les chants de
joie qu' ils con(acroient au dieu des vendanges. Ses
fétes qui arrivoient en
l'auromne, lorlque rous les
travau x cham o€tres éroienr tinis daos un rems fait
pour jouir , fÚrent beaucoup plus célebres que celles
des autres dieux , paree que le plaifir des adorareurs '
fe rrouvoi r lié avec la gloire du dieu qu'oll adoroit.
Enfin, apres avoir chancé le dieu du vio, on chanta
bienr6r .:elui de l'amour; ces deux divinités avo iene
trop de liaifon pour c!rre long-tems féparée5 par dei
ca:urs fenlibles.
(
D- '}
)
VJNDERJUS,
(
Géog. anc.)
fleuve de I'H:ber·
nie. Ptolomée, /.
/J.
c.
lj.
marque l'embouchure de
ce fleuve fur la l'Óté orientale de l'ile entre le pro–
monroil'e
l(amnium
&
l'embouchure du fleuve
Lo·
g_ia.
C'ell aujourd'hui,
{e
Ion Camden,
~Bay
of
Knoc~
fergu s .
(D .
J .)
VlNOlCATJF, adj.
(
G1•am.
~
celui qui ell
e~cli.o
a
la vengeance _ Je ne voutirois pas appell er
vtndt–
catif
celui qui fe rappelle t'acilement l'jnjure qu'il
a
rec;ue; car
i!
y.
a des
l:!ommes qui fe !ouviennent
tres bien , qui n' oublielft ml!me jamais les rorts qu'on
a avec eux ,
&
qui ne s'en vengent point, qu i ne
font point rourmentés par la
rancune
&
le reflenti–
ment ; c'ell une affaire purement de mémoire .
l is
ont l'infulte qui leur ell propre' préfente
a
l'e fp rit
a-peu-pres comme celle qu'on a faite a un amre,
&
donr ils onr été témoins.
11
y a done dans l'e fpri r
de
v~ng-ea nce
quelque chofe de plus que
la _~émoire
de l'm¡ure .
]e
penf'e qu'au moment de -t•ui¡ure le
r ellentiment n'aí't plus ou moins vif; daos cet
~tardo
reflentiment, les orga nes irHérieurs font affeél6 d'une
certaine m<J niere; nous le fentons au mou vement qui
s' y produir. Si certe atfeél-i on dure, tiene long-tems,
fi
elle paífe., mais qo'elle reprenne facilem eot;
li
elle
r\!prend avec plus de force qu'auparavant ; voila ce
qui confliruera le
vindicatif. MtJtatis mütandis,
ap–
pliquez les memes idées
a
toutes les aueres paffions'
&
VO \IS
1\urez ce qu' on appelle
le
caraflel'e domitl•nt
.•
C'ell un tic des organes intérieurs , vice qu'il etl
tres-dangereux de prendre , qu' on peut contraéleL'
de cene manieres difieren tes,. aoque( la narure d if–
poíe
&
qu'el le donne
m~me
quelquefois. Lorlqu'elle
le donne,
il
efl impoffible de s'en défaire ; c'ell une
·atreélion des organes inrérieurs, qu'il n' ell pas plus
poffihle de changer que celle des
organe~
extérieurs
¡
on ne refait pas plus fon ca:ur, fa poitrine, fes in–
tellins fo n ellomac, les libres paffionnées, que fon
front, fes yeult o u
lb!l
nez. Celui qui ell colere par
.ce vice _de conformation, refiera colere; celui qui
eft huma in, cendre, cornpatiffaot, refiera cendre,
hui'Qain , comparillani:
¡
celui qui ell cruel
&
fangui·
nai i"e . trouvera du plaifir
a
plonger le poignard danl
le fein de Ion fembl able , aimera
'a
voir couler le
f'ang
1 ,
~e
co_mplaira daos ·tes tranfes du moribond,
&
repa1tra les yeux des convulfions de fon agooie.
Si l' on a vu des hommes prendre des caraélere·s tour
oppoles a ceux qu'il s avoieni ou paroiífoienc avoir
naturellemeut, c'ell que le premier qu'ils ont
mon~
tré n'éroit que fimulé, ou que
peut-~tre
il ell poffi–
~~~
<¡ue les
or.gane~ int~rie urs
aie nt dlabord la co_nf-Ol'·
~~tlO'l
(
















