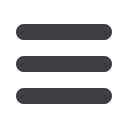
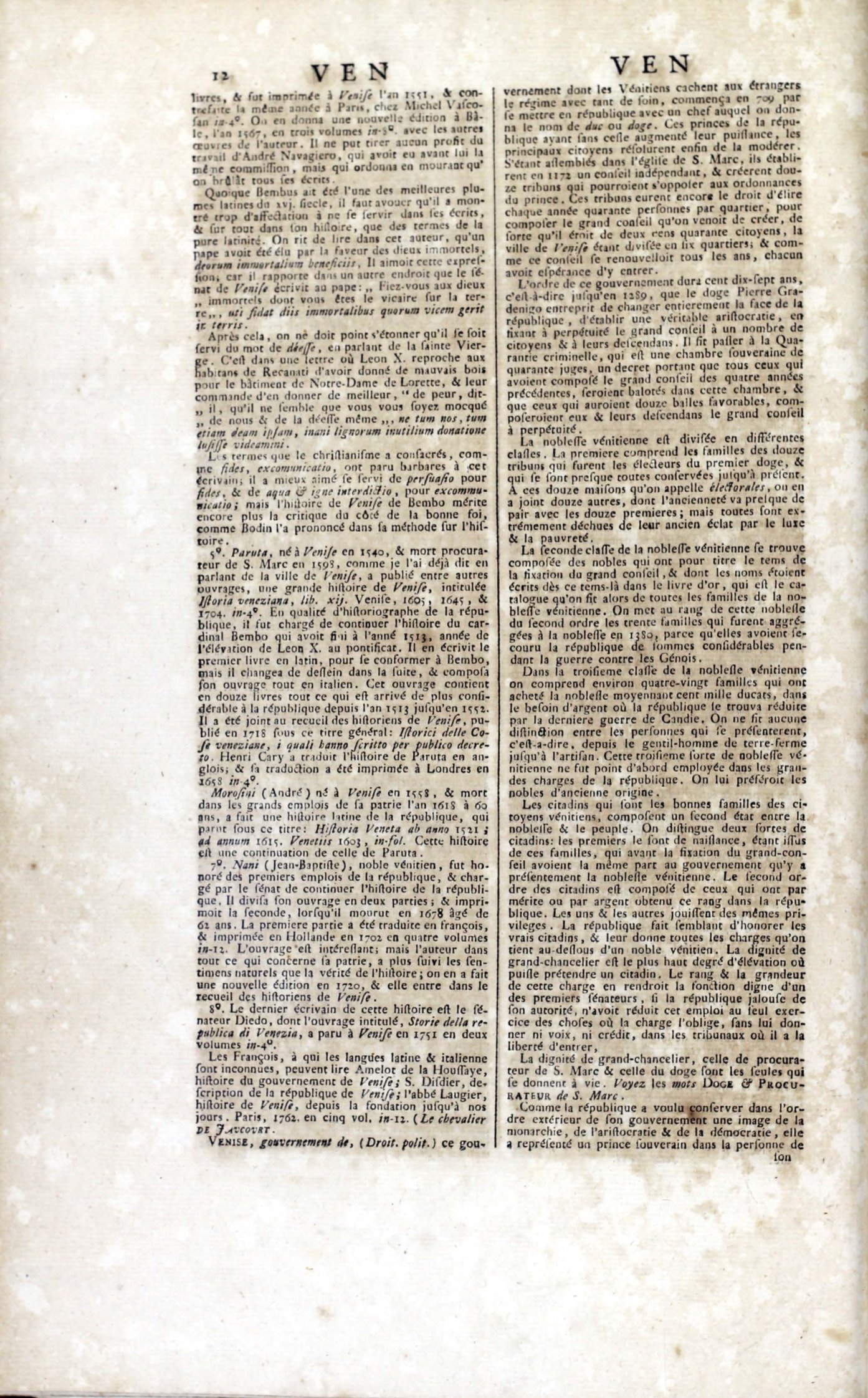
11.
E
i. le l
/'~
¡fi
1'•
con-
ann<'c
01
P:art , e
1
·.t ,
l•ch 1 \ ' Jlco-
d
nna une
11
o ·
11.
IU-
Ic ,
'an
r
:¡
-,
t:
ror
\'O
lome
i
·
.
e
1~
m
res
.:
1'
u
f'Ur.
11
ne put
u r r
u un pr fit Ju
t
,
rl
J' .,
r~
•
•a u:ro,
qui
¡
oi t e
• ant lm
IJ
l
ne e
mmrffion , m
q ui orJo nn
n
mour or qu'
o
'hr
t
too
fe
nu .
11o·que llembu
.. ,r
<'
~
l'u ne
de~
me1ll ore
plo–
me
1
unei
J
\
j.
fi
le, il
.JUt :.vo:a:r qu'!l
m~n-
t
~
era
d'a
.ui
11
a n
fe fe n •r r Jans le
écrr r ,
&
(or
root d n
ton htl1o rr:, que
d
•s
rerme de la
pure 1 rinrr '. On rir de !Jre thna cer aureur , qu'un
p p
:~voJt ~t
1~;~
par
l-1
rJ ..
eor d s di u
1m orrel _.
tltflrMm imru rtlll/lr'11
bmt
111,
11
rmorr cc:cre cxprc;_f·
j¡
,
cu ti
up
orte d
''
un urre
n ro1t que
1~
lé–
Dólt
de
Vtni(t
écrivtt ao
p
pe:, hct-vou
:10
dteux
rmmorc
1
dunr vou
lte
le VJCJire
fur la
ter·
~e ,
1
,ti
jid111
diis imf11(1rtii1Íblls
t¡tJOrllm
vium
t,tr;t
ir.
ttrris .
Apr
ce la
1
on !le doir point
~~éronnc r q~'il
le
~oit
fervi do m r de
du/Te,
n
p3 rlant ele la f.ttnre Vter–
ge.
; cll
d~n\
une 1errre ou Leon
X.
reproche aux
Ft
b1tanf de Reran.tti
el'
voi r donné de mauv¡is bois
p nr le
b~cim
ot de 1'ocre- Dame de Lorerte,
&
Jeor
c om 1nd e d'en donner de mei lleur, "
de
peor, di t–
., il , qu'il ne fc mhle que vous vous foyet mocqoé
1
de non
&
de
13
d
e(fe
m~me
, ,
tu
t11m
nos,
tufll
:ri11m
ltffnl Íf!/''!11
1
i11 11Í
lignorum Í1:utilit1m donlllÍ(IIIt
l11jijfo
Vldeam1111.
L
s
rerm e~
¡ut!
le chrifiianifme
:1
co ní1crés, com–
,ne
{idts,
cxcomtmicntio,
ont paro [)Jrbares
¡cer
~criv~in;
il
a
m1
m:
~imé
íe fervi de
prrfo11jio
pour
fidu ,
&
de
aqun
'~~ue
Ílftn-t1Wio,
pour
txcomlllu·
•icatio;
mais
l
1
hi11oi re de
Venifi
de Bembo mérire
enco re plus la critique du cócé de
la bonne foi,
comme Dodi n l'a prononcé daos
fa
méthode fur l'hif-
to ire .
.
Sq· PllruiA,
né
¡\
Penife
en
I~<Jo,
&
morr procura·
reur de
S.
Marc en
1
S9~,
comme je l'ai déjil clit en
p arl anr de la ville
de
Vtnife,
a
publ ié entre autres
ouvrages, Lllle g rande hifioire de
Venifi,
intirulée
lflqrÍfl vmezia11a,
lib. xij.
Venife,
I60i, I 6<J) ,
&
1704.
in-4
9 •
En qoalirt.' d'hilloriographe de la répu•
blique,
il
fur chargé de conriouer l'hilloire du car·
dinal Bembo qui avoit ti 'li
a
l'anné
HI¡,
année de
l'él évarion de Leon
X.
au pontificar.
11
en
écrivir le
premie r livre en latín, pour le conformer
a
Bembo,
mais il changea de de(Jein dans la fui re,
&
compofa
fon oQvrage tour en iralien. Cer ouvrlgt! con.tient
en douze livres tout ce qui ell arrivé de plus confi–
dérable
a
la république depuis l'an tc;q jufqu
1
en
IH2.·
11
a
éré joint au recucil rles hilloriens de
Vtnifi,
pu–
blié en
171 8
ll•us
ce
titre général:
1(/orici
del/e
Co–
fi
vmezi1111e,
i
qullli
hanno -
fcritto ptr
publicq
durt–
to .
Henri Cary
a
rr~duir
l'h Ífloire de Parot3 eA an·
gloi ;
&
fa
tr3duélion a été imprimt.'e
a
Londres en
l 6 SS
Ít1-4
°.
Morq{t1¡i
(
And ré )
n~
a
Venifo
en
I))S,
&
mort
D30S
1
S
grands emplojs Je fa p3trie l'iln
I6I8
Q
60
¡~ns,
a f3it une hilloire latine de la république, qui
IJ~rm
fous ce tirre :
Hiflori4 Vt11tta 4b
a11110
r r¡u;
1J
tmnum
161
r¡ .
Penetiit
1603,
in·
fol.
Cem: hilloire
el}
une cont inuarion de celle de Parura.
7g.
Nani
(
J ean·Baptille ), noble vénitien, fut ho–
l)Oré des premiers emplo!s de
l:t
républ ique,
&
char–
gé par
1~
fénat de cominuer l'hilloire de la républi–
que .
11
d1v1fa fon ouvrage en deux parties;
&
impri·
moir la feconde' lorfqu 'i l mourur en
16¡8
a
eré de
6:z.
ans . La premicre parrie
a
éré rraduire en
fra~~ois
~
imprimée en Hollande en
1702
en qu arre
volume~
111-lt.
L'ouvrage
·en
intérellant; mais l'aureur d3ns
tour ce qoi conéerne
fa
patrie
1
a plus fuiYi les fen–
timens rraturels gue la vérité de l'hitloire; on en a fait
une nouvelle éd1tion en
17:to ,
&
elle entre dans le
recueil de hiiloriens de
Vtni(t.
8°.
Le dernier écrivain de cette hilloire
ell
le fé.
nateur Diedo , donr l
1
ouvrage intitulé,
StqrÍt
tÜ/111
re·
INbli&ll
"~
V
,,,úa
J
a par
u
a
Penifi
en
1 7 ) I
en deux
volumes
111-4°.
Les
Fran~ois
1
a
qoi les langdes latine
&
italienne
(~nt
_inconnues, peuvent Jire .Ame!or de la Houtfaye
1
h11l_o1r.e du
gouverne~ent
de
llmifi.;
S.
Oifdier, de.
f~np.r1on
de la
~épubltq\1~
de
Vtnifi ;
l'ab~é
Laugier,
!1,11lot re de_
Ven1/i,
dep~1s
la
fondarion ¡u fqu'a nos
JOurs. Parrs,
1762.
en ctnq vol,
in-u. (Lr
tbevalier
DE ] .A'I:CO
Rr .
VlNIS!I zo•vrntrtlltlll
tltl
(Droit.
PfiiÍf.)
ce goq..
VE
cachent au • érr n ers
rnmen
plr
un
eh
f uquel
n
d
n–
n
prin
d
1
répu·
bllqoe ay.lnt
f
n cc(Je
;~u"ment~
leor putO ncc, les
princip u
cit >yem
r~l
lurc:nr en
fin de
la !'lodt.'rer. .
··ér utr
allembl~
d n
l'éghfe de
S.
lar , ti
é t bh·
ren
en
11 ·2
un co
(di
io é end•nt,
&
c
~ercnt
d o–
¿e
rnbons qui pourroient 'oppole r au
ort.lc;>nn~n .
e
du prrnce. Ce
rribun eurenr ene re le dro1 t d éhre
eh
t..e
.1nnée qu.u.tnre perfonne p r _<JU.artler, pour
compol~r
le grand coofeil qu'on venorr
d ~
créer, de
forre qu ' il
~rnit
de dcu x _rens quarante. Cltoyens
la
vill
de
l'mi(i
~r¡nr wvih~e
e n
h
quartters;
&
com–
me ce confcil fe renoo ve! loit tous les ans
1
ch3con
avoit cfpérance
t.!'
y correr.
.
L'or rl! de ce gou crncment dun cent dr _-íept ans,
c'ell-~-dirc
j fqu'en
u S9,
que.
1
doge P1
rreGr •
deni~
enrreprir de changcr
eor
u:remen~
la
f.tc~de la
ré publique ,
d'~tabli r
urte
éri
t.lb!c ,ar•fioccat1e,
en
tixa nt
a
perpdruité le
rand conferl
a
un nombre de
ciroyens
&
a leurs dcfcendans .
11
fit pall er
~
la_
Qun·
rantle criminelle
1
qui ell une chambre fouverame de
qu rante ju!{es, un decree port:H?t que
ro
os ceux qul
avoienr compofé le g rand con fe1l des quarre
anné~
précédentes. feroienr ualott's dans cctte ch3mbre.
&
que c eux qui auroienr douzc b:tlles favorable_,,
t'O~poferoienr eux
&
Jeurs tlefcend:rns
le gr:rnd coníeal
a
perpétoité .
. .
.
La nobleffe vénitienne ell d1v1fée en ddférenres
cla(Jes .
J..a
premiere comp rend les
famill~s
des tlouze
tribuns qui furent les éleéleurs ctu
pr~m:e~ ,
doge_,
&
qui fe fonr prefq ue roures confervées ¡ulqu
:1
prél enr.
A
ces douze mai fons
<JU
1
011
appelle
élttfor~/er,
o u en
a
joinr douze aurres
1
dont l'ancienneré va prelque de
psir avec les douze premieres; mais roures fonr ex·
trémemenr déchues
de
let~r
anden éclat par le lose
&
la pa uvreté.
La feconde
el
alfe de la noblelfe vénitienne íe trouve
compoft~e
des nobles qui ont pour titre le rems
de
la lixa rion du grand conf"eil ,
&
donr les noms froienr
écrits des ce tems-la dans le livre d'or, qui ell le ca–
uloaue qu'on fi.t alors de tootes les famillcs de la no–
bleffe vénitienne. On mct
a
u
rang
de cette uoul elle
du fecond ordre les trente familles qui furent aggré–
gées
~
la noble(Je en
138o
1
paree qu'elles avoienr fe–
couru la république de lommcs confidérables pen–
danr
la
guerre contre les Génois.
Dans la
troitieme clalle de la noblefle
~énirlenne
on compreod enviran quarre-vingr f.1mill es qui ont
achetc.' la nobleíle moyennanr cenr
mili e
ducars,
d~ns
le
be(oin d 'a rgent ou la
républi~ue
le rroova réduire
par la dcrniere guerre de C :mdte, On ne fir aucune
dillinaioll
entre
les perfonnes qui fe préfenrerenr
1
c'ell-a-dire, depuis le gentil·homme de
terre- f~:rme
jufqula l'artifan. Cene
rroili~me
forre de oobletfe vé·
nitienne ne fur point d'abord cmployée daos les gran–
des charges de la république. On luí préf.!roir les
nobles d'ancienne origine.
Les cita di ns qui font les bonnes familles des
ci~
toyens
vén irien~,
compofenr un fecond état entre la
noblelre
&
le peuple . On di {lingue detJx forres de
citadins: les premiers le fout de naiílance, ét;Jnt iiTus
de ces fdmilles, qoi avant la fi1arion d.u grand-con–
feil avoient la
m~me
pare au gouvernement qu'y
a
préíenremenr la nobleíle
v~nitienne.
Le fecond or–
dre
des
citadi ns efl COillpofé de ceux qui onr par
mérite ou par argent obreno ce raog dans la répu•
blique. Les uns
&
les aurres jouitfeor des
ITI~mes
pri–
vileges. La république fait femblant d'honorer les
vrais citadins,
&
leur donne toqtes les charges qu'on
tiene au -de(J ous d'un noble vénirien. La
di~nité
de
grand-chancelier e llle plus haut degré
d
1
élévation ou
pui(Je prétendre un citadin. Le
rang
&
la gr.:mdeur
de cetre charge en rendroir la fontlion digne d'un
des premiers fénareurs ,
fi
la république jaloufe de
fon auroriré
1
n'¡voit réduir cer emploi au leul exer–
cice des chafes
ou
la
charg~
l
1
oblige, fans luí don–
ner ni voix, ni crédir
1
d3ns les tribonaux
ou
il a
la
liberté d
1
enrrer,
La dign ité de gra nd·d1ancelier, celle
de
procura–
reur de
S.
Marc
&
celle du dog e font lea feotes qui
fe do nnenr
a
vie.
Voyez
les
tJIOts
DOG&
&
Paoc:u–
ll o\TEUR
t/e S. Marc.
Comme la république a voulu
nferver dans l'or-
dre exré_rieur de (on gou_verne
t une image de la
monarchte, de l'anllocratJe
&
de la riél'll<1crarie, elle
~
repréfen té un prince fouverain daos la perfonne de
t_on
















