
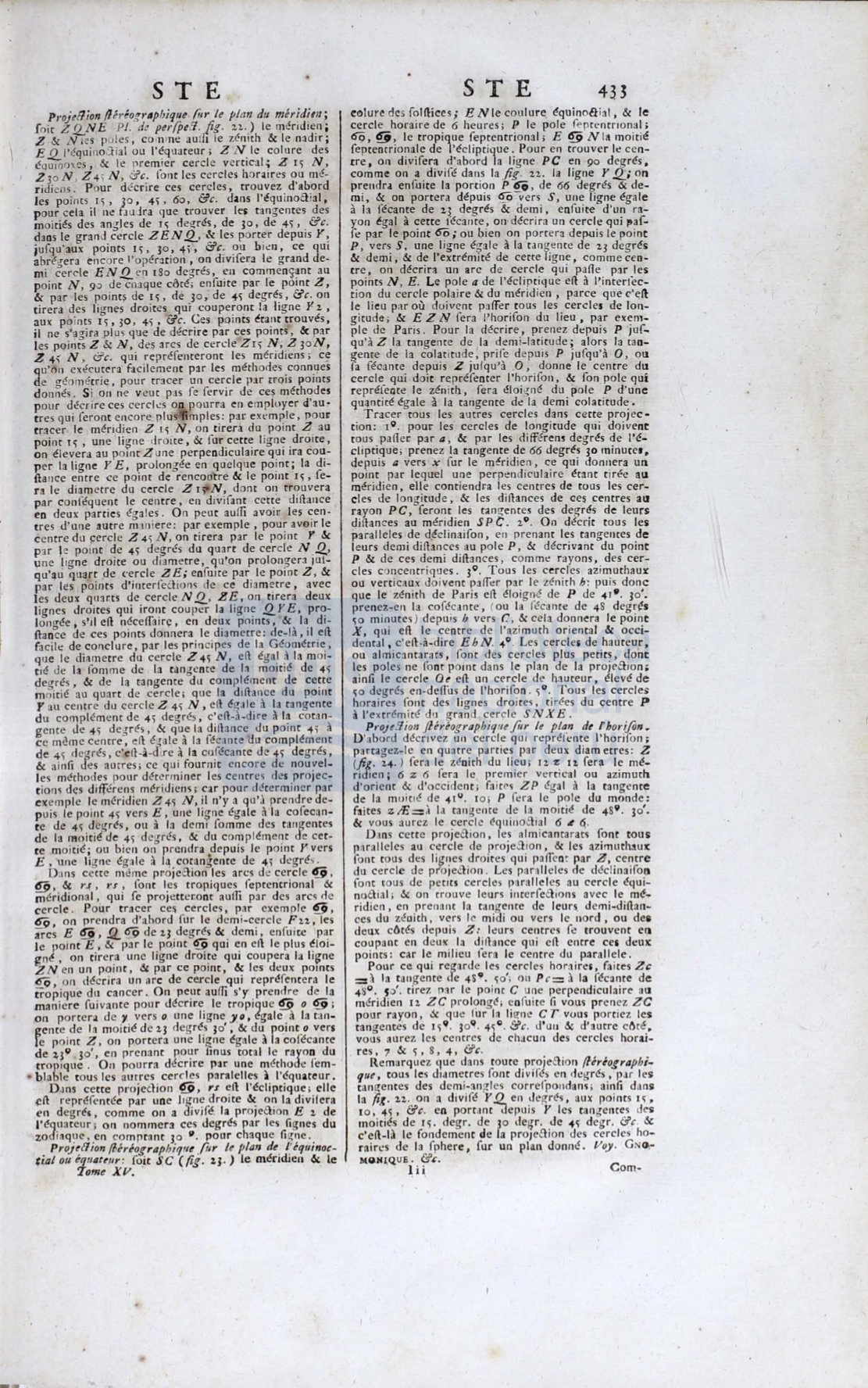
S TE
P,.ojef!ion/lér<ogr•pbiqu_e
(iw
le plan
du
méridim;
foir
z
O N E PI.
de
perfpec1. /ig.
:n. )
le méridien
¡
z
&
Nles
p<>les, comme autli ·le zénith
&
le nadir;
E
Q.l'équinoc1ial ou l'équareur ¡
Z N .
le col
u
re des
éouinn\es ,
&
le prem1er cercle verracal.;
Z
1
s
N,
Z
Jo
N , Z
4i
N,
&c.
t"ont les cercles horaires ou mé–
ridiens. Pour décrire ces cercles, trouvez d'abord
les poincs
1),
JO,
4í ,
6o, &c.
daos l'équ inoé.lial,
pour cela
il
n~
fauJra que
trouve~
les tangentes des
moitiés des
an~Jes
de
J)
de~nís,
de ¡o, de
4),
&c.
daos le grand cercle
Z E N
Q.,
&
les pórrer depuis
Y,
jurqu'aux points
1
s,
JO,
4;,
&c.
ou b ien, ce qui
abrégera encore l'opérotion , on divirera le grand de–
mi cercle
E N Q.
en
18o
degrés, en commensam au
point
N,
90
de cnaque c3ré; enruite par le point
Z,
&
par les
poinr~
de
1
s,
de JO, de
4í
degrés,
&c.
on
tirera des lignes droites qur couperonr la ligoe
Y.~
,
aux póin rs
1),
¡o,
4\,
&c.
Ces pc¡ints
~ranr
trouvés,
il
ne s.
a
gira plu• que de décrire par ces points,
&
par
les poaots
Z
&
/Y,
des aras de cerde Z zs
N , Z
joN
1
Z
4~
N ,
&c.
qui repréfenreront les méridiens ¡ e"
qu'On
cxécur~ra
facilemenr par les méthoeles
conn~es
de géomérrie, pour rracer un cercle J>lr rrois poinrs
donnés. Si on 11e veur pas re fervir de
ce~
mérhodes
pour décrire ces
ce
reles o pourra en empluyer d'au·
tres qui reront encore_p) us mpies: par exemple, f'OU<
tmcer le méridien
Z
1)
N,
on rirera du poinr
Z
au
poinr
1) •
une ligne droare'
&
rur certe ligne droire .
on élevera au poarar
Zune
perpeodiculaire qui ira cou–
per la
ligo~
Y
E,
prolongée en quelque poinr; la di–
llanee enrre ce poinr de rencootre
&
le poinr
I),
fe–
ra le diamecrc du cercle
Z
1
N,
done 011 rrouvera
par conféquenr le centre, en davifant ccrre dinauce
en deux partíes égales . O n peut aulli avoir les cen–
tres d'une aurre maniere: par exemple, pour avoir le
centre du !=ercle
Z
4í
N,
on tirera par le poiut
r
&
par
1
poant de
4)
degrés du qua
re
de cercle
N .
.Q..
une lagne droice ou diamerre, qu'on prolongera ¡ul–
qu'au quart de cercle
ZE;
enruare par le point
Z ,
&
par les points d'inrerCetlinns de ce día merre, avec
les deux quarts de cercle
N
Q.,
.ZE,
on tirera deux
Jignes droires qui iront couper la ligne
Q.Y E,
pro–
longée, s'a l eft nécelfaire, en deux pnints,
&
la di–
llanee de ces points donqera le diamerre: ele-la, il eft
facih; de conclure, par les príncipes de la Géomécrie,
q11e le diamerre elu cerclc
Z
4)
N,
en éga!
a
la moi–
tié de la fomme de
la
Un~ence
de
b
moataé de
4'í
~egrés,
&
de la !angence du complément de cetce
rnoirié au quarr de cercle; que la diítance du point
y
au centre du cercle
Z
4'i
N,
ell égal e
a
la tangente
du complémenc de
4;
degré , c•cn-1-dire a la cotan–
gente de
~'i de~rés'
&
que la diftance du point
4'i
a
ce milme
c~ncre'
en él\'ale
a
la fécanre <!u complémenc
de
4)
dc"rés' c·c:n-a-alre
a
la cofécance de
4)
degrés.
&
ainfi des aurres;
ce
qui fournic encore
d~
nouvel–
Jes mérhodes pour dércrminer les centres des projec–
tiom des dilférens méridiens ¡ car pour décerminer par
exemple le méridien
Z
4)
N,
il n'y a qu'.l prendre de–
p uis le poi
m
4'i
vers
E,
une li¡:ne égale
a
la cofecan–
te de
4)
dcgrés, ou
li
la dema fomme des tangentes
de la rnnitié de
4)
degrés,
&
du compléa'1enr de cee–
te moirié; ou bien on prcndra depuis le point
J<
vers
E
,
une ligne égale
a
la corangente de
4l
degrés.
D ans cecre meme prÓjeélion les ares de cercle
~ ,
§
, &
r-r, r.s,
fonc les rropiques Ceprerírrional
&
rnéddiona l , qui fe
proj~rcer.onr
aulli par des ares ele
cercle . Pollr tracer
ce~
cercles, par exemple
§
,
§,
on prendra d'ahord fur le demi-cercle
Fu,
les
ares
E
~ ,
Q
~
de
~J
degrés
&
demi, enfuice par
le ¡oint
E,
&
par le po.int
§
qui en en le plus
~loi
gn
, on cirera une ligne
droít~
qui coupera la ligne
ZN
en un poinr,
&
par ce point,
&
les deux poants
<59,
o n décrira un are de cercle qui reprérentera le
tropique du cancer. On
pe~tt
aulli s'y prendre de la
maniere ruivanre pour décrare le rropique
~
o
§;
on
porrer~
de
'Y
vers o une ligne
Y."•
égale
il
la tan–
gente de la moirié de
:Z.J
degrés ¡o',
&
du point
o
vers
le point
Z,
on portera une li!!ne égale
~
la co(écanre
de
'<3"
jo', en prenant pour l'inus toral le rayon du
tropique . On pourra décrire
par
une mérhode fem-
• blable tous les aurres cercles paralelles
a
l'équareur.
D Jns cetre projetlion
~'
rs
c;Jl
l'écliprique; elle
~ll
repréfenrée par une lagne droate
&
on la divilera
en degré•, comme on a divifé. la proj·eébon
E
~
de
J'équateur ¡ on nommera ces degrés par les ftgnes du
zodiaque, en comprant JO " · pour chaque tigne.
.
ProJ:Elion {loér
6ographiq11e .(i1r
le
plan
de. Nquinoc–
~~al
M
equtltt}lr :
fo.icSe
((ig.
~J.. )
le
méndien
&
le
Tome XV.
'
STE
433
e<!llure des folllices;
E N
le coulure équino8ial,
&
le
cercle horaire de
6
heures ¡
P.
le poie feprenrraonal ¡
69,
~ .
le
rropique feprentrional;
E§ N la
anoirié
feptencrionalc de l'écliprique . Pour en rrouver le cen–
tre, on divifera d'abord la ligne
PC
en
90
degrés,
comme on
a
diviré daos la
.fig .
22.
la ligne
Y
Q_;
on
prendra enruite la porri?n
P
~,
de
66
degrés
&
de–
m
a,
&
on portera dépuas
§
vers
S,
une ligne égale
a
la
fécanre de
~l
degrés
&
demi. enluite d'un ra–
yon
~ga l
ii
~erre
1écaore! on décrira un cercle qui ¡uf–
fe par le poant
0o;
ou baen on portera depuis le ()Oint
P.,
vers
S,
une ligne é¡ple ala
ran~enre
de
23
degrés
&
dcmi,
&
de l'exrrémaré de cecee ligne, comme
~en
ere, on décrira un are de cercle qui palie par les
points
N , E.
Le polea de l'écliprique ell
a
i'interlec–
tion du cercle polaire
&
du méridien
1
paree que c'ell
le lieu par ou doivenr pafrer tous les cerclet de lon–
girude;
&
E Z N
fera l'horifon du lieu , par exem–
ple de París . Pou r la décrire
1
prenez
d~puis
P
juf~
qu'ii
Z
la rangenre de la demi-laritude; alors la ran–
~enre
de la colarirude, prife depuis
P
ju(qu'a
O ,
0
u
fa [éoanre depuis
Z
julqu'ii
O,
donne le centre du
C!ercle qui doit repréfeorer l'horifon'
&
ron pote qui
repréfeore le zénirh, fera .Sioig né
el
u
~ole
P
d'une
quanriré égale
a
la rangenre de la demi colatituele.
Tracer tous les aucres cercles dans cene proj ec·
tion:•"· pour les cerales de longitude qui d
0
ivent
to.us.palier par
a ,
&
par les elifférens degrés de l'é–
clapnque; prenez la tangente de
66
degr6 jO mínutel,
depUÍS
a
vers
X
fu r le
m~ridien,
Ce qui cfonnera Un
point par lequel une
perp~ndiculaire
érant tiréc au
rnéridien, elle conriendra les centres de rous les cer–
eles de longitude,
&
les diftances de aes centres au
rayon
pe'
feronr les
ran~entes
des degrt!s de leurs
dillances au méridien
SP
C.
~
0
•
On décrir rous les
paralleles de déclinaifon, en prenanr les rangemes de
leurs demi dinanccs au poie
P ,
&
décrivant du point
P
&
de ces demi diftances , comme rayons, des cer–
cles concenrriques . J
0 .
Tous les cercles azimurhaux:
ou verricaux doivenr
palf~r
par le zénirh
h:
puis done
que le 1.énirh de París eft éloigné de
P
de
4 1"·
Jo'.
prenez-en la cofécanre,
(
ou la fécanre de
48
degr~s
so minutes ) depuis
b
vers
r. ,
&
cela donnera le point
X,
qui en le ceprre de l'azimurh oriental
&
occi–
denral, c•en-a-dire
Eh N .
-+
0 .
Les cercles de haureur,
ou almicanrarars, Ione des cercles plus perits, cjont
les poles ne fonr poanr daos le plan de la projeélion;
ainfi le cerele
0~
eft un cercle ele haureur, élevé de
so degrés en-dellus de l'horifon . s
0 .
Tous les cercles
horaires fo11t des lig nes droires, rirées du qentre
P
a
l'exr~ém.i ré dt~ ~rand c~rcle
S N X E .
Pro;~.'l!on
j}ereograp,IJ¡q¡u
ji~r
ü
plan
d~
f
hori.fon
_
D'a bord décnvez un cercle qua repréf'enre l'horifo n;
parragez-lc en quarre parries par deux diam erres :
z
(jig_.
~4·
J
fera le zéoirh du lieu ;
12
t:
a
fera
le mé–
ndien;
6
z
6
rera le premaer verracal ou azimurh
d'orienr
&
d'occidenc; fa irrs
ZP
égal
a
la tangente
de la muiraé de
41 11 •
IOj
P
fera le pole du monde!
faires zA!.'=.tld tangente de la moirié de
4 89.
jo'.
&
vous aurez le oercle équinoélial
6
.e
(\.
D aos cerre projeélion , les almicanrarars fonr t{)U$
paralleles au cercle de projeélaon,
&
les azimurluux:
ronr tous des lígnes droires qui
palfeo~
par
.z,
centre
du cercle de projeélion . Les paral leles de déclinairon
font rous de petits cercles ¡>aralleles au cercle équi–
noé.lial¡
&
on erouve leurs inrerfel.l ions
avec
le m!f.,.
ridien, en prena11r la tangenre de
leur~
demi-diftan–
oes du zéoith, vers le miCii ou vers le nord, ou des
deux cOrés elepuis
Z:
l~urs
centres re trouvent en
coupanr en demc la dillance qui cll entre ces deux
points : car le. milieu fera le centre du parallele.
Pour ce qua regarde les cercles horaires, fa ires
Zc
= a
la tangente de
48 11 •
so'¡ nu
Pe=
a
la fécanre de
4'8° .
so'.
tirez rar le point
e
une
perpendiculair~
au
méridien
a
ze
prol~ng~¡
eofuire ti
vo.u~
prenez
ZC
pour rayon,
&
que lur la
li~ne
e
T
vous portiez les
tangentes de
11"·
¡o'!.
4)
0 .
&c.
d'un
&
d'aurre cOté ,
vous
aurez les centres de chacun des cercles horai–
res,
1
& ),
8,
+•
&c.
Remarquez
~ue
dans roure projel.lion
/Ur;ographi–
que,
tous les daame.rres font diviré_s en degrés, par les
tangentes des dema-ang les correlpondans¡ ainfi daos
la
fii·
u.
on
a
diviré
Y.Q
en tleg rés , aux poinrs
1),
10,
H,
&c.
en pOrtdnr
~epuis
Y
les tangentes des
moitiés de
r ).
degr. de JO
de~r.
de
4~
degr.
&c.
&
c'ell-la le fondement de la pro¡el.lion des cercles ho–
raires de la fphere
~
fur un pla11, donné.
Voy .
GNOr
I>UlN~QUE .
&.&.
~¡¡
Com-
















