
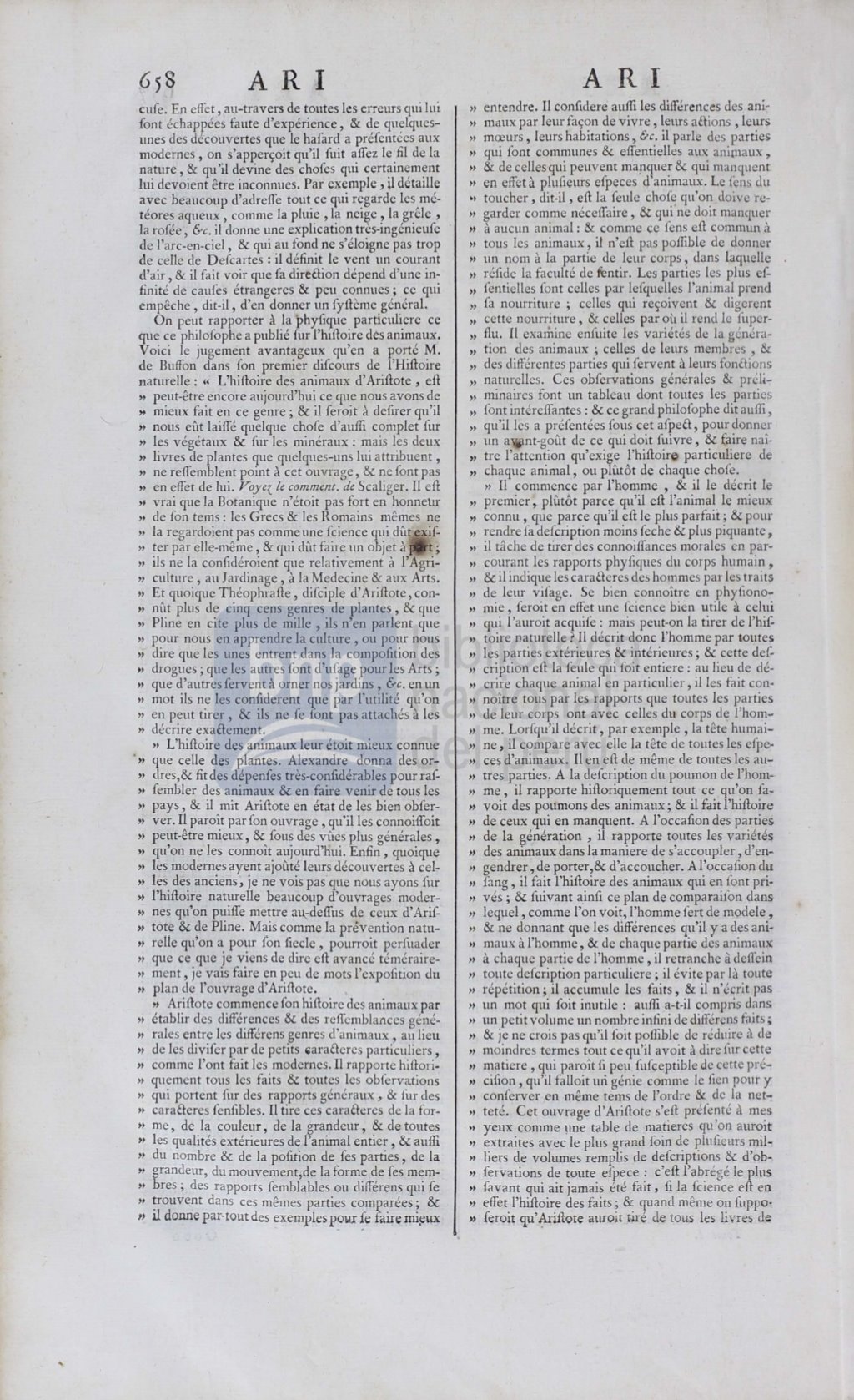
A R 1
cufe. En effet, 21u-travers de toutes les erreurs qui lui
[ont échappées faute d'expérience,
&
de quelques–
unes des découvertes que le hafard a préfentées aux
modernes, on s'appers;oit qu'il [uit aífez le
Jil
de la
nature,
&
qu'il devine des chofes qui certainement
lui devoient etre inconnues. Par exemple , il détaille
avec beaucoup d'adreífe tout ce qui regarde les mé–
téores aqueux , cornme la pluie , la
nei~e
, la grele ,
la rofée,
&c.
il donne une explication tres-ingénieufe
de l'arc-en-ciel,
&
qui au fond ne s'éloigne pas trop
de cene de Defcartes : il délinit le vent un courant
d'air,
&
il fait voir que fa direilion dépend d'une in–
linité de caufes étrangeres
&
peu connues; ce Cjlli
empeche, dit-il, d'en donner un fyfreme général.
On peut rapporter
a
la phyfiCjlle particuliere ce
que ce philofophe a publié fur I'hifroire des animaux.
Voici le jugement avantageux qu'en a porté M.
de Buffon dans ron premier di(cours de I'Hilloire
naturelle : " L'hifroire des animaux d'Arifrote , efr
" peut-etre encore aujourd'hui ce que nous avons de
" mieux fait en ce genre; & il feroit
a
defuer qu'il
" nous ellt laiífé quelqlle chofe d'allili complet fur
" les végétaux
&
fur les minéraux : mais les deux
" livres de plantes que quelques-uns lui attribuent ,
" ne reífemblent point
a
cet ouvrage,
&
ne font pas
" en effet de lui.
Voye{ te comment. de
Scaliger. Il eíl:
;¡
vrai que la Botanique n'étoit pas fort en honnetu
" de fon tems : les Crecs
&
les Romains memes ne
" la regardoient pas comme tlne (cience qui dllt exif–
" ter par elle-meme ,
&
qui dí'tí fau'e un objet a
;
" ils ne la confidéroient que relativement
a
I'Agri–
" culture, au Jardinage,
a
la Medecine
&
aux
Arts.
11
Et quoique Théophrafre, difciple d'Arifrote, con–
" ní'tt plus de cinq cens genres de plantes, & que
" Pline en cite plus de mille , ils n'en parlent que
" pour nous en apprendre la culture, ou pour nous
" dire que les unes entrent dans la compofition des
" drogues; que les auo'es font d'ufage pour les Arts;
" Cjlle d'autres fervent
a
orner nos jardins ,
&c.
en lm
" mot ils ne les confiderent que par l'utilité Cjll'on
" en peut tirer,
&
ils ne fe iont pas attachés a les
" décrire exaaement.
" L'hiíl:oire des animaux leur étoit mieux connue
." que celle des plantes. Alexandre donna des or–
" dres,&!it des dépenfes tres-coníidérables pour raf–
" fembler des animaux & en faire venir de tous les
" pays,
&
il mit Arifrote en état de les bien obfer–
" ver. Il parolt par fon ouvrage , qu'illes connoiífoit
" peut-etre mieux,
&
fous des vlles plus générales ,
" qu'on ne les cormolt aujourd'hui. Enfin, c¡uoiCjlle
" les modernesayent ajollté leurs découvertes
a
cel–
" les des anciens, je ne vois pas que nous ayons fur
" l'hiftoire nattuelle beaucoup d'ouvrages moder–
" nes qu'on puiífe mettre au;-deífus de ceux d'Aru–
" tote
&
de Pline. Mais comme la prévention natu–
" relte Cjll'on a pour fon fiede, pourroit pemlader
" Cjlle ce que je viens de dire efr avancé téméraire–
" mem, je vais faire en peu de mots I'expofition du
" plan de l'ouvrage d'Arifrote.
" Arifrote commence fon hifroire des animanx par
" établir des différences & des reífemblances géné–
" rales entre les différens genres d'animaux , au lieu
" de les divifer par de petits ,araaeres particuliers ,
" comme l'ont fait les modernes. Il rapporte hifrori–
" quement tous les faits
&
tontes les obfervations
" qui portent fm des rapports généraux ,
&
fm des
" caraaeres fenfibles. Il tire ces caraaeres de la for–
" me , de la couleur, de la
~randeur,
&
de tomes
" les qualités extérieures de I animal entier ,
&
auili
" du nombre
&
de la pofition de fes parties, de la
" grandeur, du mouvement,de la forme de fes mem–
" bres ; des rappotts femblables ou différens qui fe
"
~ouvent
dans ces memes parties comparées;
&
" il
donne par-routdes exemplespOlol.r fe faire mi¡:ux
A R 1
" entendre. Il confidere auili les différenees des aní–
" maux par leur faSon de vivre, lenrs aaions , leurs
" mceurs, leurs habitations,
&c.
il parle des parties
" 'lui foot communes
&
eífentielles aux ani¡naux,
" &
de eelles qui peuvent marquer
&
c¡ui manquent
" en effeta plufieurs efpeces d'animaw{. Le ú!ns du
., toucher, dit-il , eilla feule chofe qu'on doivc re–
" garder comme néceífaire ,
&
qui ne doit manquer
;¡
a
aucun animal :
&
comme ce fens efr commun
11.
" tous les animaux, il n'eft pas poflible de donner
;¡
un nom a la partie de leur corps, dans laquelle
" réfide la faculté de fentir. Les parties les plus ef–
;¡
femielles font celles par lef'luelles l'animal prend
" fa nourriture ; celles qui re'foivent
&
digerent
" cette nourriture,
&
eelles par
011
il rendle fuper–
;¡
flu. Il examine enfuite les variétés de la généra–
" tion des animaux ; celles de leurs membres ,
&
;¡
des dífférentes parries qui fervent
a
leurs fonaions
;¡
naturelles. Ces obfervations générales
&
préli–
>1
rninaires font un tableau dont toutes les parties
" fom intéreífantes :
&
ce grand philofophe dit auili ,
;¡
qu'illes a préfentées fous cet afpea, pour donner
;¡
un a'ilnt-gollt de ce 'luí doit fuivre,
&
faire na1-
" tre l'attention qu'exige l'hifroire particuliere de
" chaque animal, ou pllltot de chaque chofe.
" Il commence par l'homme ,
&
il le décrit le
" premier, pllltot paree qu'il efr l'animal le mieux
" connn, que paree qu'il eille plus parfait;
&
pour
;¡
rendre fa defcription moins feche
&
plus piquante,
" i1
tache de tirer des connoiífances mOl ales en par–
;¡
courant les rapports phyfiques du corps humain.
" &
íl indique les caraéleres des hommes par les traits
" de lelu vifage. Se bien connoltre en phyfiono–
" mie, feroít en effet une fcience bien utile
a
celui
" qui l'auroit acquife: mais peut-on la tirer de l'hif.
" toire naturelle
?
II décrit donc !'homme par tolltes
" les parties extériemes
&
jntérieures;
&
cette def–
" cription efr la feule qui foit entiere: aulieu de dé–
" clire chaque animal en particulier, illes fait con–
;¡
nOltre tous par les rapports que toutes les parties
" de leur corps ont avec celles du corps de l'hom-
11
me. Lorfqu'il décrit , par exemple , la
t~te
humai–
" ne, il compare avec elle la tete de tomes les efpe-
11
ces d'animaux. Il en ea de meme de toutes les au–
;¡
tres parties. A la defcriprion du poumon de I'hom–
;¡
me, il rapporte hiiloriquement tout ee qu'on fa–
" voit des poumons des animaux;
&
il faitl'hifroire
;¡
de ceux qui en manqtlent. A l'occafion des partíes
;¡
de la génération , il rapporte toutes les variétés
;¡
des animauxdans la maniere de s'accoupler, d'en–
»
gendrer, de porter,& d'accoucher. AI'occafion du
»
fang, il fait l'hifroire des animanx qui en font pri–
»
vés;
&
fuivant ainfi ce plan de comparaifon dans
" lequel, comme l'on voit, l'homme fert de modele,
" &
ne donnant Cjlle les différences qu'il ya des ani–
" maux
a
l'homme,
&
de chaqtle parrie des animaux
»
achaque partie de l'homme , il rerranche
a
deífein
11
toute defcríption particuliere ; il évíte par la toute
;¡
répétition; il accumule les faits,
&
il n'éerít pas
" un mot qtlí foit inutile: iluili a-t-il compris dans
" un petitvolume un nombreinfini dedifférens faits;
" &
je ne crois pas qu'il foit poflible de réduire
a
de
»
moindres termes tout ce qu'il avoit a dire {ur cette
" matiere, qui parolt fi peu fufceptible de cene pré–
" cifion, qu'il faltoit uñ génie comme le fien pOtlr
y
" conferver en meme tems de l'orelre
&
de la net–
" teté. Cet ouvrage d'Alifrote s'efr préfenté
a
mes
" yeux comme une table de matieres qu 'on auroir
" extraites avec le plus grand foin de pluftems mil–
" liers de volumes remplis de defcriptions
&
d'ob–
" fervations de toute efpece: c'eft l'abrégé le plus
" favant qui ait jamais été fajt,
fi
la fcience efr en
;¡
effet I'hifioire des fajts;
&
qlland meme on fllppo–
" {eroít
qu'
Aliíl:ote auroit riré de tous les Enes de
















