
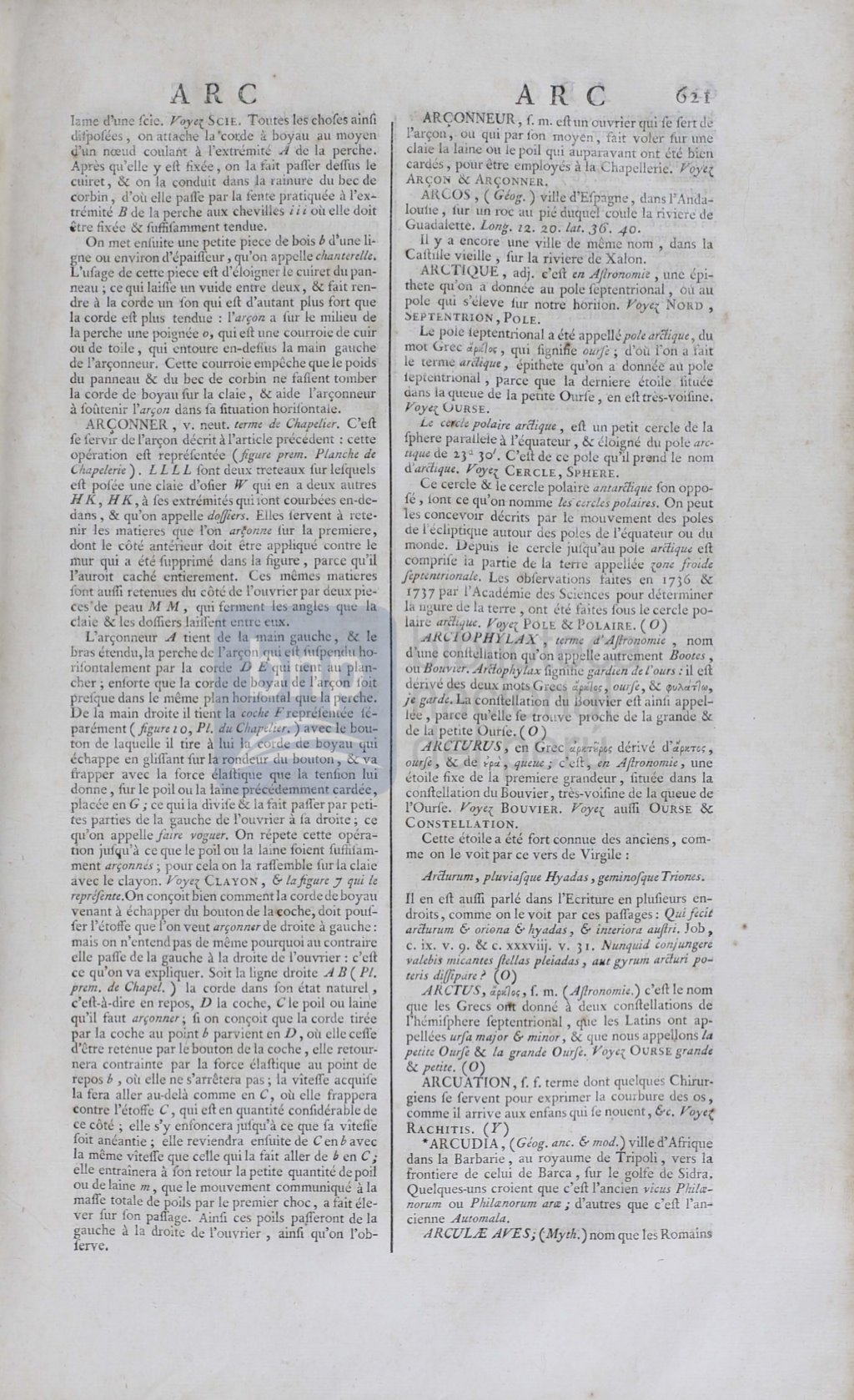
ARe
lame d'une leie.
Voyt{
SCII:,. Tomes les chofes ainli
dilpofé s, on attache la 'cOl:de
ti
boyau au moyen
d'un nreud COlúant
a
l'extrémit
A
de la perche.
Apres qu'elle y el! fLxée, on la fait ,Paifer de([us le
cuiret
&
on la conduit dans la ralllure du bec de
corbin', d'ol! elle pafie par la
fel~te pratiqt~ée
a
l'e~trémité
B
de la perche aux chevIll s
III
on elle dOlt
~tre
fixée
&
{uffifamment tendue,
On met enCuite une petite piece de bois
b
d\me
lí–
gne ou environ d'épaiíreur"qu'.on
appcll~
chanterelLe.
L'u{agc de cette picee eft d élolgner le Clllrer d.u pan–
neau ; ce qui laifle tm vuide enn'e deux,
&
falt ren–
dre
a
la corde un fon qui eft d'autant plus fort que
la corde eft plus tendue :
l'arfon
a úlr le mi!ieu
~e
la perche tme poignée
o,
qui eft
t~nc
courrolc de cutr
ou de toile, qui entoure en-defius
la
mam gauche
de
l'ar~onneur.
Cette courroie empeche que le poids
du pannean
&
du bec de corbin ne fafient tomber
la cOl'de de boyau úlr la claie '.
&
aide, I'an;onneur
a
{ollterur
I'arfoll
dans {a úmauon honlontale.
ARCONNER, v. neut.
terme
dJ
Cllapelier.
Ceft
{e
{erv~'
de l'al'<fon décrit
a
l'artide précédent : cette
opération eft repré{entée
( figurt prem.
Plan~he
de
Ulapelerie).
L L L L
font deux rrcteaux
{ur
lelc¡uels
eft pofée une claie d'oúer
IV
qui en a deux autres
H
!í.,
H K,
a
{es extrémités qui lont courbées en-de–
cians,
&
qu'on appelle
dl!!fiers.
Elles fervent
a
rete·
nir
les
maueres que l'on
ar?onne
litr la premiere,
dont le coté antérietlr doit etre appliqué ontre le
mur qui
a
été íilpprimé dans la figure, parce .qu'il
l'amoit caché entierement. Ces memes man res
{Unt auíIi retenues elu coté de l'ouvrier par deux pie–
ces'ele peau
M M,
qui fennent les angles que la
claie
&
les doíIiers laitfent entre ellX.
L'ar~onnenr
A
tient de la lI1ain gauche ,
&
le
bras étendu, la perche ele
l'ar~on
qui ett {u{penelu ho–
rifontalement par la corcle
D E
qui tlent au plan–
cher; elúorte que la corde de boyau de
I'ar~on
toit
pre{que dans le meme plan horuontal que la perche.
De la main droite
il
uent la
coche
F
repfi;!{entée lé–
parément
(figure
1
O,
PI. du C/¡apelier.
)
avec le bou–
ton de laquelle il tire
a
lui la corde de boyau qui
échappe en gliJrant{m la rondeur du bollton,
&
va
frapper avec la {orce élaftique que la te\lúon lui
donne, {m le poil ou la lame précédemment cardée,
l)lacée en
G;
ce qui la divife
&
la faít pa([er par peti–
tes parties de la gauche de l'ouyrier a la droite; ce
'In'on appelle
.faire yoguer.
On répete
~ette
opéra–
tion jlúqu'a ce qtle le poil on la laine {OIent
{lúlita~ment
ar~onnes
;
pour cela on la raJremble {ur la dale
ayec le clayon.
Voye{
CLAYON,
&
lafi'gare:J 'lui le
reprqeme.Oncon~oit
bien comment la cordedeboyau
enant
a
échapper du bollton de la coche, doit pouf–
fi
r I'étoffe que I'on veut
arfonn.r
de droite a gau he:
mais on n' ntend pas de meme pourquoi au contraire
elle paJre de la gauche
a
la droite de I'ouvrier : c'eft
ce qu'on va eA'Pliqtler. Soit la ligne droite
.A
B
(
PI.
prem. de Clzape!.)
la corde dans {on état natttrel ,
c'eft-a-dire en repos,
D
la coche,
C
le poil ou laine
qu'il fallt
ar(}onner;
Ú
on
con~oit
que la corde tirée
par la coche au poi,nt
b
parvient en
D,
Ol! elle cdre
d'&rre retenue par le bonton de la coche, elle retom–
nera conrrainre par la force élaftique au point de
repos
b
,
Oll elle ne
s'arr~tera
pas; la vl:te([e acqui{e
la fera aUer au-elela comme en
C,
ou elle frappera
Contre !'étoffe
C,
qui eft en quantité coniidérable de
ce coté; elle s'y enfoncera jufqu'a ce que fa vlte/le
{oit anéanue; elle reviendra enfuite de
C
en
b
avec
la meme viteJfe que celle qui la fait aller de
b
en
C;
elle entralnera a Con retom la petite quantité de poil
ou de laine
m,
que le mouvement communiqué a la
maJfe totale de poils par le premier choc, a fa it éle–
ver {ur fon paírage. Ainft ces poils pafferont de la
gauche a la droite de I'ouvrier , ainft qu'on l'ob–
ferve.
ARe
, AR<;:ONNEyR,
f:
m. eftunouvrier'Iui {e {ertde
1
al:~on , ~u
qlll par ion moyen, fait voler fur une
cia!e la lame ou le poi! qui auparavant ont été bien
cardés, pom etre employés
a
la ChapeUeric.
Voy~{
AR ~O
&
AR~ONNER.
ARCC? ,(
Géog.
)
ville d'E(p;¡gne, dans l'Anda-
10uÍle,
1ur
un roc au pié duquel couie la riviere de
Guadalcrte.
Long.
Z2.
20. lato
36.
40.
Il Y
a encore une vi!le ele m&me nom , dans la
Caftdle vieille , {m la riviere de Xalon.
ARe..TIQUE, adj. c'cft
en Aflronomie
,
une épi–
thete
qu.'o~ ,
a donnée a11 pole {eptentrional, on au
poie qU! s eleve íllr norre horilOn.
Yoye{
NORD ,
:>EPTE TRION, POLEo
Le pOle teptentrional a éré appellé
pole aréli'lue,
du
mor Grec
Jp,,1o~ ,
qui ftgnine
ourfe ;
el'O~1
ron a iait
le terme
aréli'lue,
épithete qu'on a donnée atl pole
t
p
enmonal , parce que la derniere étoile útLlée
dans la queue de la pente Omfe, en eft tres-voi{11le.
VOyt{
()URSE.
Le c"ele polaire arélique,
eft un petit cercle ele la
{phere parallele
a
l'équatettr ,
&
éloigné du pole
are–
tt.qll¿
de
23
á
3
0'.
Ce!1: de ce pole qu'il prend le nom
d'arélu¡ue. Voye{
CERCLE, SPHERE.
, Ce cercle
&
le cerde polaire
antaréliqlle
Con oppo–
{e, íom ce qu'011 nomme
üs'c¿relespolaires.
On peut
les
c?n:e~otr
décrits par le mouvement des poles
de l'ecllpuc¡ue autour des poles de l'éqtlateur ou du
monde: Depuls le cercle jtúqu'au pole
aréli'lu¿
eft
compnfe
ia
partie de la terre appellée
t one froide
[ept¿nmonaü.
Les obfervations taites en
173 6
&
1737
par l'Académie des Sciences pour dételminer
la.ngure de la terre , ont été faires (OllSle cerde po–
¡me
arEl'que. Voyet
POlE
&
POLAIRE.
(O)
ARCIOPHYLAX, terme d'Ajlrollomie ,
nom
d'tme conHellation qu'on appelle autrement
Booees ,
ou
BOllvur. Arélop/¡ylax
fignihe
O'ardim
de
t'ours
:
il
eft
dérivé des deux mots Grecs
á'px7o~ ,
ourft,
&
q¡uAd...
1w,
je garde.
La conftellation du Bouvier eft ainft appel–
lée, parce qll'elle {e trOi!Ve plOche de la grande
&
de la petite Our{e. (
O)
.
ARCTURUS,
en Grec
dpy....
íip.~
dérivé
d'a'py.....
~ ,
oll1fe ,
&
de
~p"' ,
q/leue;
c'e!1: ,
en Aftronomie,
une
étoile fixe de la premiere grandeur, fitllée dans la
conftcllauon dll Bouvier, tres-yoifine de la qlleue de
¡'Ourfe.
Voye{
BOUVIER.
Voye{
auíIi OURSE
&
CONSTELLATLON.
Cette étoile a été fort connlle des anciens, com–
me on le voit par ce vers de Virgile :
ArElurum, pluyiaji¡ue Hyadas> geminoji¡ue Triones.
Il
en eft
auffi
parlé dans l'Ecriture en
plufieur~
en.–
droits, comme on le voit par ces palfages:
Qm
fiel!
arélurll1n
&
oriona
&
Izyadas,
&
interiora aujlri.
Job,
c. ix. v. 9.
&
C.
xxxviij. v. 3
I.
Nunquid
,onju~gere
valebis mieantes jlellas pleiadas, altt gyrum arélun po–
mis diflipare? (O)
ARCTUS,
Jpy.1o~,
f.
m.
(AJlronomie. )
c
'eft.lenom
qtle les Grecs Oltt donné
ii
deux conft
7
11anons de
Phémifphere {eptenu'ional, qtle les Latms ont ap–
pellées
Ulfa major
&
minor,
&
que nous appellons
la
puia Ourft
&
la grande Ourft.. royC{
OURSE
grande
&petite.
(O)
ARCUATION,
f.
f. tenne dont quelqtles Chirur–
giens {e fervent pour exprime.r la courbure des os ,
comme il arrive allx enfans qm (e nouent,
&c. Voyet
RACHITIS.
(Y)
..ARCUDIA,
(Géog. anc.
&
mod. )
:rille.d'Afriqtle
dans la Barbarie, au royaume de Tnpoh , vers la
frontiere de celui de Barca, fur le golfe ele Sidra.
Quelques-uns croient que c'eft l'ancien
vicus Plzil(}!–
norum
ou
P/¡il(}!norum arf2;
d'alltres que c'eft l'an–
cienne
AUlomala.
ARCULJ"E AVES; (Myt".)
nom que lesRomains
















