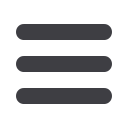
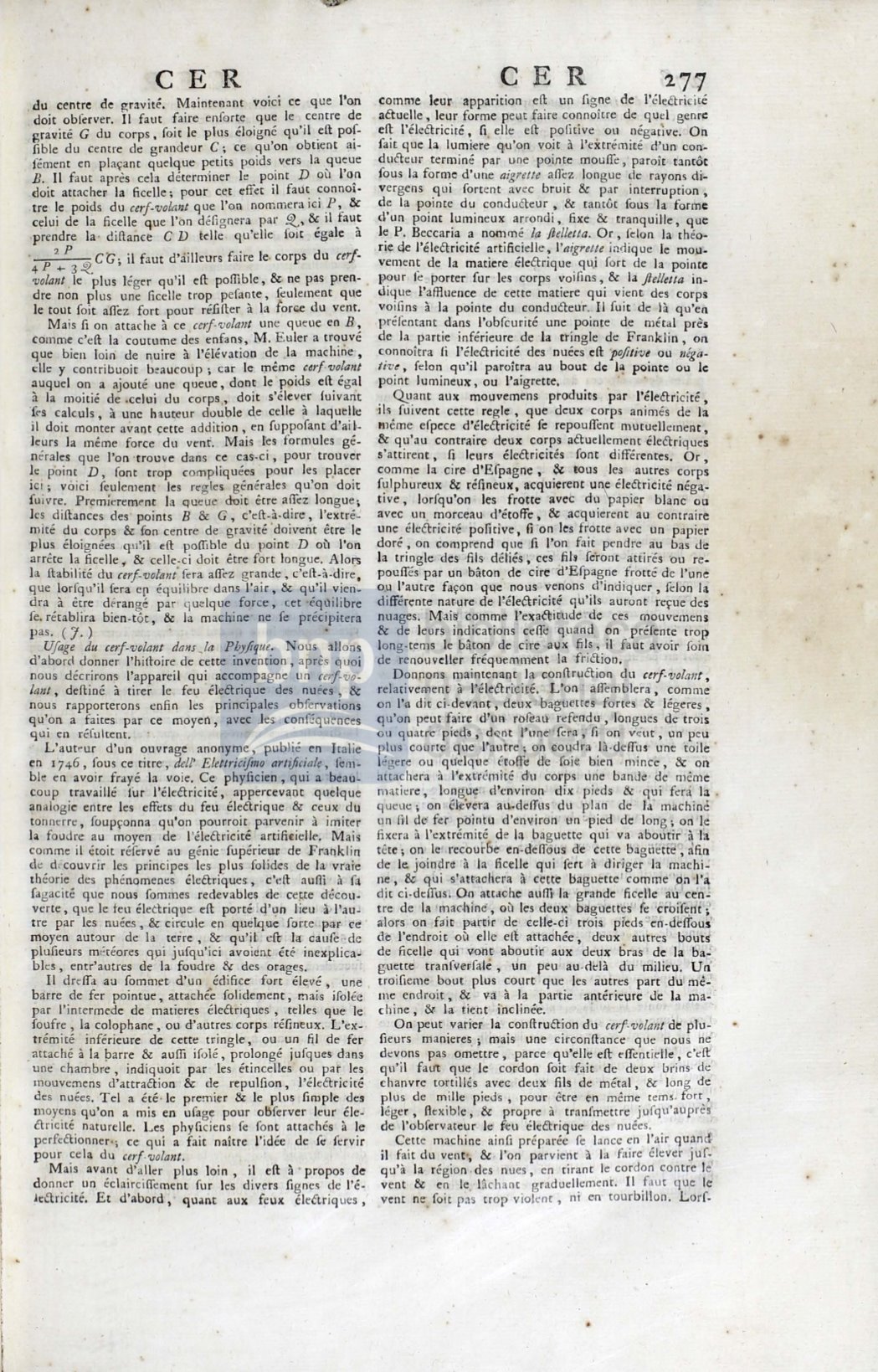
CER
du centre de gravite. Maintenant vo1c1 cc que l'on
doit obferver. ii faut faire enforre que
le
centre de
gravire
G
du corps, foir le plus eloigne qu'il .en
po~fible du centre de grandeur
c.;
ce
~u'on
obuent a1-
fement en
pla~ant
quelque P.ems po1ds .vers la
~u:ue
B.
II
faut apres cela determ'iner le.
p~mt
D
ou
I
o.n
doit atc:icher la ficelle; pour cet
effet
11
fact~ ~onno1-
tre le poids du
cerf-volant
q ue l'on nommera 1c1
_P ,
&
c~lui
de la fice\le que !'on defignera par
~·ts:
11
fau:
prendre la · diflance
CD
kite qu'dle fo1t egale a
--2
_P_
C'(;.
ii faut d'ailleurs faire
le.
corps du
cerf-
4
P
+-
3~
'
volant
le plus leger qu'il dl: poffible,
&
ne pas pren–
dre non plus une ficelle trop pefante, feulement que
le tom foit affez fort pour r.efiner
a
la torc:.e du vent.
Mais fi on atrache
a
ce
wf-volant
une queue en
B,
comme c'efl la cournrne des enfans-, M. Ewler a rrouve
que bic:u loin de nuire
a
l'elevarioo de la
machine ,
elle
y
contribuoit beaucoup; car le 1;neme.
carf.vo!a11t
auquel on a ajoute une queue, door le potds en egal
a
la moitie de .cctui du corps,, doit s'clever {uivant
'frs calculs'
a
uac hauteur double d,e celle
a
laquelle
ii doit mooter avant cette addition, en fuppofant d'ail–
kurs la rneme force du vmt. Mais res formules ge–
neralc:s que ]'on ·trouve dalls cc cas-ci' pour trouvor
k
p'oinr
D,
font trap co.mpliqueos pour les P.lacer
ic1; voici
feulement
Jes
r~crles
generales qu'on doit
fo ivre. Premierement la
que~e
doio
erre affez longue;
Jes diftances des points
B
&
G,
c'd1:-a-dire, l'extre–
mite du corps
&
fon centre de gravite 'doivent erre le
plus eJoignees q.'1'il e(l: poffible du point
D
ou !'on
arrece la ficelle
1
&
cellc-ci doit etre fort longue. Alors
la nabilite d'u
cerf.vota11t.
frra a!fcoz grande, c'efl:./i.dire,
que lorfqu'il fera
C[l
equi!ibre dans ]'air,
&
qu'il vien–
dra
a
etre derange par qudque force' cet ·eqt)ilibre
(e. retablira bien-tot ,
&
la machine ne
fe
precipitera
pas. (
J.)
·
·
Ufage du
cerf-vola11t
da11sJa Pbyjique.
Nous aliens
d'aborci donner l'hitl:oire de cette invention, apres quoi
nous decrirons l'appareil qui accompagne un
cerf-vo–
la11t'
defl:ine
a
tirer
le feu eleCl:rique des nufrs '
&
nous rapporterons enfin
les principales obfervations
qu'on a faires par ce moyen, avec Jc:s confcqtiences
qui en rHultent.
·
L'aut.-ur d'u111 ouvrage anonyme, publie en Iralie
en 1746, fous ce titre,
dell' E/ef,tricifmo artijiciale,
fom–
ble en avoir fraye la voie. Ce phyficien , qui a
·beau~
coup
travaille
t'ur l'eleCl:ricite, appercevaot queleiue
analogie entre les effets d'u feu eleetrique
&
ceux du
tonntrre, fouP\:onna ql\'On pour.roit parvenir
a
imiter
la foudre au moyen de
l'eleCl:ricite artificielle. M ais
commc ii etoit rfferve au genie fuperieuu de Fra11.klin
de drcouvrlr les principes les plus foJjdes de la. vraie
theorie des phenomenes e!echiques' c'dl: aum
a
fa
fagacite que nous fommes redevables de cette decou–
verte, que le feu eletl:rique
ell:
porte .d\in lieu il!l'au–
tre par les nuecs,
&
circ.ule en q.uelque force .par ee
moyen auteur de la
teFre ,
&
qu'iL dt-
la oaul'e ·de
plufieurs mt:tfores qµi jufqu'ici avoiunt ete inexplicaJ
bks, enrr'autres de la foudre
&
des orages.
II
dreffa au fomrnet d'un edifice fort
eleve, une
barre de fer pointue, attachee folidement, ma.is ifolee
par l'intermede de matieres eleCl:riqucs '
telles que le
foufre ' la colophane'
OU
d'autres, corps refim:ux. L'ex–
tremite
inferieure de cette tvingle, ou un fil de fer
attache
a
la parre
&
auffi ifole , prolonge jufques dans
une chambre, indiquoit par Jes etincell.es OU par !es
mouvemcns d'attraCl:ion
&
de
repulfion, l'eleCl:ricire
des nuees. Tel a
ere·
le
premi~r
&
le plus firnple des
mo_yens qu'on a mis en ufage pour obferver lt'ur ele–
Cl:nc1te. naturelle. Les phyficiens re font attaches
a
le
perftCl:1onner
0
;
ce qui a fait naltre l'idee de
fo
frrvir
pour
~e la
du
cerj.volant.
Mais avant ?'aller plus loin ,
ii
efl:
a·
propos de
donn_e~
_un
ecla~rci{foment
for Jes divers fignes de l'e–
leCl:nc1te. Et d abord' quant aux feux ele{Lriques'
CE R
'277
comme leur apparition ell:
un figne de l'eleCl:ricice
altuelle, leur forrne peut faire connoitre de quel genr-c:
e~
l'Clell:ricite'
Ii
elle ell: politive
OU
negative. On
fa1E que la lumiere qu'on voit
a
]'eictremice cl'un con–
dufteur termine par une rointe mouffe' paroit tantot
fous la forme d'une
aigrette
a{foz longue de rayons di–
vergens .<Jlli
fortent avec bruic
&
par
interruption,
de la pointe du conduCl:eur ,
&
cantor fous la forme
d'un point lumineux arrondi, fixe
&
tranquille, que
le
P.
Beccaria a nomrne
la
foelletta.
Or, felon la chfo–
rie
cle
l'ele&ricite artificielle,
I'
aigrette
indique le mo!l–
vemen~
de la matiere
eleCl:rique.qu.i fort de la pointe
}ilOl:lr
le
porter for les corps votfins,
&
la
flelletta
in–
dique
l'~ffiuenc~
de cettc: matiere qui
v~enr.
des corps
vo1fins a la pomte du conduCl:eur.
II
fo1t de
la
qu'en
prefentant dans l'obfcurite une pointe de metal pres
de la partie inferieure de
la
tringle de Franklin , on
connoirra
Ii
l'eleCl:ricite des nuecs eft
po}iti'Vt
ou
11iga–
tiv~ ,
felon_ qu'il
paroit~a
au bout de
l~
pointe ou le
point lumineux, ou l'a1grette.
·
·
.
~i.ant
aux mouvemens
produi~s
'par l'eleCl:ricire,
tis
fu1vent cette regle , que dc:ux corps animes de la
Pneme efpcce d'elell:ricite
(e
repouffent mutuellement
&
.qu'au contraire deux corps aCl:uellemenr eleCl:rique;
s'attirent, fi
leurs eleCl:ricites
font differences. Or,
comme la cire d'Efpagne ,
&
taus
]es
autres corps
folphureux
&
refineulC, a<;quierent ul\e eleCl:ricite nega.–
tive, lorfqu'on
les
frotte avec du 'papier blanc oa
avec un morceau d'etoffe,
&
acquierent au contraire
une eleCl:ricire poficive,
fi
·on les frotte
avec
un papier
dare, on c<ilmprend que
fl
]'on fait pendre au bas
Je
la tringle des fils· delies, ces fib fc'ront atiires ·ou re–
pouffes par un baton de cire d'Efpagne from: de l'une
o.u l'autre
fa~on
que no1'!S veAons d'inciiguer, felon la
different
e nar·ure de J?CleCl:ricitc:l qu'ils auront
re~ue
des
nuages.
M.ai!I
comme l'exatbirnde de ces
rnouvernens
&
de leurs indications ce{fe quaAd on prefc:nte tro?
long-terns le baton de cire avx fils, ii fa ut avoir foi n
de renouveller frequemment la friCl:ioo.
Donnons mai
ntenaqt laconfl:ruCl:ion du
cerf-vola11t,
relatiV<lf.Flent
a
l'
eleCl:rici.te.L'on . affemblera ' comme
on l'a die ci-devant, deux
bagolfttes
fortes
&
legeres,
qu'on peut faire d'un roit!au
r~fendu,
longucs de rrois
ou quatre piec\s, dQrit l'lll)e' fera, fi on veuc, un peu
plus courtc que l'aut-re; on eoudra ]a.delfus une roile
legere ou quelque
~eoff'e
de foie, biert mince,
&
on
attachaa
a
l'tl(tremite d\1 corps 1.1ne bantle de nicme
matiere,
long_u? d'cnviron dix · pieds
&
qui fcra la .
queue; on e1·1:vera au-defFus du plan de
ta
machine
un Ii>!
de;
for pointu <ll'enyiren ttn !.flied de long; on le
fixera
a
l'cxtremite de
I~
baguette; qui va abourir
a
Ill
tete; on le'.recouH>e en-d'elf6us de cetce
oagii~tre , ~fin
de le join.drc
a
la ficelle qui fert
a
diriger la machi–
ne.
&
qui
s'atl'a~hera
a
cette baguette 1 comme 'pn ·l'a
die ci-ddfus, On attache auffi' la· grahde ficel1e aU-
ce'n~
ere de la •111achrne, oi\ Jes deux baguettes fe ·crolferti ;'
alors on fait rarvir de coell'e-ci rrois pieds ''err-deri"ous
de
l'endroit ou ellc ell: artaohee, deux atmes bduts
de ficelle q u.i 1tdl1t abouti\1 a
ux deux bras de la
ba~
guette
tranfver,fale, un peu au.cl la d'u milieu. Un'
troifieme bout plus court que Jes autres part du
me–
me endroit,
&
va
a
la
p~rtie
anterieure Je la ma- ·
chine,
&
la tient inclinee.
On peut varier la conflruCl:ion du
cerf.volanl
d~
plu–
fieurs manieres. ; mais une citconflance que nous ne
devons pas omettre , parce· qu'elle eft effentidle, c'df
qu'il faut que
le
cordon foit fair de deux brins de
chanvre tortilles avec deux fils de metal'
&
loni de
plus de mille pieds ' pour etre en meme rems. torr'
leger' fltxible'
&
propre a tranfmettre jufq\1'aupres
de l'obfervatc:ur le<
f.eueldlrique des nuees.
Cette machine ainfi preparee fe lance en ]'air
qu~n&
j]
fait du vent-,
&
]'on parvient
a
la faire elev<:r
JUf–
qu'a la region .des nues, en tirant le cordon contre le
vent
&
en
le,-lachanc graduellement. II _faut que le
vent ne Coit pas crop vio)enr, ni en rourb11lon. Lorf-
















