
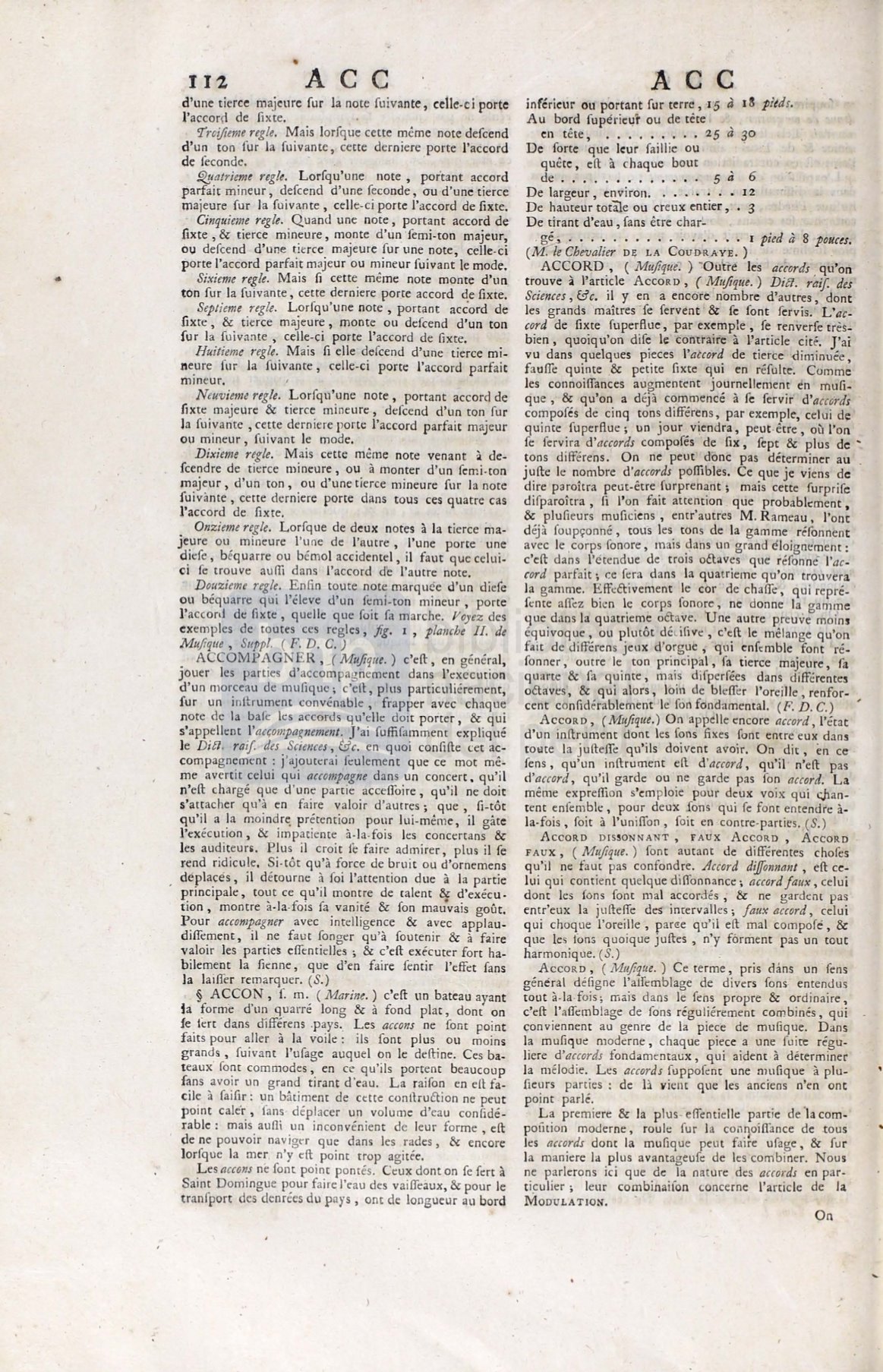
..
112
ACC
d'une tierce majeure fur Ja note foivante, cdle•CÍ porte
l'accord de fixte.
'l'roijieme regle.
Mais lorfque cette meme note deícend
d'un ton fur la fuivante, cette derniere porte l'accord
de feconde.
!}¿Jwtrieme regle.
Lorfqu'une note , por'tant accord
parfait mineur, defcend d'une fecoode , ou d' une tierce
majeure fur la fuivante, celle-ci porte l'accord de Jixte.
Cinquieme regle.
Quand une note, portant accord de
fixte,
&
tierce mineure, monte d'un ·femi-con majeur,
ou
defcend d'une tierce majeure fur une note, celle-ci
porte l'accord parfait majeur ou mineur fuivant le mode.
Sixieme regle.
Mais Ji cette. meme note monee d'un
tón fur la fui vante, cette dern1ere
por.reaccord
d,e
fixte.
Septieme regle.
Lorfq u' une note , portant accord de
fixte,
&
tierce majeure , monte ou deícend d'un ton
fur la fuivame, celle-ci porte l'accord de fixte.
Huitieme regle.
M ais Ji elle defcend d'une tierce mi–
ne_ure fur J;¡ fuivante, celle-ci porte l'accord parfait
mmeur.
Neuvieme regle.
Lorfqn'une note, portant accord de
fixte majeure
&
tierce mineure, defcend d'un ton fur
Ja fuivante , cette dern iere porte l'accord parfait majeur
ou mineur, fuivant le mode.
Dixieme regle.
Mais cette meme note venant
a
de–
fcendre de tierce mineure' ou
a
monter d'un femi-ton
majeur, d'un ton, ou d'une tierce mineure fur la note
fui vánte, cene derniere porte dans tous ces quatre cas
l'accord de fixre.
Onzieme regle.
Lorfque de deme notes
a
la tierce rna–
j'eure ou mineure !'une de l'autre ,
l'une porte une
dieíe, béquarre ou bémol accidente), il fai1t que celui–
ci fe trouve aum dans l'accord efe l'autre note.
])ouzieme regle.
Enfin toute note marquée d'un diefe
Otl
béquarre qui l'éleve d'un femi-ton mineur, porte
l'accord de fixte, quelle que foit
fa
marche.
/loyez
des
exemples de toutes ces regles,
jig.
l
,
planche
JI.
de
Mvjiqtte
,
Suppl.
(
F.
D.
C. )
ACCOMPAGNER
, _(
lvfufique.)
c'eíl:, en général,
j·ouer
les parties d'accompagnemrnt dans l'execlltior:i
d'un morceau de mu fique; c'eíl:, p lus particuiiérement,
fur un iníl:rument convénable, frapper avec chaque
note de la bafe les accords qu'elle doit pnrter,
&
qui
s'appellent l'
ac~oinpagnement.
J'ai fuffifammenr expliqué
le
Diél. raif des Sciences, &c.
en q uoi confiíl:e cet ac–
compagnement : j'ajou terai feulement que ce mot me–
me avertit celui qui
accompagne
dans un concert. qu'il
n'eft chargé que d' une parcie acceífoire , qu'il ne doit
s'attacher qu'a en
faire valoir d'autres; que , fi-tót
qu'il a la moindr" prétention pom lui-meme, il gate
l'exécution,
&
impaciente a- la-fois les concertans
&
les auditeur,, Plus il croit
fe
faire admi rer, plus il
fe
rend ridicule, Si-tot qu'a force de bru it ou d'ornemens
déplacés, il détourne
a
foi l'attention due a la partie
principale, tout ce qu'il montre de calent
l!f
d'exécu–
t ion, montre a-la-fois
fa
vanité
&
fon mauvais gout.
Pour
accompagner
avec
intelligence
&
avec applau–
difü:ment, il ne faut fon ger qu'a foutenir
&
a
faire
valoir les
partie~
effenrielles ;
&
c'eft exécuter fort ha–
bilemeot la fienne, que d'en faire fentir
l'effet fans
Ja laiffer remarquer.
(S.)
§
ACCON,
f.
m.
(Marine.)
c'eíl: un bateau ayant
fa
forme d\1n quarré long
&
a fond plat' done on
fe
krc
daos dífférens .pays.. Les
accons
ne
font point
faits pour aller
a
la voik :
ils font plus ou moi ns
grands , fuivant l'ufage auquel
bn
le
deíl:ine. Ces ba–
teaux· fonc commodes, en ce qu'ils portent beaucou p
fans avoir un grand tirant d'eau. La raifon en elt fa–
cile
a faifir : un bacimenc de cene conllruél:ion ne peu t
point calér, fa ns- déplacer un volume d'eau confidé –
rable; mais auíli un incon vénient de leur forme , eft
de ne pouvoir
navig~r
que dans les rades,
&
encore
lorfque la mer, n'y eft point trop agitée.
Les
accons
ne font point pontés. Ceui:c dont on
fe
fert
a
Saint Domingue pour fa ire l'eau des vailfeaux,
&
pour
le
tranfport des denrées du pays , ont de longueur au bord
ACC
Ínférieur
Oll
portant fur terre,
·1'5
a
18
preds.
Au bord íupéric:4r ou de tete
en tete'
. . . • . • • . .
2
5
a
~o
De force que lcur faill ie ou
quete, eíl:
a
chaque bout
de . . . . . • . . • . . . .
5
a
6
De largeur, environ.
. .. . "
.
12
De hauteur tot-;\le ou creux ent1er,
3
De tírant d'eau , fans etre char!.
. gé..................
1
pied
a
8
poum.
(M:~le
Chevalier
D~
LA
Couo·RhYE.)
ACCORD ,
(
Mujique~
)
'Ou~re
les
accords
qu'on
trouve
a
l'article AcCORD'
(
l'vf11Jiq11e.) Diél. ráif des
Sciences, &c.
il y en a encore- nombre d'autres, dont
les grands maitres -fe fervent
&
fe
fon~
fervis.
L'ac–
cord
de fixte fuperflue, par exemple ,
fe
renverfe tres.
bien, quoiq u'on dife le contraire
a
Varticle cité. J'ai
vu dans quelques pieces
l'atcord
de tierce -Oiminuée,
faulfe quinte
.&
petite í1xte qui en réfulte. Comme
les connoi{fances augmentent journellement en mufi–
que,
&
qu'on
a
déja commencé
a
fe fervir
d'accords
compofés de cinq tons différens, par exemple, celui de
quinte íuperflue; un jour viendra, peut-ecre, ou l'on
fe
fervira
d'accords
compofés de Jix, íept
&
plus de •
tons d ifférens. On ne peut d'onc pas déterminer au
jufte le nombre
d'accords
poffibles. Ce que je viens de
dire paroltra peut-ecre furprenant ; mais cecee furprife
difparoltra, Ji
l'on fait attention . que probablement,
&
plufieurs muficiens , entr'autres M. Rameau, l'ont
déj a fouVionné , tous les tons de la gamme rffonnent
avec le .corps fonore, mais
~ans
un grand éloignement:
c'eíl: daos l'étendue de tro1s oél:aves que réfon né
l'ac–
cord
parfait; ce fera daos la quatrieme qu'on trou vera·
la gamme. Elfcél:ivement le cor de chaífe, qui repré–
frnce affez bien le corps fonore, ne donne la gamme
que dans la quatriemi: oél:ave, 'Une autre preuve moi'ns
éq uivoque, Oll plutclt déLiÍIVt:, C'Cíl: le meJange qu'on
fait de différens jellX d' orgue , qlli enfcmble font ré–
fonner, outre le
ton principal,
fa
tierce tnajeure,
fa
quarte
&
fa
quinte, mais difperfées daos différentes
oétaves,
&
qui alors, loin de bleífer l'oreille, renfor–
cent confidérablement' le fon Ídndamental.
(F. D .
C.)
AccoR o,
(
Mujique.)
On appélle encere
accord,
l'état
d'un iníl:rument dont les fons fixes font entre eux dans
to1:1te la juíl:eJfe qu'ils doivent avoir. On dit, en ce
fens, qu'u n inftrurnent
eíl:
d'accord,
qu'il · n'eíl: pas
d'accord,
qu'il garde ou ne garde pas fon
accord.
La
meme expreffion s'emploie pour deux voix qui .:;Jian –
tent enfemble' pour deux fons qui fe font entendre a–
la-fois, foit a l'uniífon, foi t en conrre-parties. _(S.)
AccoRD 01ssONNANT, FAUX AccoRo, AccoRD
FAUX, (
Mujique.)
font autant de différentes chofos
qu'il ne faut pas confondre.
Accord di.ffonnant
,
eíl: ce–
lui qui contient quelque diífonnance;
accord Jaux,
celui
dont les fons font mal accordés ;
&
ne gardent pas
entr'eux la jllíl:eífe des inrervalles;
faux accord,
celui
qui choque l'oreille, parl!:e qu'il eíl: mal compofé,
&
que les fons quoique juftes, n'y fórment pas un tout
harmonique. (S.)
AccoRo, (
Mujique.
)
Ce terme, pris dáns un fens
général défigne l'alfemblage de divers fons entemlus
tOllt a- la-fois; mais dans le fens propre
&
Ordinaire ,
c'eíl: l'aífemblage de fons réguliérement combinés, qui
conviennent au genre de la piece de rnufique. Dans
la mufique moderne, chaque piece a une fuite régu–
liere
d'accords
fondamentaux' qui aidenc a déterminer
Ja mélod ie. Les
accords
fuppofrnc une nmfique
a
plu–
Jieurs parties : de
Ji
vient que les anciens n'en ene
point parlé.
La premiere
&
la plus- e!fentielle parcie de 'la com–
poütion moderne, roule fur la coi1 r¡oiífance de .tous
les
accords
done la mufique peut faire ufage,
&
íur
la maniere la plus avantageufr de les combiner. Nous
ne parlerons ici que de la narnre des
accords
en par–
tic ulier ;
leur combinaiíon wncerne
l'arcicle de
la
l\ÍloIJULATION.
On
















