
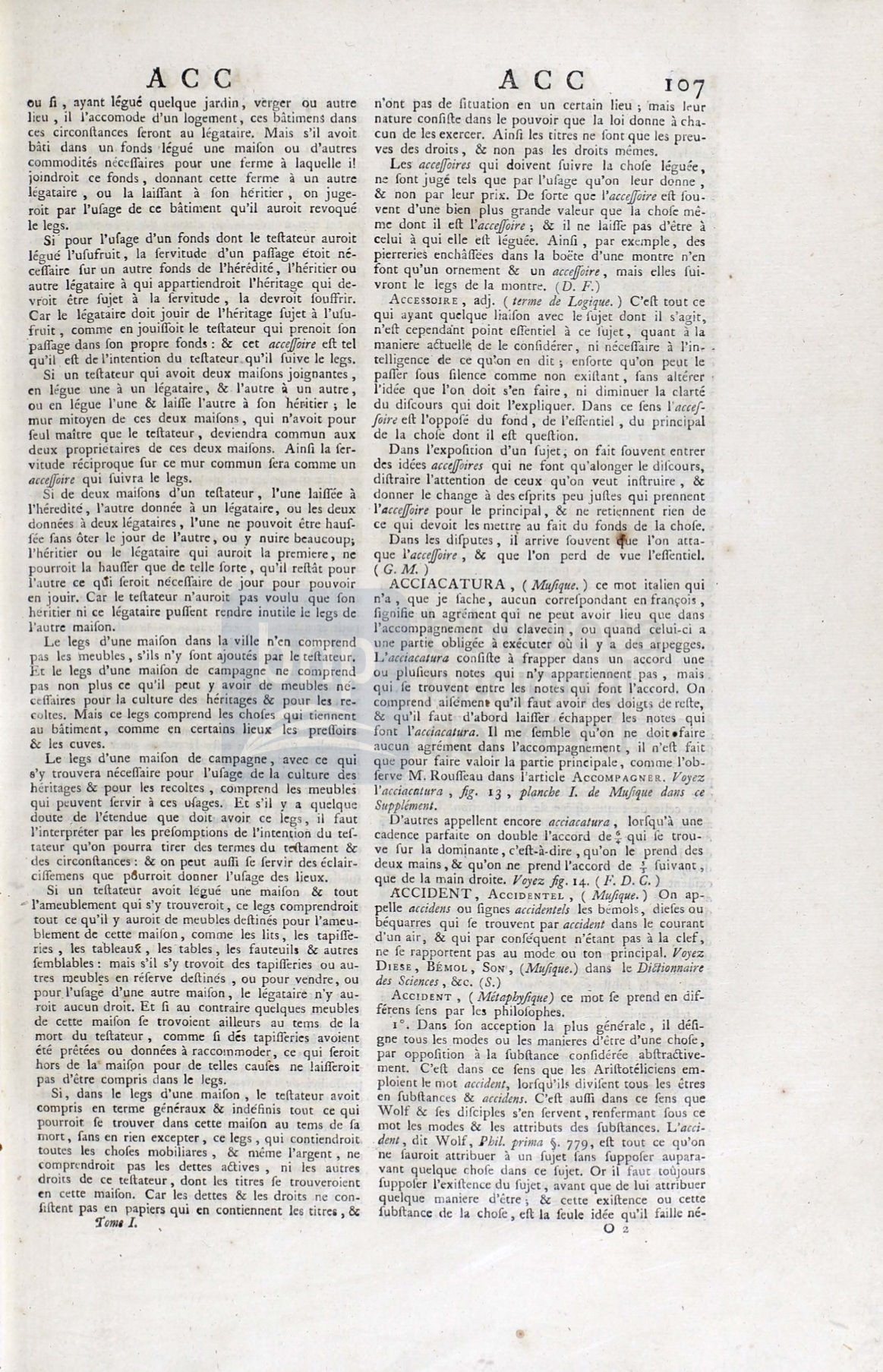
ACC
ou
fi ,
ayant légué quelque jar<lin, vé:rger ou autre
lieu , il l'accomode d'un logement, ces batimens dans
ces circon!lances feront au légataire. Mais s' il avoit
bati dans un fonds ·légué une maifon ou d'autres
commodités nécefTaires pour une ferme
a
laq uelle i!
joindroit ce fonds , donnant cecee ferme
a
un autre
légataire ' ou
la laifTant
a
fon
hé ritier '
on juge–
roit par l'ufage de ce batiment qu'il auroit revoqué
Je
legs.
.
Si · pour l'ufage d'un
~onds
d?nt le
teíl:ate~r ~uro!t
Jégué l'ufufruit, la ferv itude d, u!1 .
p_al!ag~ ~t?~t
ne–
cdfaire fur un autre fonds de l heredite,
1
hermer ou
autre légataire
a
qui
appar~iendroit l'hérita~e
qui d.e–
v roit étre fujet
a
la fervitude '
la devroit fouffnr.
Car
le
légataire d?it
_jo~ir
de l'héritage
~ujet
a _l'ufu–
frui t
comme en JOU1fT01t le teíl:ateur qui prenoit fon
·pafTage dans fon pr?pre fonds :
&
cet .
accefJ!ire
eíl: tel
qu'il eíl: de l'intenuoi:i du
.tdl:ateur. q~'il f~i~e
le legs.
Si un teíl:ateur qui avoit deux ma1fons JOignantes ,
en légue une a un
lég~taire,,
&
l'~utre
a
~?.
autre'
ou en légue l' une
&
lailfe
1
a~cre
a
foi:t
~er-1t~cr
; le
mur mitoyen de ces deux ma1fon.s , qui n avo1t pour
feul maitre que le teftateur, dev1endra commun aux
d eux proprietai res de ces deux maifons. Ainfi la fer–
v irnde réciproque fur ce mur commun fera comme un
accejfoire
qui fuivra
le
legs.
Si de deux maifons d'un teftateur, !'une lailfée
a
l' héredité ' l'autre donnée
a
un légataire' ou les deux
données a deux légataires , !'une ne pouvoit étre hauf–
fée fans oter le jour de l'autre, ou
y
nuire beaucoup;
l'héritier ou
le
légataire qui auroit la prcmiere, ne
pourroit la hauífer que de telle forte, qu'il refült pour
l'autre ce qi!i feroit nécelfaire de jour pour pou voi r
en jouir. Car le teíl:ateur n'auroit pas voulu qu<:: fon
héritier ni ce légataire pufü:nt re¡¡dre inutile le lcgs de
l'autre maifon.
Le legs d'une maifon dans Ja · vifle n'en comprend
p as les 'meubles , s'ils n'y font ajoutés par le tdl:aceur.
Et le Jeas d'une maifon .de campag ne ne comprend
pas non
°
plus ce qu'i l peut Y,
~voir
de meubles né–
celfaires pour la culture des hemages
&
pour les re–
coltes. Mais ce legs comprend les chofes qui tiennent
au batiment, comme en certains liemc
les· prelfoirs
&
les cuves.
Le legs d'une maifon de campagne, avec ce qui
e'y trouvera nécelfaire pour l'ufage de la culture des
héritages
&
pour les recoltes , comprend les meubles
qui peuvent fervir
a
ces ufages. Et s'il
y
a quelque
doute .de l'étendue que doit avoir ce legs, il faut
l'interpréter par les prefomptions de l'intentioil du tef–
tateur qu'on pourra tirer des termes du te'fiament
&
· des circon!lances :
&
on peut au!Ii fe fervir des éclair–
cilfemens que
p~urroit
dooner l'ufage des lieux.
Si un
te!lateur avoit légué une maifon
&
tout
• l'ameublement qui s'y trouveroit , ce legs romprendroit
tout ce qu'il
y
auroit de meubles defün és pour l'ameu–
blement de cette maiíon, comme les lits , les tapilfe–
ries , les tableaufé , les tables , les fauteuils
&
autres
femblables : mais s'il s'y trovoit des tapilferies ou au–
tres
meubl~s
en réferve def1inés , ou pour vendre , ou
pour. l'ufage d'une autre maifon, le légataire n'y au–
roit aucun droit. Et fi au contraire quelques meubles
de cettt: maiíon fe
trovoient ailleurs au tems de la
mort du teftateur , comme fi dés tapifferies avoient
écé prétées ou données
a
raccommoder, ce qui feroit
hors de la maifpn pour de telles caufes ne lailferoit
pas d'etre compris dans le legs.
Si, dans le legs d'une maifon , le teftateur avoit
compris en terme généraux
&
indéfinis to\lt ce qui
pourroit fe
trouver dans cette maifon au tems de fa
mort , fans en rien excepter, ce legs , qui contiendroit
toutes les chofes mobiliares ,
&
méme l'argent , ne
cornprrndroic pas les dettes aétives , ni
les autres
droits de ce te!lateur, dont les titres fe crouveroient
en cette maifon. C ar les dettes
&
les droits ne con–
fiíl:ent pas en papiers qui en contiennent les titre¡¡ ,
&
'.lom1
l.
,
A
e e
10
7
n'cint pas de fituatio n en un certain lieu ; ·mais
l~ur
nature confi!le dans le pouvoir que la loi donne
a
cha–
cun de les exercer. Ainfi les citres ne fonc que les preu–
ves des droics,
&
non pas les droies mémes.
Les·
accejfoi1·es
qui doivent fuivre
la chofe
lég uée ,
ne fone jugé tels que par l'ufage qu'on
leur donne ,
&
non par leur prix. De forte que
l'accejfoire
eíl:
fou - .
vent d'une bien plus grande valeur que la chofe me–
me dont il eíl:
1'
accejfoire
;
&
¡¡ ne lailft: pas d'éere a
celui a qui elle e!l: lég uée. Ainfi , par exemple, des
pierreries enchalfees dans la boec<:: d'une montre n'en
font qu'un ornement
&
un
accejfoire ,
mais elles fui–
vront le
legs de la montre.
( D. F.)
AccEsso1RE, adj . (
tmne de Logique.)
C'eíl: tout ce
qui a)1ant quelque liaifon avec le fojee don e il s'agit,
n'efr cependánt point effeneiel
a
ce l"ujet' qu ane a la
maniere aél:uell¡; de le confidérer, ni néctlfaire
a
l'in–
telligence · cle ce qu:on en die ; en force q u'on peut le
palfer fous
filence comme non exi!lant , fans alcérer
l'idée que l'on, doit s'en faire, ni diminuer Ja clareé
du difcours qui doit
l'~xpliquer.
Dans ce fens
l'accef–
foir~
efr l'oppofé du fond, de l'elft>neiel , du principal
de la chofe done il eft que!lion.
D ans l'expofition d'un fujet; on fait fouvent enerer
des idées
accejfoires
'qui ne font qu'alonger le difcours,
diíl:raire l'aetention de ceux qu'on veue iníl:ruire ,
&
donner le change
a
des efpries peu j uíl:es qui prennent
l'accejfoire
pour le princ ipal,
&
nt reeic;nnene rien de
ce qui devoie les
mettr~
au fait du fonds de la chofe.
D ans les difpuees ,
il arrive fouvent
e l'on atra-
que
l'accejfoire
,
&
que l'on perd de vue l'elfentiel.
(G.M.)
.
ACCIACATURA , (
Mujique.)
ce mot italien qui
n'a , que je fache , aucun correfpondant en
fran~ois
,
fig oifie un agrément qui ne peut avoir lieu que dans
l'accompagnement du clavecir¡ , ou quand celui-ci a
une partie obligée
a
exécuter ou il
y
a des arpegges.
L'
acciacalura
confiíl:e a frapper dans un accord une
ou plufieurs notes qui n'y appartiennenc pas , mais
qui fe trouvent entre les notes qui font l'acco rd. On
comprend ,aifément qu'il faut avoir des
doigt~
de rcíl:e,
&
qu' il faue d'abord lailfer échapper les AOtts qui
fon t
l'acciacatura.
11 me femble qu'on ne doi e. faire
aucun agrément dans l'acco_mpagnemenc , il n'eíl: fait
que pour faire valoir Ja partie principale , comme l'ob–
ferve M. Roulfeau dans l'arcicle AccOMPAGN ER.
Voyez
l'acciacatura
,
jig.
13 ,
planche
l.
de Mu.fique dans ce
S11pplémenl.
,
D'autres appellent encere
acciacatura,
lorfqu'a une
cadence parfaite on double l'accord
de~
qui fe::
trou–
ve fur la domjnance, c'eft-a-dire, qu'on
le
prend dc;s
deux mains,
&
qu'on .ne prend l'accord de
+
fuivant,
que de la main droite.
Voyez jig.
14.
(F. D.
C.)
ACCIDENT, AccJDENTEL,
(Mu.fique.)
. On ap–
pelle
accidws
ou fignes
accidentels
les bémols, ·diefes ou
béquarres qui fe
trouvent par
accident
dans
le
courant
d'un air.
&
qui par conféquent n'étant pas a la clef'
ne fe rapportent pas au mode ou ton principal.
f/oyez
D1 EsE , BÉMOL , SoN ,
(Mujique.)
dans
le
Diflionnaire
des Sciences ,
&c.
(S.)
AcciornT, (
Métaphyjiq11e)
ce 1ñot fe prenden dif-
férens fens par les philofophes.
.
1
º.
Dans fon acception la plus générale , il défi–
gne taus les _modes ou les manieres d'erre d'une chofe ,
par oppofüion
~
la fub!lance confidérée abíl:raél:ive–
ment. C'eíl: dans ce fens que les Arif1otéliciens em–
p loient le mot
accident,
lorfq 'ih divifent taus les etres
en fubf1ances
&
accidens.
C'eft auffi dans ce fens que
Wolf
&
fes difciples s'en fervent, renfermant fous ce
mot les modes
&
les attributs des fubíl:ances.
L 'acci-
.
dent,
dit Wolf,
Phi!. prima
§.
779, eíl: cout ce qu'on
ne:
fauroit attribuer a un fujet fans fuppofer aupara–
vant quelque c:hofe dans ce fujet. Or il faut toíljours
fuppofer l'exiíl:ence du fujet, avant que de lui auribuer
quelque maniere d'etre ;
&
cette exiftence ou cette
fubftance de la chofe , eíl: la feule idée qu'il faille
né~
o
2
















