
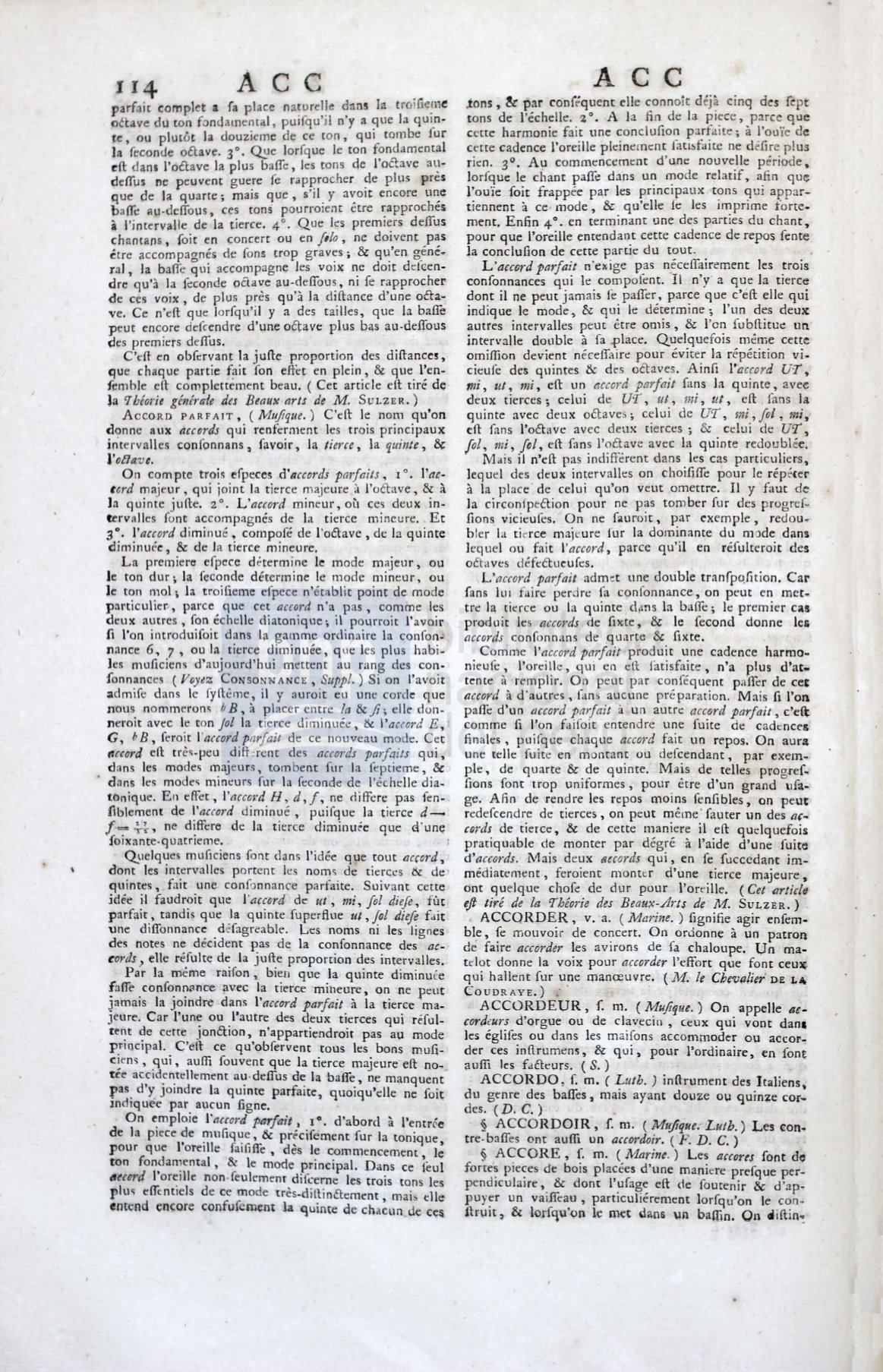
i
1
4
A
e e
parfaic complet
a
fa
place
na~u re!!e ~ans
la troíÍle!né
oétave du con fondamental , pu1fqu
il
n
y
a 9ue la quin–
te
ou plutót la douzieme de ce ton , qui combe fur
Ja 'reconde oél:ave.
3º.
Q!ie lorfq ue Je con f?ndamcnral
eft dans )'oél:ave la plus balfe , les rons de
1
oétave at!–
delfµs ne peuvent guere fe
rapprocher
~e
plus p res
que de la quarte ; mais que, s'i l.
y
a~OJ t
encore
u~e
b alfc au-de!fo11s,
ces
rons pou rro1en t ¡:ere
~approches
a
l'intcrvalle de la tierce. 4
o.
Que ks prem1ers ddfus
ch antans
foit en concert ou en
falo ,
ne doiven t pas
étre
acco~pagnés
de fons trop g rav:s ;
&
q~'en
g_éné.
ral, Ja balfe q ui accompagne les vo1x ne do1t det<¡en–
dre qu'a la f.:conde oélave ¡m-delfou s , ni fe rapprocher
de
ces
voix ,
de
p ius pres q
u'~
la diftance d'une oél:a–
ve. Ce n'eíl: que lorfqu' il
y
a des tailles, que la baffe
p eut encare defcendre d'une
o~ave
plus bas au-ddfous
des prcmiers deffus.
C'dt en obfavant la juíl:e proportion des diftances,
que chaque partie fait fon efte t en plcin,
&
que l'en–
femble eft complettément beau. ( Cet article eft tiré de
la
'Théorie génér4{e des Beaux arts de M .
SuLzER.)
A ocORD PARFA JT, (
Mujique.)
C'eíl:
le
nom qu'on
cfonne au x
accords
qui rcnfrrment les trois
principau~
intervalles confonn&ns, favoir, la
Jierce ,
la
quinte'
&
J'oflave.
On com pte trois efpecos
d'accords parfaits ,
1
º.
l'ac–
t ord
majeur' qui joint la tierce majeure
a
l'oél:ave ,
&
¡¡
Ja quinte jufte.
2
º.
L 'accord
mineur,
011
ces deux in–
t ervalles fo nt accompagnés de
la
tierce mincure. . E t
3°.
l'accord
diminué , cornpofé de l'oél:ave, de la quinte
diminuéc,
&
de Ja tierce rnineure.
La premiero efpece détermine le rnode m ajeur, ou
Je ton dur; líl feconde déterrnine le mode rnineur, ou
le ton mol; la troi fierne efpece n'étab lit point de mode
p articu\ier, , parce que cet
accord
n'a p as, comme les
deux atmes, fon échelle di atoniqt1e; il pourroit l' avoir
fi
l'on introduifoit dans la gamme ordinaire la confon,
nance
6, 7,
ou la tierce diminuée, q lle les plus habi –
les muficiens d'auj ourd'hui mettent au rang des con–
fonnances (
//oy~z
CoNSONNANCE,
Suppl.)
Si on l'avoi t
admife dans
le
fy íl:en1e, il
y
auroit eu une carde que
nous nommeron.•
b
B,
a
pl acer entre
la
&
Ji;
elle don–
neroit avec le ton
jo/
la t ierce dirninuée ,
&
l'accord
E ,
G, b
B,
feroit
l"accord pa1Jait
de ce nouveau mode. Cet
t:ccord
eíl: tre•-peu difrerent des
acco1·ds parf4its
qui ,
d ans les modes majeurs , tom bent fu r la feptieme ,
&
d ans les mode< mineurs fur la feconde de l'éc helle dia–
tonique.
En
dfet,
l'accoi·d
H,
d ,f,
ne differe pas fen–
flblement c\e
l'accord
di minué , puifque la t ierce
d –
f
=!,-!., ,ne difft:re de la
tierce
dimin~1fr
que d 'une
foix ante-quatrieme.
1
Quelques mulicions font da ns l'idée que tout
acrord,
dont les intervalles portent les noms de tierces
&
de ·
quintes, fait une con fo nnance p arfaite. Suivant cette
jdée il faudroi t que
l'accord
de
ut, mi,
fa! diefe ,
fUt
parfait, tandis que::
I¡¡ q uinte fqperflue
ut, Jo! diefa
fait
une d ilfonnance défagreable. Les noms ni
les lignes
des notes ne décident p as de la confonnance des
ac–
eords,
elle réfulte de la jufte proportion des intervalles.
Pa'r la méme raifon, bien que la quinte diminuée
falfe .
confo_n~a nce
¡ivec l,a
tierce mi11eu:e , on ne pc::u t
Jama1s la JOmdre dans
1
accord parfait
a la tierce rna–
jeure. Car l'une ou l'autre des deux tierces qui réfu l–
te~t
de cctte jonétion, n'appartiendroit pas au rnode
pnocipal. C 'eíl: ce qu'obfervent tous lc::s bons mu1i–
c1em ' qui' aum fouvent que la tierce majeure eíl: no,
tée
ac;id;~tdlement
ª':1·ddfus
d~
la
baff~,
ne manquent
pas. d
Y_
3omdre la quinte parfa1te, quo1qu'elle ne foit
rnd1quee par aucun figne.
On
~mploie
f auord parfait
,
i
º.
d'abord
a
l'entrfo
de la p1ece ?e ?1ufiq':1e ,
&
pr~cifément
fur Ja tonique,
pour que
1
ore11le
fa11i lfe , des le commencement, Je
ton
fon~an:emal
,
&
le mode _principal. D ans ce kul
tJuord
1
oreille non-feulemenr difcerne les trois tons les
plu~
dfcntiels de ce mode tres-dilt inél:ement, mais elle
C!lltend encare confofi
ment
1a quinte qe cl¡acun
de
ce;~
ACC
.tons,
&
par conírquent elle connoit
déj~
cinq des fcpt
tons de l'échelle.
-zº.
A
Ja fin de la p1ece, parce que
cctte harmonie fai t une conclufion p arfaite;
a
l'oui"e de
cette cadence l'oreille pleinemcn t fati;faitc:: ne défire pl us
ríen.
3º.
Au commencement d' une nouvelle p ériode ,
lorfque le chane paffe dans un r:iode relatif, afin que
l'oui"e foit frappée par les prrnc1paux t?ns
Cjlll
ª J?par–
t iennent
a
ce mode,
&
qu'elle fe
les
un
prime íorte–
ment, En fin 4
º.
en terminant !.lne des parties du chane,
pour que l'oreille entendant cette cadence de repos fente
Ja concluflon de cette partic du tout.
L 'accord parfait
nºexige pas nécelfairement les
~rois
confonnances qui le compofent.
11
n'y' a que la t1erce
dont il ne peut j amais fo_paífer_.
par~e
que, c'eíl: elle qui
indique le mode,
&
qu! le
de~ermrne:
1
un
d~s
deUlc
autres intervalles peut etre 01111s,
&
len fubíl:1tuc:: un
intervalle double
a
fa
.place. Quelquefois meme cette
omillion devient nécelfaire pour év iter la répétition vi–
cieufe des quintes
&
d es oél:aves. Ainfi
l'accord UT,
tni, ut, mi,
eft un
accord parfait
fans Ja qu inte, avee
d eux tierces; cdui de
U'I ,
ut_, mi , ut ,
eft
fa ns la
qu inte avec deux oél:aves ; celu1 de
ur ,
sni '
fal'
mi,
dl
fans l'oél:ave avec deux tierces ;
&
cdui de
U'T,
fo!, mi ,
fol,
eíl: fans l'oétave avec la qu inte redoubl ée.
M ais il n'eíl: pas indi ffé rent dans les cas particuliers,
lequel des deux intervalles on choifiífc:: pour
le
rép~er
a
la pl ace . de celui qu'on vem omettre.
II
y
faut
de
Ja
cin::onfpeél:ion pour ne pas tomber fur des progref.
fions vicieufes. On ne fauroit, par exemple, redou.
b ler la ti crce majeure fur la dominante du mode dans
lequel ou fa it
l'accord ,
parce qu'il en réfulteroit des
oél:aves défeétueufes.
L'accord parfait
admet une double tranfpo.lition. Car
fans lui faire
perd r~
fa
confonnance, on peut en mcr.
tre
la tiercc:: ou la quinte
d~ns
la balfe; le premier cas
produit les
accords
de fixte,
&
le
fecond don ne
le&
accords
confonnans de ,q uarte
&
fücte.
Comme
l'accord parfait
produit une cadence harmo–
nieuíe, l'oreille , qui en eft fati sfaite , n'a plus d'at–
tente
a
remplir. Oo peut par conféq uent p affer de cec
(lccord
a
d "autres , fan s aucune préparation. Mais
f¡
l'on
p affc:: d'un
accord parfait
a
un autre
(lccord parfait ,
c'e{\:
comme fi l'on faifoit entendre une fuite
de
cadc:nces
fin ales, puifque chaque
accord
fait un repos. On aura
une telle fu ite en montant ou defcendant, par exem.
ple, de quarte
&
de quinte. Mais de telles prog.ref,
fions fon·t trap uniformes , pour erre d'un grand
nfa–
ge.
A
fin de rendre les repos moins fenfibles, on peut
redefcendre de tierces, on peut meme ' fauter un des
a<–
co;'ds
de tiercc::,
&
ele cette maniere il eft quelquefois
pratiquable de monter par dégré
a
l'aide d'une fuite
d'accords.
Mais deux
aecords
qui, en fe fuccédant
im–
médiatement, feroient montt r d'une tierce majeure,
ont quelque chofe de dur pour l'oreille.
(
Cet
artic!~
fjf
tiré de la 'l"héorie
des
Beau¡c-Arts de M.
Su¡.zER.)
, ACCQRDER, v. a.
(Marine.
)
fignifie agir enfem–
ble, fe mouvoir de concert. On ordonne
a
un patron
de faire
accorder
les avirons de
fa
chaloupe. Un ma–
ttlot donne la voix pour
a(corder
l'elfort que font ceul(.
qui h allent fur une q¡ana;:uvre. (
M.
le Chewi/ier·
DE 1.4
COUD RAYE . )
:
,
ACCORDEUR,
f.
m. (
Mujique.)
On appelle
ac–
cordeurs
d'orgue ou de clavecín , ceux qui vont dana
les églifes ou dans les maifons accommoder ou acco!'–
der ces iníl rumens,
&
q ui, pour l'ordinaire, en font
¡¡ uffi les faél:eurs. (S. )
ACCORDO, f. m.
(
L uth.)
inftrument des ltaliens,
du genre des baffes, mais ayant douze O\l quinie car–
des.
(D.
C.)
·
§
ACCORDOIR,
f.
m. (
Mujique.· L utb.)
Les
~on.
rre-baffes ont auffi un
4ccordoir.
(
F. D.
C. )
§
ACCORE ,
f.
m. (
M.arine.
)
Les
auoru
font de
force~ pie~es
de bois
pla~ées
d'une maniere prefque per–
pendicula1re,
&
dont
1
ufage eft de foutenir
&
d 'ap–
puyer un vailfeau, particuliérement lorfqu'on le con–
fü\llt)
&
lo¡ fqu'Qn le met dans \ln baffin.
On
Gi iftir¡~
















