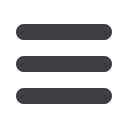
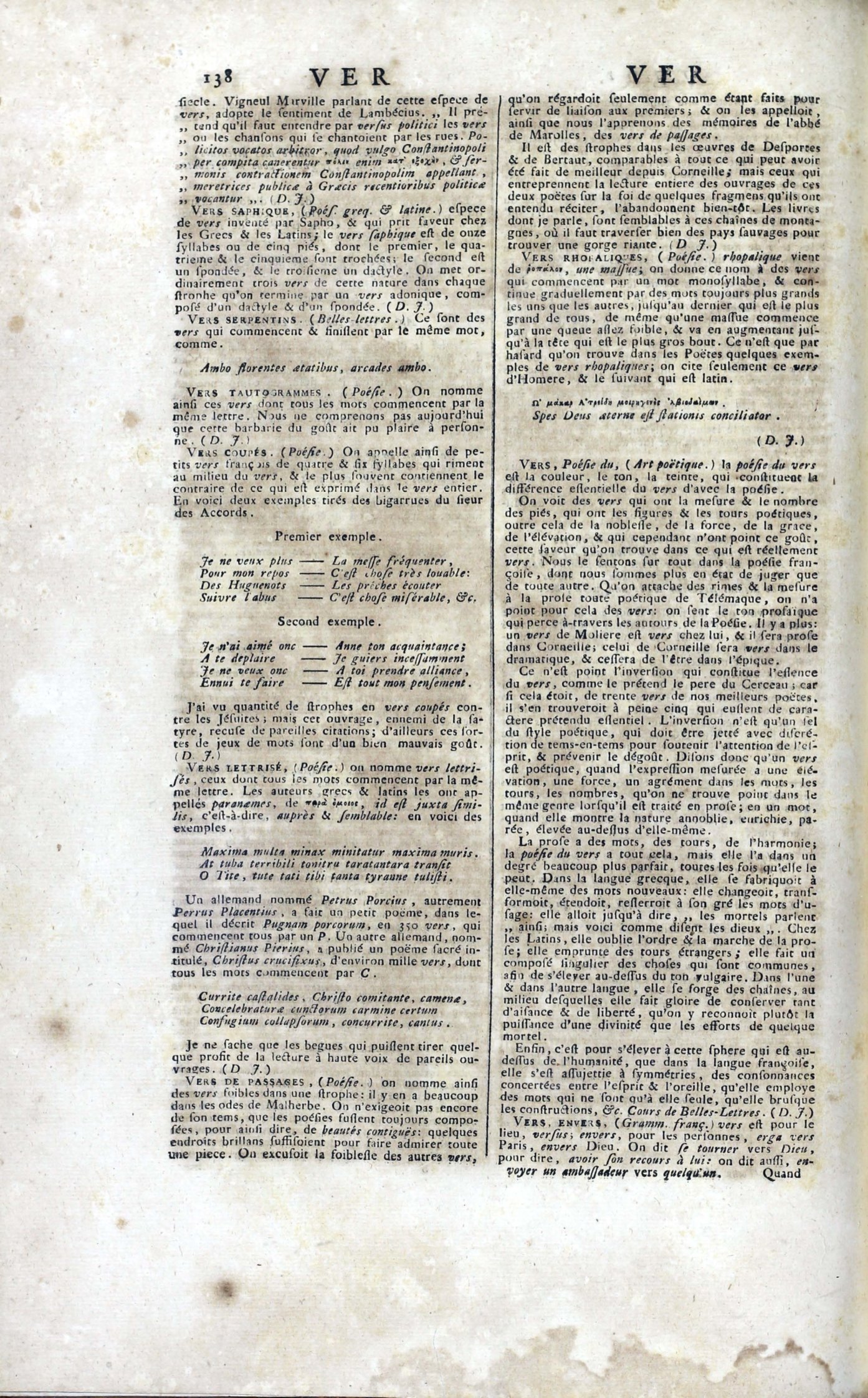
t
•
'
'
VER
_1iecle. Vi_gneul
M
trville parlant de cette efpel!e d_e
11ers,
adopte le (entimenr <le
Lambéciu~
•. ,_.
ll
pre–
" etl nd qu'il faur encendre par
'lln(Ñs poltttct
les
tJ~rs
., o u les chaníons qui fe chantoieot par les ruc:s.
Po~
,
licitas vocllt()s
~.f.i*fiqr,
lfiiOd Y,tflgo
.f!o:flantmopolt
,,
_ p~r, ~ompJt~ ¡¿anel-".f!ll~{lf· ró~,. ~111m
•."'"'.
!;'X~'
,
&.for–
"
moms corifl·ndío11em
Cóttj/alltinopo~tt!l. llppdl~n!
•
,
meretrices public.e
a
Gr.ecis rtcentt(Jrtbtu polzttc.e
;,
""
antt~r
, .
( D.
J .)
VERS SAPH ;QUI!.,
(<RfJéf.
zm¡.
&
1Ati11e.)
eípece
de
vru.
inven té par JSapho,
&
qui p_rie
f¡¡ veur
che~
les Grecs
&
les Lariqs¡ le
vrrs (aph.tqtlt
_ell: de onze
fyllabes ou de cinq piés, done le premrer, le qua–
trierne
&
le ci nquieme fo nt
tro~h ées ;
le
íecond ell:
un (poodée ,
&
le ero ilicme un daétyl'é. On mee or–
dinairemene trois
verf
de cerre ri aeure dans chaque
fironhe qu'on
~ermine
par
un
v~rs
adonique, com–
pof~
d'un da ét yle
&
d' u11
ípondée.
(D.
J . )
VERS
SER¡.>ENTI
s . (
Be/Les -lettres.)
Ce íont des
'fi~YS
qui Cornruencent
&
finiílent •par
1t
m~
me mOt
>
c:omme.
Ambo florentes .etat
ibJu,
11ru1de.r
.11111bÓ.
Vus
TAUT9 :JRA. ~IMES
•
(Poé(ie.
) On nomme
ainfi ces
vers
done rous les mors commencent par la
méme Jenre.
N :Ju's
ue
CoQ1prenons pás aujo'urd!hui
que
cerre barb:trie du
goí\~
ait pu plaire
a
perfon..
ne.(D. .J. l
Vus
cou rh.
(
Poéji~ ·. )
0 •-1
aroelle ai!lli ,de pe–
t its
wrs
fra n~.>ls
de ql}arr,_e
&
.lit fyllabes qui rimeDt
1
á
u milieu du
vers,
~
le
pl,u.~
íouvenr
co,r~tiennen_t
le
contraire cic ce qui
erl
ele
primé dú1s 1e
'Vers
ent1er.
En
voki deux exem,p-les ürés des
uiga~rue5
cdu
fi~ur
d:es
Accords.•
Premier ei'l!mple.
je
ne
'f)f!IIK
pitts
~· La
mt:/[e
.frh¡uenur,
Po11r mon repos
- .-
·
C 'eft
tbq(e
tres iouable:
Des
Ht~g11mots
--
Les prh-hes écotJter
Suivre
l'a._btt-s
--
C'ef/ chofe mi(ér11ble,
f:ff.
Second exemple •
VER
qu'onrégardoit feulemcrnr C'_omme
étapt
fairs
~~~r
íerv.irde liaifon aux premiers ;
&
on
les
appeiJoit ,
ainfi que nous l'appreno11S des mémQires de l'abbé
de Marl.llles, des
vert
ti~ p¡¡.ffag-e~
•
11
ell: des !lrophe.s dar1s
. l~s ~uvres d~ Deípol't~s
~
de Bertaot, <;onwaraqles a
to~t
ce qp.r peut avoir
éeé fait de mdlleQr deHuis Corneille; mais eeux qui
entreprennent la leél:ure' eotiere des OUVt:ages
de
C~'
deux poetes íur la foi de quelques fragrnens,qu'ils ont
entendu réciter,
l'aband01~oeQt bie-n-t~t.
Les
livr~s
dont je parle, font ÍemblabJes
a
ces .chaí'nes de
ffiOFita–
gnes, ou il faut traveríer bien des pays íauvages
pour
trouver une gorge ria,nte.
(
lJ_
J.)
.
'
.
VERS RHOFÁLIQ,E;ES,
(
Poijie.) rl,op,11ilque
vrent
de
;•
.,..¡M,,
une
!llllJ/fle;
Qn donne ce uom • des
vus
qui commencent p"r un . mor mono(yllahe,
&
c.o"–
tinu.: araduellement p¡¡ r des_muts t<;>UJ o urs plus grao<{s
tes
un~
que lt!s aucres, julqu'au dernjer
q-ui
e¡lle plus
grand de
tou~,
de
n,~rne
qu'une maffue comrnenc.e
par une queue
afll:!z
fp ihle,
&
va .en augmentant juf–
qu'a la t!ce qui ell: le plus gros bout.
Ce n'efi
que
par
hal~rd
qu'on crouve
d¡~ns
les Poeces quelijues e¡cem–
ples de
'fJCYI
rhopaJiques
i
on Cite feuJeme.11t Ce
.'~ITI
d'Homere,
&
le fuivant qui ell: latin.
n' ,.,.._,
,.•
.,.,,¡¡.
"'"P•'l'"l'
•
...
fi,.Jal,.,.., .
Spes
De1u
.ttern-,
«}1
flationis co11ciHatar
•
(D.
'J.)
VERS,
Poéfie
du__,
(
Arl _,oitique.)
l:a
poijie
-t/11
Wt't
.e¡(l
la couJeur, le con, la teince, qui -conll:itueo(
¡¡a
. ~ilféren~e
eílenrielle du
vers
d'avec la
po~6e.
Qn
v~it
des
'Vers
qui ont la meí11re
&
le nombre
des piés, qui ont les figures & les tours pol!eiques,
o uere cela de la noblefle, de la forc
e, dela grace,
de l'élév-¡gion,. & qui cependaoc n'mtt
poi.ntce
goür,
cerre Javeur
~u!on
rrouve dans c,e qu
i ~r~eltement
vers.
Nogs
le
ten~ons
Íl[lr
tO,?t dans lA poéfie fran–
<;oil'e,
door
oo,us Iom
roes
plus en éta.t de .j
uger ·que·
de roqce
a~tre
.. Qn,'qn íltiaci.)e des
ri '1u~s
.&
I.Jlrnefure
a
la prole roat-3 poétiqne de Téfémaqu
e, on n'a
poif)t pour cela de$
flltrs:
911
fent
le
t (j)l(l
l(>fQf¡fi~ue
,qu\
perce a-tr.avecs les a
o
rours de la
.P~éúe.
11
y
a plus:
1.10
,tJers
de M o liere efi
vers
chez lui, .& il íera
~rofe
dans C o rAeille; celui de 'Corneille fera
•tltr.t
darts le
~ramarique,
&·
c~lfera
de l'icre dans
l'~p~<¡ue
.Ce
n'e~ poiQ~
r'in-verfioo <)Ui
con(lit~~ l
'e.fl~
nceJe.
t~'l!Í
•.
11ür!é
onc
--
Annr ton
a~·qr~tl;lltt11J;e;
A
te
tftplaire
--
]e gui_ers mce./fo1?1111tllt
J~
flt!
ve11-x onc
--
4
toi prentire
ll~li11nce,
Ennui
te
f11ire
--
Eft.
to11t mo11 penfime'11.
J'ai vo quantité de !lrophe5 en
yert co11pé.r
con–
.tre les
Jéínite~
; m!li$ cer ouvrage,
enn~mi
de la fa·
tyre, recure
d
e pareilles ciracions; -d'ailleurs ces for–
res de jeux de
mo.tsfant
d~uo
bie-n mauvais go¡1c. ,
¡ D. ].)
• ,do
flers,
comme le prétend le pere
da
Cerce
au;
c.arfi cela l!coit, de trence
verr
de nos meilleurs poe
res,.ji
5'en trouveroit
a
peine cinq qui euflent de ¡::ara–
élere _prétcnciu eílentiel. L'inverfion · n' ell: qu',l,ln f el
du
~-y
le poétique, qui doit c!tre
jetté avec ddcré–
·tion de rerus-en-tems pour foutenir l'.rnrenti0n de l' c l::.
prit,
&
prévenir le dégoí)t. Dilons dooc ·qiJ ' I,Jn
v ers
~p;~~¡,s
LET T
R,J~t,
.(
Pqijir.)
.on
n~mme
vers lettri–
fls,
ceux dont cous les ·n,lc;>ts coml'flencent par la
m~¡ne Jettre. Le.s auteurs
gr~c~
&
lacios les onr
ap–
-pellés
P'(lran~mi'S,
ele
w~p.l
.,...,.,,
.id
efl juxta· jimi-
'
Jú,
c'efi-a-dire ,
1111pres
&
fimblable:
en v-oici des
ex\!mples .
MAXttflil
m11Jtt1
mina.x minitatur .
maxima
mur.is.
-At
t r1ba terribili ·to>1Ítru taratantara tran
¡itO Tiu, t11te tati
¡i~j
Frmta .tYrf!UIJe .tuli}!i
~
Un atlem¡¡nd nommé
'Betrru ,P.Órcius
, aurrement
Perrtlf
Pl~cintius,
a (a!r un petit poem'e,
d.ails
le:
.queJ
il
décr,it
J!11gn_am porCQYIIIIJ,
,el)
3)0
'Jiert,
qui
cmnnier1cent rous p¡¡r un
P.
U
o
autre al'lemand,
~on)
rné
Chri/l)anu~
Pieritu,
11
puolié un poeme facré in–
o~~itulé,
(;hrijltu
cr!lcifixu~·.,
d'environ mille
ver!,
done
toas les moes
c;o..~m~encent
par (; .
<9urrite
'i,a¡lt¡lides ,
.Chrjflo cqmittmte,
camen~t,
Coruelebr.aturte cm¡élqrtltp tarmine etrtmn
·
Conf11giu11J
cullt~p.(ortlm,
coi?t·qrrite, fllnlfls
•.
Je ne fa che que
.les
begues qui _p_uillent tirer quel–
que profie de la leéture
a
haute
VOÍX
de pareiJs OU•
vrap;es. (
D
.J.)
·
' •
e!l poétique, quand l'expreffion mefu.rée
a
une
lflé–
va~ion,
une force, un agrément dans les n,tqrs, ,les
rours, les nombres, qu'<>n ne
crou~~;e
poinf
d.-lll·S
le!
. m~me ge-nr~ lorfq~'il ~11: m~iré
eo
prof'e; eo
90
m~,
quand
el!~ rnOI)tr~ 1~
nat'lJI:!! anQob\ie, euriah·ie,
pa-
rée, élevée au-dei'JtH
d'!i!lle-nH~me.
J.a profe a des mots,
d~s ro~n,
de
1
har.monie;
Ja
p11ijje dtl '!Jer¡
a,
rouc ,eela
~
mús elie 1'11 11iJ,ans nh
degré beapcoup plus J>3_rfait, tou¡es ·l!3s fo(s _q,u\elfe le
~p;eut , J~hns
kt
laogo~
grec;que'
.e-11~
íe fabriquo ir
a
!!11!!-tpEme. <Jes
~ors nolJv~aux:
e
JI!!
cl}angeoit, eran f.
formoit,
é~el)dOit,
•te_llerrojt
a
ÍOI) gré )es
11)0~5
d'u–
f¡¡g
e: elle alloit jufqu'a di
re~,~.
les
morr~ls
parlent
,
~i.nG;
mais yofci comme <'litept
l~s di~ux
,',. Chez
les
~atins, el~e
ouplie l'ordre
j,j.
la marche de la pro–
fe; elle
~mprunt~
d
es~ours
fcrangers;
elle
fait un'
compoíé li llguJier
<l.esci)Gfes ·qui íont c.o•umunes,
a.tjo
·de s'éleyer au-5f
e(fus du ,too
•Julg~ire.
D .tns l'une
&
d~ns
l'au,tre langue , elle fe forge d!!S cl)atne$ ,, a
u
milien
deíquelle~
elle ·
fai~
,gloire de coníerver rant
d'aifance
&
de Jiberté, qu'on
y
reconnolr plurOr l:t
puilfJnee
d'un~ qivinit~
que les efforts de quelque
mortel.
·
VER.f!
o~ P~~!?A:.~ES,
(po;¡fe.
,)
'o¡;¡ nomrtle :¡inli
des
veYJ'
foibles dans une llrophe: il
y
en a pe3·ucoup
tla ns
·les odes
de
J\1al-hl!rbe. On n'exigeoir pa$ eocore
de
íon
cems, _ q~c ~~~
pqé¡ies ruqent
t~ujours
campo":'
(.ées, pour
:alllh
drre.,
~e
ptatlt!'f
fOll!tgflf.f:
qu~Jques
endro~ ts Qnllan
~ fufliíor.ent pour faire admirer' route
\me piece. pn
e.xc~folt
la foibleile des autres
fl.lrs,
En
ni),
c'e(l pour s'éJever
~ ce~:re fph~re
qqi
!!fl
.au–
d~ffus
de. l'hull')aoité, que daos la l,angue fran'!oife,
!!lle s'ell:
a{fuje~tj~ ~ Ífrt}mé~ries
,
~!!S
confonnances
~oncerc~es
entre l'efprit & l'oreille, qo'elle
~mploye
.des mots qui ne Tont qu'a eiJe feule, qu'eJle bruíque
Je~
conflruélions,
~p.
(:or1rs de
~el/e~-Lettre¡.
(D.].)
1
.
V~a~ , E~V.~ R ~,
(
Qrq11f1/1 ..
fra11f~) ver~ ~tl
pour le
· heu_,
tJerfos; envert,
pour lt:s pertonnc-s,
erg11 'l.:ers
Pans,
enwrs
Dieu. On dit
fo
touriur
vers
Dieu,
,pmlr
di
re'
avoir fin recours
a
luí ..
on dit
aufli,
eii-
.
)
..
-
.. . .
'PII)'tr
!!'!
~fl!bll/!•~~~~r
yers
t¡uei,IJiJU!~
· Qu.¡nd
















