
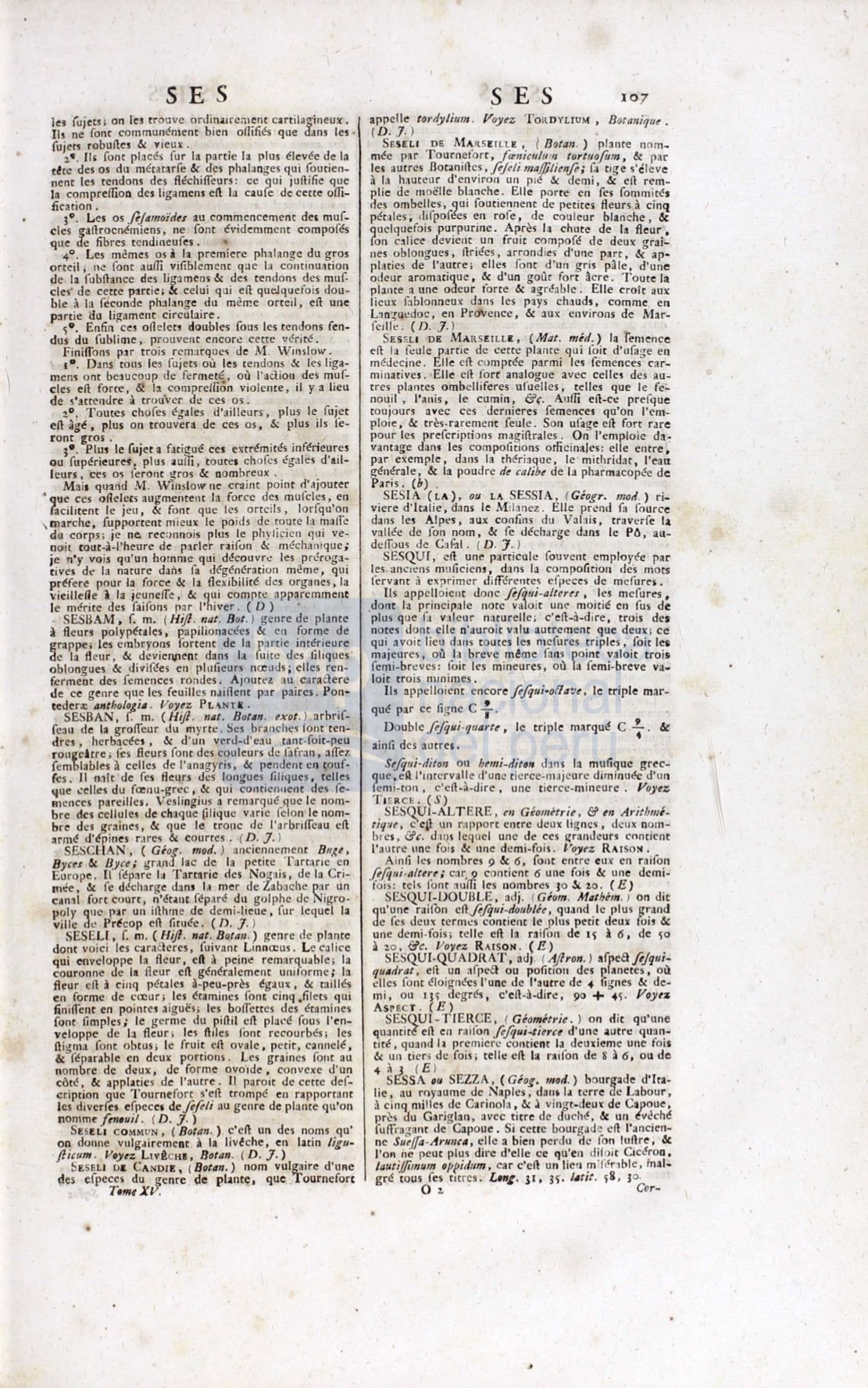
S E S
}e9 (ujecs; on les trouve
ordi.na1re:n~nt carcila~ineux.
Ils ne font communémenc b1en ofhfiés que aans les
fujers robunes
&
vieux .
2 •.
11•
font placés fur la parcie la plus élevée de la
tlcc des os du mécacarfe
&
des phalanges qui foucien–
nenc les tendons des fléchiffeurs: ce gui junifie que
la comprellioo des ligamens en la caufe de cecee offi–
ficacion.
JQ· Les os
flj4moi"du
au commencement de' muf–
cles ganrocnémiens, ne fonr évidemmenc compofés
que de libres tendineufes .
.¡
0 •
Les memes os
a
la premiere phalange du gros
orceil
¡
ne fonc auffi vifiblemcnc que la concinuarion
pe la fubnance des ligamens
&
des tenclons des muf.
eles· de cecee parcie;
&
celui qui en que.lqu efois dou–
ble
¡¡
la feeonde phalange du meme orceil' en une
parcie ilu ligamene circulaire.
~
0
•
Enfin ces o!l eleu doubles fous les tendons fen–
dus du fublime, prouvenc eneor.: cette véri cé.
Finiffons p1r trois remarque• de M . Wi11slow.
1°.
Daos rous les fujccs ou les rcndons
&
les liga–
mens ont beaucoup de
f~rmecé,
ou l'aé\io11 des muf–
eles en forre,
6t
la
comprellion violente, il y a lieu
de s'attenúre
a
trou'ver
de
ces os .
2.
0 •
Toutes ch¡¡fes égales d':tilleurs, plus le.
fuj~t
..
en
~gé.
plus on trouvera de ces os,,
&
plus lis !e–
ront gros .
3•.
Plus le fujet a fatigué ces extrémités inférieures
o
u fupérieuref, pi us
~ulli,
roures ehofes égales d'ail–
leurs , ces os fero11t !{ros
&
oomhreux .
M ais quand
M.
W1ns!mv ne craint point
rl'~jouter
• que
ces o!lelecs augmentenc la force des mufclcs, en
faciliten e le jeu ,
&
font que les ortei ls,
lorfqu'on
, marche, fupportent mieux le poids de toute la marre
du
corps; je ne recannois plus le phylicien qui ve–
noit tout-a-l'heure de
p~rle'r
raifun
&
méchan1que;
je n'y
vois
qu'un homme qui
découvr~
les préroga–
rives
d~
la nature dañs fa úégénération meme , qui
préfere pour la
forc~
&
la flexibilicé des organes, la
vieilleUe
l
la jeuneffe ,
&
qui compt.: apparemment
le mérirc des (aifons par l'hiver . (
D
)
·
SE
llAM •
f.
m. (
Hijl .
nat. Bot. )
gen re de plante
a
fleurs polypétales. Jlapilionacécs
&
en
forme de
grappe¡ les embryons fortent de la p:trtie intérieu re
ile la fl eur ,
&
devicflllent dans la fui te des filiques
oblongues
&
divifées en plnfieurs na::uds; elles ren–
fermeot des femences rondes . Ajnutez au caraé\ere
de ce genre que les feu ill es ndiflent par paires. Pon–
tedera:
411t!Jo/~Í11. V~yez
PLANTII .
SESBAN,
r.
m. (
Hift .
1111t. Botan. exot.)
.arhrif–
feau de la groffeur du myrte. Ses branches {ont cen–
dres , herbacées ,
&
d' un verd-d'eau
tanr.foit-peu
rou¡:eirre ; fes fleurs font des cou leurs de tafran, a(fez
femblables
a
celles de l'anagyris'
&
pendene en tour–
fes . ll nait de fes fleurs des longues filiques, telles
que .:elles
du
fa::nu-grec,
&
qui contiennent des fc–
Rlences pareilles. Veslingius a remarqué que le nom–
bre des cellulcs de chaque f¡liqu e varie felon le nom–
bre des graines'
&
que le tronc de l'arbriffeau en
armé d'épines rares
&courres .
( D .
J.
l
SESeHAN , (
G;
o.ff.mod. )
andennement
B~tge,
Bycot
&
Byce ;
g rand lac de
la perite Tarrane en
Europe.
[1
fépare la Tartarie des Nogais, de la eri–
mée,
&
fe décharge dans la mor de Zabache par un
canal fort courr, n'étant féparé du golphe deNigro–
poly que pu un iilhme de demi-lieue, fu¡· lequel la
ville dt! Prt!cop en fituée. (
D.
J. )
SESELI, f. m. (
Hift.
nat. Bqt1111. )
genre de plante
dont voici les caraéteres, fuivant Linnreus . Le calice
qui enveloppe la fleur. en a peine: remarquable ¡ la
couronne de la fleur en généralement uniforme; la
flfur en
a
cinq pétales 3-peu-pres égaux.
&
raillés
en forme de cceur ¡ les étamines fon& cinq .filets qui
finiffent en pointes aigues; (·es boffettes des étamines
font fimples; le germe du pinil en
pla.~é
fous l'en–
veloppe de la fleur ; les ftiles
!ont recourbés;
les
frigma fonc obcus; le fruit
efi
ovale, petit,
c~nnelé,
&
(éparable en deux portions . Les graines font au
nombre de deux, de forme ovo·¡de, convexe d'un
c8té,
&
applaties de l'autre.
ll
paroit de cette def–
cdpcion que Tournefort s·en trompé en rapporrant
les diverfes efpece5
defiflli
au genre de plante qu'on
nomme
fm•uil .
( D .
J .
)
St:SI!:La COMMUN,
(Botan. )
e•
en un des noms qu'
o~
donne vulgairemeot a la livlche. en latin
ligll–
ftrcum . Voytz
LtvftCH!,
Botan.
( D .
J.)
St:SELJ
D&
eANDit:, (
Bot4n. )
nom vulgaire d'uRe
~es
efpeces du genre de plante, que Tournefod
T•mtXll.
S E S
107
appelle
torrlylimn . Voytz
ToRDYLIUM ,
Bota11iqut.
( D . .
J.)
.
SESELI DE MAI\SI!:tLU: ,
/
Bota11.
)
plante nom–
mée par Tourn.efort,
{amimltllll
tortuoji1m,
&
par
!es autres
llou~lfie~,
fijeli maflllienfi;
fa rige s'éleve
a la haureur d envJron un pa!
&
demi
&
en rem–
plie de moelle bllnche. Elle porte en 'res fomm ités
rles ombelles, qui foutiennenr de petites fleurs\a cinq
pétales , difpofées en rofe, de couleur blanche
&
quelqoefois purpurine. Apres la chute de
(~
fle'ur
(on
Cll iee deviene un fru ir compofé de deux <>rai:
nes oblongues. nriées' arrondies d'une pare.
~-"
ap–
plaries de l'autre¡ elles fon t d'nn gris pale, d'une
ocleur aromarique,
&
d'un gour forc acre. Toure la
pla11te a une odeor forre
&
agréable. Elle croit aux
lieux f.1blonneux dans les pays chauds, comme en
Lan~ll~doc,
en Provence,
&
aux environs de Mar–
fed
l~. (D.
J . )
ESF.LIDI!
MARS~ILLI!,
(
Mat. mM.)
la remence
en
1~ lcule part1e de cette planre qui loit d' ufa"e en
méúecine . Elle en comptée parmi les femenees" car–
minatives . ·Elle en forr analogue avec celles des
a
u–
tres plantes ombell iferes ufuelles, telles que le fe–
nouil , l'anis,
le cumin,
&(.
Aulli en-ce: prefque
toujours avec ces dernieres femences qu'on l'em–
ploie,
&
tres-ra rement feule. Son ufage eil forc rare
pour les prefcriptions maginrales. On l'emploie da–
vanrage dans les compofirions otficinales: elle enrre,
par exemple, dans la théri3que, le· mithridar
l'eau
générale,
&
la poudre
dt calibt
de la pharmacopée de
Paris.
(b)
.
SESIA (LA) ,
ou
LA SESSIA,
( Géogr.
1110tl. )
ri–
viere d'ltalie, dans le M ilanez. Elle prend fa !ource
dans les
Alp~s,
aux confins du Valais,
traverfe la
vallée de fon nom,
&
fe décharge dans le PO, au–
dd(ous de e:ti:JI .
( D.
J.
J
SESQUl, en une parricule fouvent employée par
les anc1ens mt1ficiens, dans la compofirion des mots
(ervam
a
CX¡lrimer ditférentes efpeces de mefures.
lis appelloient done
fiJi¡ui-alteru,
les mefores,
.done la principale nore valoit une moitié en fus
de
plus que f.t valeur narurelle; c'en-a-dire , crois des
notes done elle o'auroic valu aurrement que deux ; ce
qui avoit lieu dans toutes les mefures triples , foir le&
majeures, ou la breve
m~
me fans point valoit trois
femi-brc:ves: loir les mineures, ou la femi-breve va–
loit trois minimes.
lis appelloienc encare
flfqui·oélav~,
le triple
mar-
qué par ce fig11e e
t.
Double
fijqui-quart~
•
le triple marqué e
..!.. .
&
•
ainfi des
a
utres.
Sifquí·dito11
ou
htmi-dit611
dans la mufique grec–
que , elll'intervalle d'une ticrce-maj eure diminuée d'un
femi-ron , c'eil-a-dire, une tierce-mineure .
Voytz
TI ERCE.
(S)
SESQUl-ALT ERE ,
m
Géométrie,
&
m
Arithmé–
tiqut,
c'c¡l un rapporr enrre úcux lig nes, dcux
nom~
bre• ,
&c.
d:u¡s leq uel une de ces (!rantleurs cnncient
l'autre une fois
&
une demi-fois.
i'oyez
RAISOM.
Ainfi les nombres
9
&
6,
font entre eux en raifou
.fe.(qui·nlten;
car.
9
contiene
6
une fois
&
une demi–
fois : tels font aulli les nombres
Jo~
2.0.
(E)
SESQUl-DOUllLE, adj.
(Géotn. M11thhn.¡
on dit
qu'one rai!on
enfifqui-doubléc,
quand le plus grand
de fes deux termes contiene le plus petit deux fois
&
une demi-fois; telle en la
raifon de
1$
a
6.
de
50
a
20.
&c.
Vovtz
RAISON .
(E)
SESQUI-QUADRAT, ad¡ . (
Aftron.!
3fpeét
fijqui–
qut~rlrat.
en un afpeét ou pofition des planetes. ou
elles font éloignées l' one de l'autre de
+
fignes
&
de–
mi, ou
q;
degrés , c•en-a-dire,
9a
+
+$·
f/oyt~
ASPECT .
(E)
SESQUI- TIERCE,
(
Géomhric .
J
on dit qu'une
quantité en en raifon
fifqui-titru
d'une
autr~
quan–
tité, quand la premierc contiene la deutieme une fois
&
un tiers de fois ¡ eelle en la raifon
de
8
ii
6,
ou de
+
i13 ( E l
SESSA
ou
SEZZA, (
Géog.
motl. )
bourgade d'lra–
lie, au royaume de Napies,
dan~
la rerre ile Labour,
a
cinq mil les de earinoht,
&
l
vingt-deut de eapoue,
pres ilu Gariglan , avcc titre de duché,
&
un éveché
fu!fraaant de eapoue. Si ceue bourgad e en l'ancien–
ne
Su~jfo-ArNIICII,
elle
a
bien perdu de fon Iunre,
&
l'on ñe peut plus dire d'elle ce qu'en dil it eicéroo,
/autijjimum opf!irlum,
car c•en un lieu
mi!~r1ble,
fnal–
gré tous fes m res.
L•nz.
31,
3)·
14tit.
58,
Jo.
O
z.
Cor-
















