
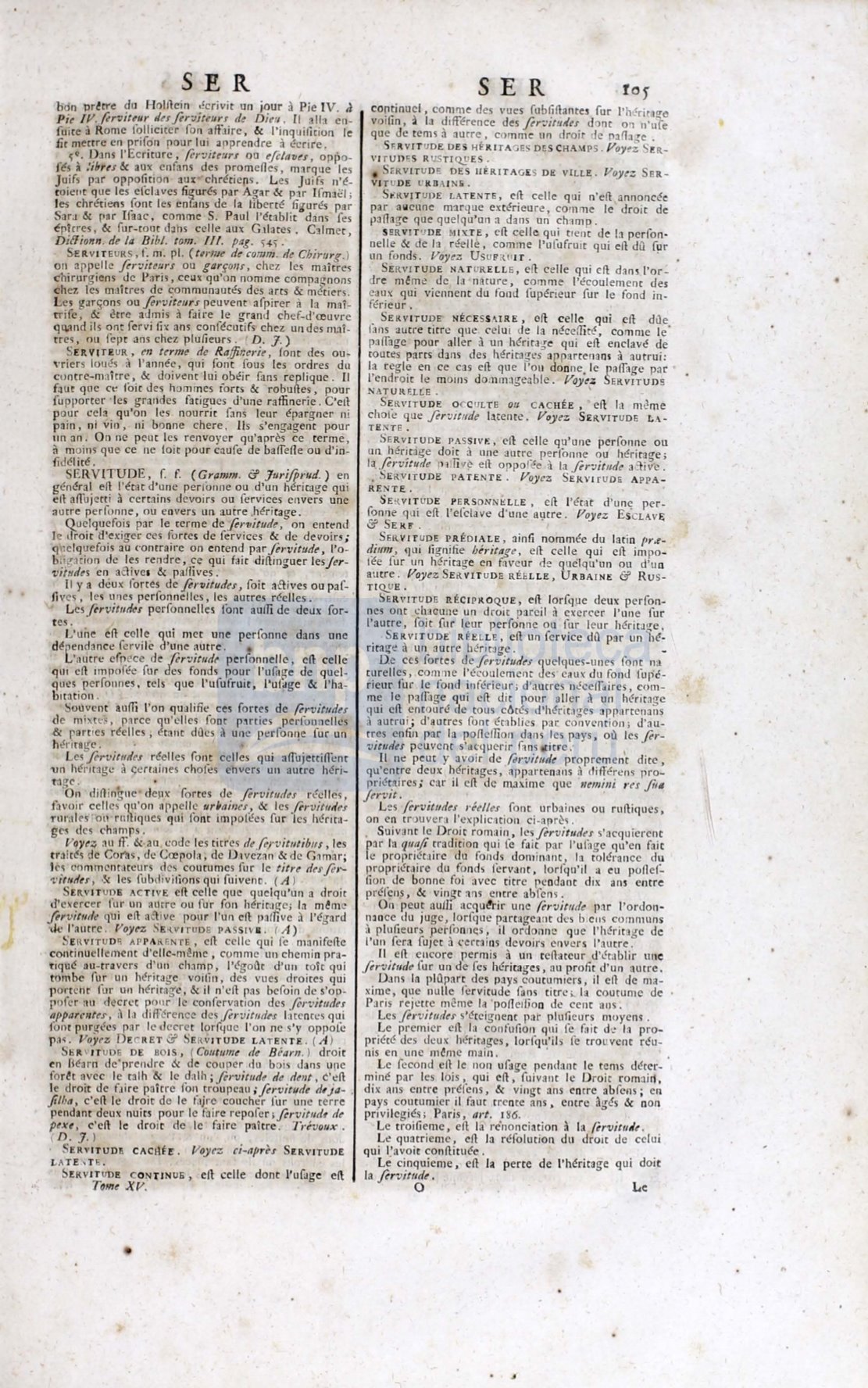
S
E R
bon prtrre du f-lolllcin Jcrivit un jour
i\
Pie IV.
J
Pie
/ P.
{erviteur tlu flr:úreun de Dieu ,
ll
alla en–
fuíce
:l
Rome l'ollicicer fon afFaire,
&
l'inquifi tion le
fic menre en ¡>rifon pour lui a¡>prendre
a
écnre.
)•. Dans
1'
Ecriture ,
(ervítet1rr
o
u
eftlatJtt ,
oppo–
f€s
¡,
:ibru
&
aux enfans des promefles, marque les
J uifs par
oppo~non
aux chrécieps . Les Ju ifs
n'é–
roi~JOr
que les elciJves fu!urés par Agar
&
p1r lfmael;
les chrériens fonr les entans de la liberté figurés par
ara
&
pnr Ifaac, commc S. Paul l'écabl ic
dan~
fes
~pi
eres,
&
fur-couc dahs celle aux
G
tbces . C1lmec,
Diflíonn. de la Bibl. tom.
111.
pag.
SH .
St:RVITEUR
'e
m. pi.
(
t•rllle de
COTlJ/11.
de Chirurg.)
011
appellc
flrvitcurs
ou
garfOI/f,
chez
les maltres
chirurgiens de París, ceux qu'on nomrne compa!!nons
che1: les
maltre~
de communaucés des :¡res
&
m.!'tiers.
Les garc;ons ou
fi,"Viteun
peuvenr afpirer
a
la rnal–
rrife ,
&
erre aJmis
i\
faire le grand chef-d'reuvre
q11.1nd ils onr fervi fix ans confécucifs chez un des
mnl–
rrcs, nu
lepe
ans chez plufieurs .
1
D. ] .
)
SEP.
VITI!UR,
e11
terme de R.ajjincrie ,
Ione des ou–
\•riers lom!s
a
l'année' qui fonc fous les ordres du
cunrre-malrre,
&
doivenr lui obéir fans replique.
Il
faur que e" loic J es hommes forcs
&
rebulles, pour
fu pporcor les grandes fatigues d'une raffinerie . C'etl
pour cela qu'on les nourrir fans
leur épargner ni
pain, ni vio, ni bonne chere ,
lis
s'engagenc pour
un an. On ne peuc les renvoyer qu'apres ce cerrne ,
a
mom
que
ce ne ta1t pour caufe
de
balfefl e ou d'in–
fid~l icé .
ERVITUDE,
f. f.
(Gr11mm.
&'
] uri}prud. ) en
général el! l'éttlt d'une pertonne ou d'u n hérirage qui
dl
all11jetti
a
cercains devoirs ou fervices envers une
auere perfonne, ou eovers un aucre .hérirage.
Quelqucfois par le ccrme de
flrvitude,
on
enc~nd
le
droir tl'exiget ces fo rres de fervices
&
de devoir! ;
q
clquefois ao c·onrraire on encend par
f t rvitude ,
l'o–
bi g:uion
Je
les rendre, ce qui
l:~ic
dillinguer
lesjer–
vitHdes
en a ivea
&
paffives .
11
y
a
déux forres de
for'IJÍtudes,
foit
afrives
ou paf-
fi vcl,
l e~
unes perfonnellcs, les aucres
r~elles .
·
Les
.firvituder
perfonnelles !onc auffi de deux for–
res .
L'une el! celle qui mer une per[onne dans une
dépendance l<!rvile d'une aurre .
•
L'aucre ef¡>ece de
fCr:;itudf
perfon nelle , efl: celle
qm el! 1rnpofée fur des fonds pou1· l'u(,¡ge de quel–
ques _perfounes, rels que l'ufufruir,
l'ut~ge
&
l'ha–
bJcatlon .
'ouvent
au(fi
l'on qualille ces forres de
f-rvituder
de
mi: tt~,
paree qu'elles fonc
p~rcies
perlo
o
elles
&
parc1es réelles, éranr dQes
il
une perfon11e fur un
h~l'iragc .
·
Les
flrvitudu
réelles fom celles qui alfujercifl'enc
'Un hé'l'ltagc
a
certaines chales envers un aucre héri-
t<l'í)~
dillingne de¡1x
forres de
flrvittufu
réelles,
favon· celles qu'on appell e
url~ait:es,
&
les
.f-rvitlll{es
rum ies ·on rurliques ql1i fonc impolees fur les hérJra–
ges des champs.
Vq¡m;
au
tf.
&-au code les rirres
defiruitntib!ls,
les
traí tés de Cor'as, de Ccepola, de
D
¡vezan
&
de Gamar;
le~
commcncareurs
des
coucumes fur le
titre duo
fl:~
1nlrufn ,
,:~¡
les fubd ivitions qui fuivenu .
(A )
SEIWITUDE ACTIVE efl: celle c¡ue quelqu'un a droic
d'excrcer fu1· un aucre ou fur fon hérit>:1ge; la
m~m
firvitllde
qu i efl: a ive pour l'un efl: paltive
~ l'~gard
de
l'nucrc .
f/oyn
.'Eli.VITUDE PA S!va .
1
A)
St:RVITUD"- APPA RF. T6, efl: cell e qoi
(e
manifefle
conrinuell
mene
d'elle-m~me,
comme un chemin pra–
tiqué nu-cravcrs d' un champ, l'égollc d' un rolr qui
tombe fur un hérirage voifin, des vu es droices qui
porcellt for un héricag'c,
&
il n'ell pas hefoin de s'op–
pofer au
decrec
pnur le confervarion des
.forvitudu
apparentu,
i\
IJ
di tférence de
fir vit11de-s
J:¡ccnrcs qui
Jo~>c
purgécs par le dccrer lorfque l'on ne s'y oppo[e
pa<.
Voyfz
DECRET &
'ERVITUDE LATENTE .
( A )
S6!l
viT uo F.
DE
BOl
S,
(
Coutmn~
de
Bí:am.)
droir
en Oéarn de'prendre & de couper du
bois
dans o¡1e
for~t
avec
le ralh
&
le dalh ;
flrvitttde de dent ,
c'<!ll
le droir de fJi re pairre fon rroupeau
;flrvitude dtja- .
ji
Iba,
c'ellle droir de le t<¡jre coucher fur une rerre
pendant deux nuics pour le füire repofer;
flr vitudt
d~
pexe,
c'cll le droir de le fai re pa1cre .
Trévoux
.
¡ D .
J. )
ERv JTUDE CACllb: .
Voycz
ri-npres
Sr;RvJTuDE
LATE '
T~ .
I!:RVITU'DE CONTJNU&, eft celle donr l'ufage ell:
TDme XV.
S
E R
ro;
conrinuel, comrne des vues fubfiftante! fur l'héritJ"C
voilin ,
~
la d11férence des
flr"JÍtutlu
dnnr on n·u'fe
que de cems
a
aurre, comme un droir de nafl3"e .
SF.RVIT UDE
o
es
HÉRITAGES DESCHA\IPS .
Voyn
I!:R.–
VJTUDF.S R
USTIQ.!
E .
e
ERVLTUDE DE
llER ITAGi:S DI! VlLLI! .
Voytz
ER–
VIT UDE
II.DAIN&.
Y.KVI TUDE LATE TE, cfl: celle qui n'ell
annonc~e
par
aY
cune
m~rque
excérieure, com 1e le droir de
r arlage que quelqu'un
a
dans un ch1mp.
SERVIT'JOJ! MI
'C.
TE, efl celle qui tiCnt de
ll
perfon·
nelle
&
de la réelle , camme l'ufufr01r qui efl: dQ fu r
un fonds.
Voyez
UsuF;w JT .
·
ERVITUDE HA TURE LLE, efl celle qui cfl dans J'or–
dre me!me de la nacure , comme l'écoul emenc des
canx qui vienncnc do fond {upérieur fur le fond in–
férieur.
EKV ITUDE
HÉCESS ~IRE,
Ofl:
ceiJe qui cfl
dQe
li111
a
u
ere riere que c-elu1 de la nécefficé , comme le·
pafl'age pour aller
a
un héritaJe qui ell enclavé de
coures pares dans des
hérirng~s
appartenaos
a
autrui :
la regle en ce cas el! que l'on donne. le pa!fagc par
l'endroir le moms do 1mageable .
Voye;-
SER.VITUDS
NATUR F.LLE.
E!WITUDE OC'CrJLTE
011
CACHÉ!!,
efl:
la meme
chote que
flrvltllde
latente.
Voyez
S<:ltv!TUDE LA.
TRi"TF.
.
SsR.v!TUDE
PASSJv~: ,
efl: celle qu'une perfonne ou
un hém age doir
a
nne aurre perlonne ou hérirage;
la
.fei'VÍtude
[l
1
Ti
V~
eJl
O
pof' e
a
la
flr :JÍtlldt
3
:ti
VC .
. SERVITODE PATENTE .
Voycz
SEX.YJtUDti APPA–
RE TE.
SERVITUDE
YE RSONN~LLE,
efl:
l'écat d'u ne per–
fonne q i ell l'elc lave d'une nmre .
Voy tz
Es'cLAVF;
&
SEI<.I!'
.
.
SE! VITUDE PR.ÉDIA LE, ainfi nommée du lacin
{Jr.e–
d_ÍIIfll ,
qni lign!fie
béritagc ,
ell cell e qui efl:
impo–
l~c
[ur un hémage en faveur de quelqu'nn ou d'u n
aucre.Voytz
ERVITUDE RÉhLLE, U!tBA lHE
&
Rus–
TIQ.YE. SERVITUDE RÉCIPR OQUE, efl: lorfque deux perfon–
OCS 01\t ..:haCUilC
Un drOIC pareil :\ exercer J'one fur
l'aurre, foit [ur leur perfonne ou fur leur hérirage ,
f! RVITUDE RÉELLE, efl: Un fcrvice dQ par
Ull
l1é·
rirage
ií
ttn aocre bérot:Jge.
-
D.e ces forres de
firvitudu
quelques-unes fon c na
curelles, comme l'écoulcmenr des eaux du fond t'upé–
rieur t'ur le fond in férieur ; d'aucres
111~cefl~ ires,
eom–
me le pafl:1ge qu i efl: die pour all er
a
un hérirage
qui cll enrouré de cous cótés d'héricages appnrcenans
ii
aurru i; d'aurres fo nr éro l>lies pat convcnrion; d'a u–
cres enfin par
In
pofleffion dans les pays , oil. les
fir-
vimdu
pcuvertt s'acquerir f1 ns
o~:icre .
,
ll
ne peuc
y
avoir de
/drvit11de
proprement di re,
qu'entra deux ht5ritagt!s, ·apparrenans
ii
ditfért!ns pro–
priéraires; car
il
efl: de m,axime que
11emini res
Jit•
jervit.
Les
.firvitudu réelles
fonc urbaines ou rufl:iques,
on en rrouvera l'ex¡>licacion ci-al'rel .
. Suivanr le Droir roma in , les
flrvitruler
s'acqu ie1·enr
par
1\l
q11aji
rradicion qui
Ce
fa ir par l'ulage qu'en fait
le propriétaire du fonds dominanc , la rolérance du
propriéraire du fonds lervant, lorlqu'il ;¡ eu pofl ef–
fion de bonne foi avec tirre pendanr dix an! entre
pré(ens,
&
vingr
~ns
en
ere abien> .
On peur aulli acqut!rir une
(ervÍt11tfe
par l'ordon·
nance du juge, lorfque parcageanr des b.ens communs
it
plnfieurs períonnes, il ordonne que l' héricage de
l'on [era fu¡et
a
('Crta ins devoirs envers l'aurre .
11
el! encere permis
a
un rellaceur d'établir une
flr"JÍtride
Cur un de
[es
hérirages,
a
u profit d'un
a
ocre.
u~ns
la piO.parr. des pays courum icrs, il el! de ma–
xirue , que nulle {ervirude fans riere ;.. la courume de
París rejerre meme la ·poflelfion de cene ans.
Les
fl•·vitudes-
s'éceig nenc par plufieurs moyens .
Le premier
eft
la con fufion qui fe f.1ir
d~
la pro–
priété des deux hérirages, lorfqu'ils fe rrouvenr réu-
nis
en une
m~me
main .
·
Le fecond eft le non ufage penc!anc le rcms détcr–
miné par les lois , qoi el!, fui vanr le Droic romaiJ1,
dix ans corre prét'ens,
&
vingr
ans
enere abfens ; en
pays coucumier
il
faur trence ans' entre agés
&
non
privilegi€s ; París,
art. 186.
Le croifieme,
eQ
la re'nonciarion
a
la
(ervitrule .
Le quatrieme ,
efi
la réfolucion dn dro1c de celui
qui
l~avoir
confiicuée .
Le
cinquieme, el! la perte de l'héricage qui doit
la
flrvitudt.
O
Le
















