
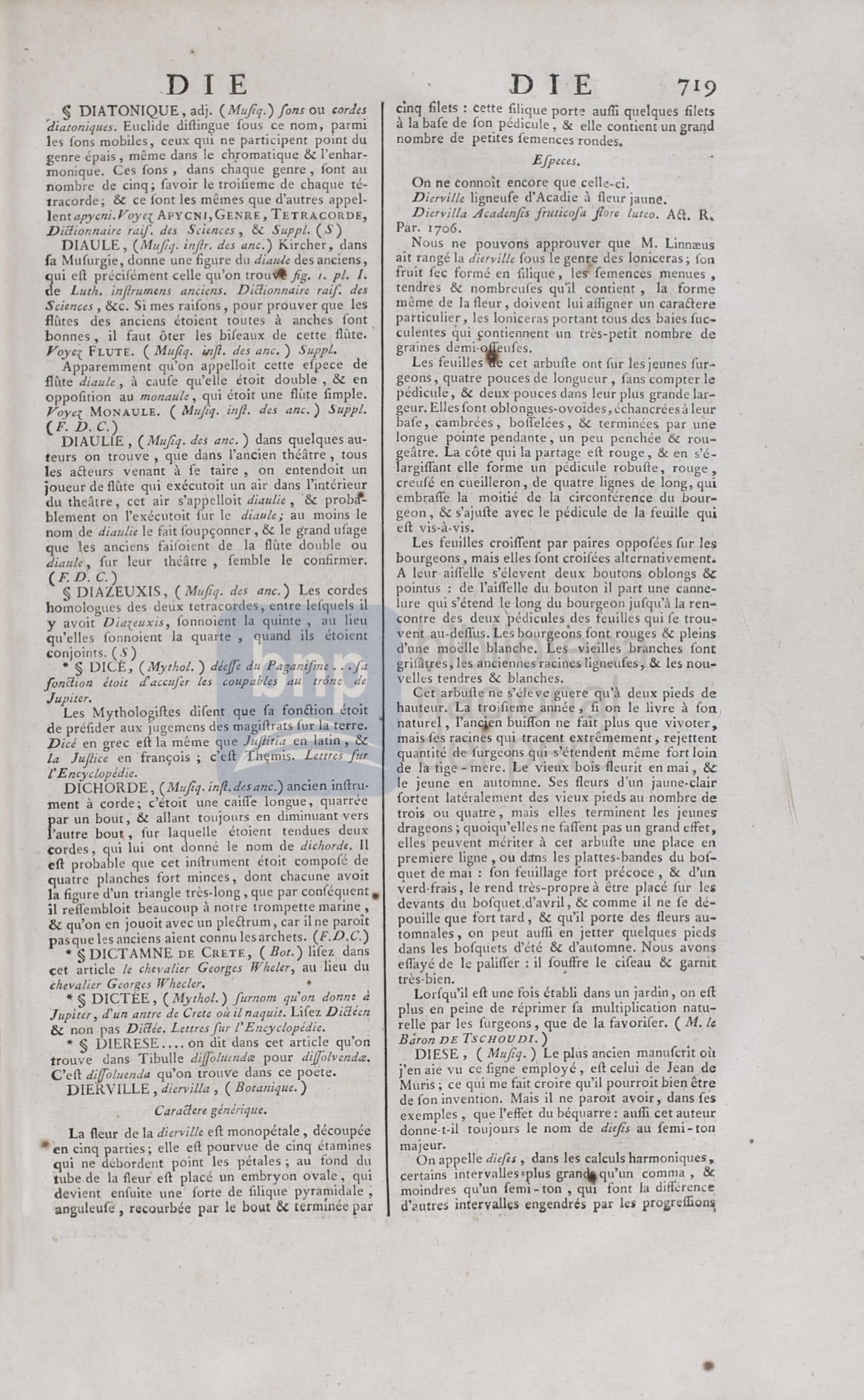
§
DIATONIQUE, adj. (
Mujiq.) fons
ou
cordes
diatoniques.
Euclide difiingue fous ce norn, parmi
les fons mobiles, ceux quí ne participent point du
genre épais' meme daos le chromatique
&
l'enhar–
rnonique. Ces fons , daos chaque gente, font au
nombre de cinq; favoir le troifieme de ebaque té–
tracorde;
&
ce font les memes que d'autres appel–
lent
apycni. Voye{
APYCNI, GENRE, TETRACORDE,
Diai.onnaire raif. des Sciences,
&
Suppl. (S)
DIAULE,
(Mujiq. inftr. des anc.)
Kircher, dans
fa Mufurgie, donne une figure du
diazde
des anciens,
qui eíl: précífément celle qu'
on troufig.
1.
pl.
l.
de
Luth. injlrumens anci.ens. Di.aionnai.re raif. des
Sci.ences,
&c. Si mes raifons, pour prouver que les
flfltes des anciens étoient toutes
a
anches font
bonnes '
il
faut oter les bifeaux de cette flute . .
Yoyez
FLUTE. (
Mujiq.
i.nfl.
des anc.) Suppl.
Apparernment qu'on appelloit cette efpece de
flfne
di.aule
'
a
caufe qu'elle étoit donble '
&
en
oppoíition au
monaule,
qui étoit une fll!te fimple.
Yoyez
MoNAULE. (
Mujiq. i.nft. des anc,) Suppl.
(F. D. C.)
DIAULIE,
(Mujiq. des anc.)
dans quelques au–
teurs on trou ve ,
q~te
dans l'ancien théatre , tous
les aéteurs venant
a
fe
tait:e ' on entendoit un
joueur de flute qui exécutoit un air dans l'intérieur
dLl
theatre, cet air s'appelloit
diaulie,
'&
prob -
blement on l'exécutoit fur le
diaule;
a u moins le
n0m de
diaul_ie
le fait
foup~onner,
&
le grand ufage
que
es anciens fai(oient de
la flute double ou
diaule,
fur leur
théatre ,
femble
le confirmer.
(F.
D~
C.)
§
DIAZEUXIS,
e
Mujiq. des anc.)
Les cordes
homologues
d~s
deux tetracordes, entre lefquels
il
y
avoit
Dia'{_euxis,
fonnoient la qt¡inte , a
u
lieu
qu'elles fonnoient la quarte , quand ils étoient
conjoints. (
)
*
§
DICÉ,
elvfythol.) déej{e du Paganifme .•• fa
fonélion étoit
d'
accufer les coupables au
trone
de
Jupiter
.Les
Mythologifi.esdifent que fa fonétion
étoit
de préfider aux jugemens des magifirats fur la terre.
Dicé
en grec efi la meme que
Juflitia
en latín,
&
la luftice
en
fran~ois
; c'eft
Th~mis.
Leures fur
l'Encyclopédie.
DICHORDE,
eMujiq. i.nfl.desanc.)
ancien iníhu–
ment
a
corde; c'étoit une caiífe longue' quarrée
par un bout,
&
allant toujonrs en diminuant vers
l'autte bou , fur laquelle étoient tendues deux
cordes, qui lui ont donné le nom de
dichorde.
Il
efi
probable que cet infirumenr étoit compofé de
quatre planches fort minces, dont chacune avoit
la
figure d'un triangle tres-long, que par conféguent
il reífetnbloit beaucoup
a
notre trompette marine ,
&
qu'on en jouoit avee un pleétrum, car
il
ne paroit
pasque les anciens aient connulesarchets.
eF.D.C.)
*
§
DICTAMNE DE CRETE, (
Bot.)
lifez daos
cet
article
le clzevalier Georges Wheler,
au
1ieu du
chevalier Georges Whecler.
*
§
DICTÉE, (
Mythol.) Jumom qu'on donm
a
Jupiur, d'un antre deCrete ouilnaquit.
Lifez
Diélien
&
non pas
D iélée. Leures
Jur
L'Encyclopédie.
*
§
DIERESE .... on dit daos cet article qu'on
trouve daos Tibulle
dif{olumdre
pour
dij{oLvenda.
C'eíl:
di.f!oluenda
qu'on trouve 'daos ce poete.
DIERYILLE,
diervilla,
(
Botanique.)
Caraaere générique.
La fleur de la
dierville
eíl: monopétale , découpée
en cinq parties; elle eíl: pourvue de cinq étamines
qui ne débordent point les pétales ; au fond du
tube de· la fleur eíl: placé un embryon ovale, qui
devient enfuite une forte de filique pyramidale ;
"'Clnguleufe ' recourbée par le
bo\,lt
&
termínée rar
D I E
719
cinq fitets : cette
~~~que
port'.! aulli quelques filets
a
la bafe de fon. pedJcule'
&
elle conrient un grand
nombre de pet1tes femences rondes.
·
Efpeces.
On ne
conno~t
encore que celle-ci.
Dierville
ligneufe d'Acadie a fleur jaune.
D iervi.Lla Acadenjis fnuicofa flore luteo.
Aél. R,
Par.
1706.
. Nous
ne
pouvons approuver que
M.
Linnreus
ait .rangé la
die~ville
fous le genre des Ioniceras; fon
frutt fec forme en filique , les femences menues
,
tendres
&
nombreufes qu'il contient ,
la forme
me~e
d.e la fleur' ?oivent
luí
affigner un caraétere
parocuher '.l es lomee ras portant tous des baíes fuc–
culentes qm fOntiennent un tres-petit nombre de
graines demi-o eufes.
Les feuilles
cet arbuíl:e ont fur les jeunes fur-
g~o~s,
quatre pouces de longueur, fans compter le
ped1cule,
&
deux pouces dans leur plus grande lar...
geur. Elles font oblongues-ovoides
1
échancrées
a
leur
bafe, cambrées, hoífelées,
&
terminées par une
longue pointe pendante, un peu penchée
&
rou–
gearre. La cote quila partage efi: rouge,
&
en s'é.
largia:-anr elle. forme un
p édicul~
robufie, rouge,
creufe en cue1lleron, de quatre hgnes de long
qui
embraífe la moitié de la circonférence
du
b~ur
geon, & s'ajníl:e avec le pédicule de la feuille qui
efi vis-a-vis.
Les feuilles croiíTent par paires oppofées fur les
hourgeons, mais elles font croifées alternativement.
A
!eur aiífelle,
~'élevent
deux boutons oblongs
&
pomtus : de
1
a1ífelle du houton il part une canne–
lure qui s'étend le long du bourgeon jufqu'a la ren–
contre des deux pédicules .des feuilles qui fe trou–
vent au-deífus. Les bourgeons font rouges & pleins
d'nne moelle blanche. Les vieilles branches font
grifatres, les anciennes racines ligne-ufes, & les nott•
velles tendres
&
blanches.
Cet arbuíl:e ne s'éleve guere qu'a deux pieds de
hauteur. La troiíieme année, íi on le livre
a
fon
naturel, l'anc· en buiífon ne fait plus que vivoter
J
mais fes racines qui tracent extremement,
rejetten~
quantité de furgeons qui s'étendent meme fort loin
de .la tige- mere. Le vieux bois fl eurit en mai,
&
le Jeune en automne. Ses fleurs d'un jaune-clair
fortent latéralement. des vieux pieds au nombre de
trois
ou
qnatre, mais elles terminent
les
jeunes
drageons, quoiqu'elles ne faífent pas un grand effet
elles peuvent mériter
a
cer arbufie une place
e~
premiere ligne, ou daos les plattes-bandes du bof–
quet de mai : fon feuillage fort précoce,
&
d'un
verd-frais' le rend tres-propre
a
erre placé fur le¡;
devants du bofquet .d'avril,
&
comme il ne fe dé..
pouille que fort tard, & qu'il porte des fleurs au–
tomnales , on peut auffi en jerter quelques pieds
daos les bofquets d'été
&
d'automne. Nous avons
eífayé de le paliíTer : il fouffre le cifeau
&
garnit
tres-bien.
•
Lorfqu'il efi une fois établi dans un jardin, on eíl
plus en peine de réprimer fa multiplication natu–
relle par les furgeons, que de la favorifer.
(M.¡,
Báron
DE TSCHOUDI.)
DIESE,
e
Mujiq.)
Le
pli.lsancien manufcrit
o1t
j'en aie vu ce figne employé' efi celui de Jean de
Muris; ce qui me fait croire qu'il pourroit bien
~tre
de fon inventíon. M'ais il ne paroit avoir, dans fes
exemples, que l'effet du béquarre: anffi cet auteur
donne·t-il toujours le nom de
ditjis
au femi- ton
majeur.
·
On appelle
diefes,
dans les calculs harmoniques
~
certains ínter valles ,.plus gran
qu'un comma ,
&
moindres qu'un femi- ton , qm font la différence
d'¡>.utres
interval~es
engendrés
par
lci
progreffion~
















