
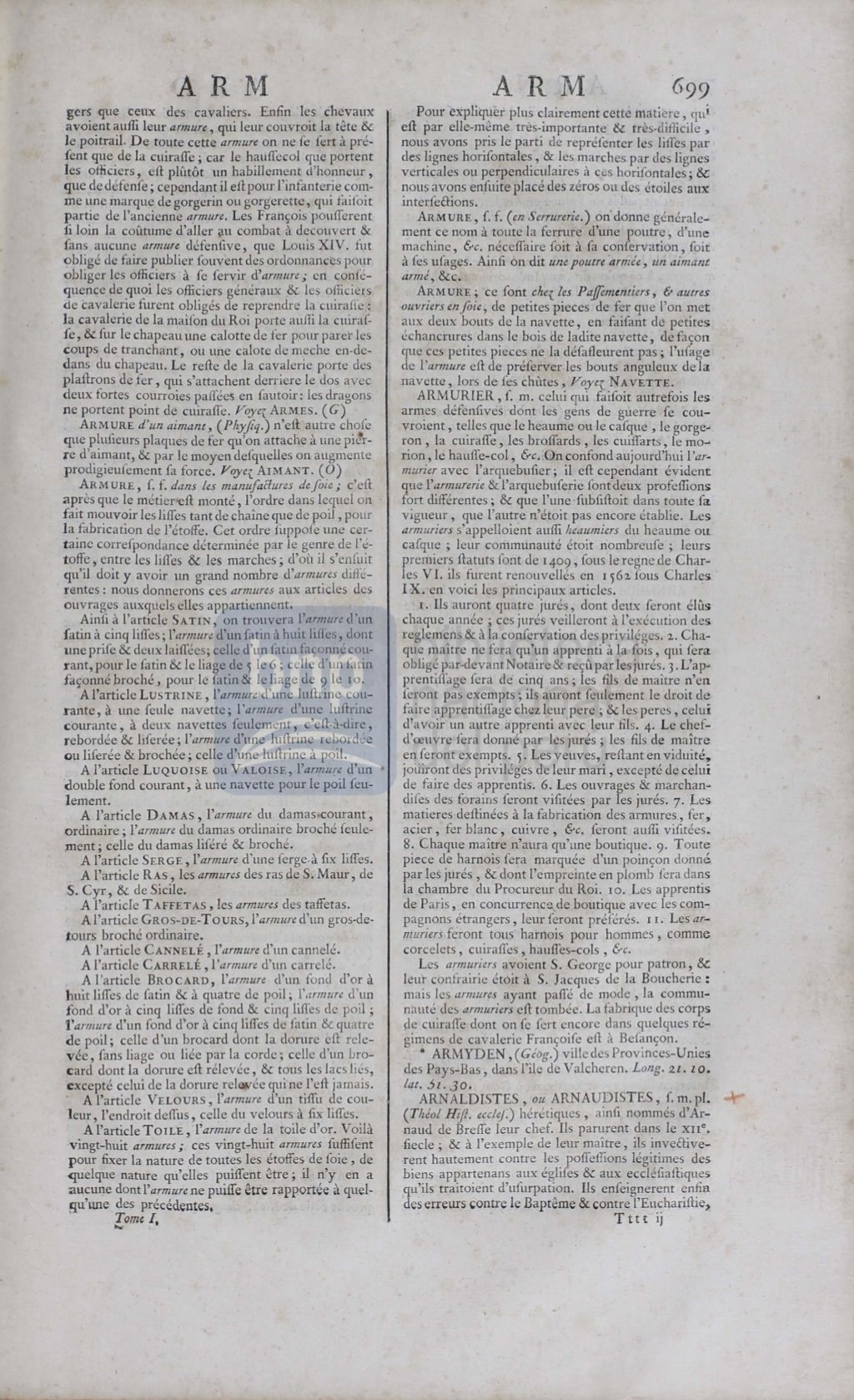
ARM
gcrs que ceux des cavaliers. Enfin les chev3ux
avoient aufIi leur
armure,
qui leur couvroit la tete
&
le poitrail. De toure cette
amlltre
on ne {e (ert
a
pré–
fent que de la cuiraífe; car le hauífccol que porrent
les officiers, ea pllltot un habillement d'honneur ,
que de défen(e; cependant il eapour I'infanterie com–
me une marque de gorgerin on gorgerettc, 'lui fai(oit
partie de l'ancienne
armure.
Les Frans:ois poufferent
ii
loin la COlltume d'aller au combat a decouvert
&
fans aUCllne
arnlUre
défenfive, que Louis XIV.
fut
obligé de faire publier fouvent des ordonnances pour
obliger les officiers a fe fervir d'
armure;
en con(é–
quence de quoi les officiers généraux
&
les officiers
de cavalerie furent obligés de reprendre la clúraiIe :
la cavalerie de la maiCon du Roi porte auffi la cuiraf–
fe,
&
Cur le chapeau une calotte de fer pour parer les
coups de tranchant, ou une calote de meche en-de–
dans du chapeau. Le
reae
de la cavalerie porte des
plafuons de fer , qui s'attachent derriere le dos avec
deux fortes courroies paírées en fautoir: les dragons
ne portent point de cuiraífe.
YOYe'{
ARMES.
(G)
ARMURE
d'un aimant,
(P/ryfiq.)
n'eft aun'e choCe
que plufieurs plaques de fer qu'on attache a une pilr–
re d'aimant,
&
par le moyen deCquelles on augmente
prodigieufement fa force.
Yoye{
AIMANT.
(O)
ARMURE, f. f.
dans les manufaélures deJoie; c'ea
apres que le métier-eft monté, l'ordre dans lequel on
fait mouvoir les liíres tantde chalneque de poil, pour
la fabrication de l'étoffe. Cet ordre lilppofe une cer–
taine correfpondance déterminée par le genre de
l'<f–
toffe, entre les li{les
&
les marches; d'oh il s'enCuit
qu'il doit y avoir un grand nomhre
d'ammres
diffé–
rantes: nous donnerons ces
arnzures
aux artides des
ouvrages auxquels elles appartiennent.
Ainfi a I'artide SATIN, on trouvera
l'arnzure
d'un
fatin
it
cinq I¡¡res;
l'amuere
d'un {atin a huit lilles, dont
une prife
&
deux laiffées; celle d'un Catm fas:onné cou–
rant, pour le {atin
&
le liage de 5 le 6; celle d'un {atin
fas:onné broché, pour le fatin
&
le liage de 9 le 10.
Al'artiele LUSTRINE,
l'armure
d'une luarine cou–
rante, a une {eule navette;
l'arllIure
d'une luftrine
courante, a deux navettes feulement, c'eft-a·dire,
rebordée
&
h{erée; l'
armure
d'une luftrine
rebord~e
ou!i{erée
&
brochée; celle d'une luarine
a
poil.
A I'artide LUQUOISE ou VALorSE,
l'armltT¿
d'un
Qouble fond courant,
a
une navette pour le poil feu–
lement.
A l'article DAMAs,
l'armure
du damas.courant,
ordinaire; l'
armure
du damas ordinaire broché {eule–
ment; celle du damas liféré
&
broché.
A I'article SERGE,
l'armure
d\lI1e (erge.a íix liífes.
A I'al'ticle RAs, les
armures
des ras de S. Maur, de
S. Cyr,
&
de Sicile.
A I'artiele T AFFETAS, les
armures
des tafferas.
Al'artide GROS-DE-ToURS, l'
armure
d'un gros-de-
tours broché ordinaire.
A l'article CANNELÉ,
l'armure
d'un cannelé.
A I'article CARRELÉ ,
1
'armure
d'un carrelé.
A l'article BROCARD,
l'armure
d'un fond d'or a
huit li{[es de fatin
&
a
quatre de poil;
l'ammre
d'un
fond d'or a cinq li{[es de fond
&
cinq liíl'es de poil ;
l'armure
d'un fond d'or a cinq liKes de {atin
&
quatre
de poil; celle d'un brocard dont la dorure eft rcle–
vée, Cans liage ou liée par la corde; celle d'tm bro–
card dont la dorure
e1l
rélevée,
&
t011S les lacs liés,
excepté celui de la dorure releowée qui ne I'eft jamais.
A l'artiele VELOURS,
l'armure
d'un ti{[u de cou–
Ieur, l'endroit deífus, celle du velours a fIX liífes.
A ['artieleTOILE
,Tarmure
de la toile d'or. Voila
Vingt-hlút
armures;
ces vingt-huit
armures
(uflifent
pour fi.-"er la nature de toutes les étoffes de ioie, de
<fUelque nature qu'elles puiífent
~tre;
il n'y en a
aucune
dontl'armurene
PltiíTe etre rapportée
iI
quel–
gU\Ule
des précédentes.
lOme¡,
ARM
Pour expliquer plus clairement cette h1atiere, 'lu
i
eft par elle-meme tres-importante
&
tn!s-difficile
~
nous avons pris le parti de repréfenter les li{[es par
des lignes horifontales ,
&
les marches.par des lignes
verticales ou perpencliclúaires
a
c\..s horifontales'
&
nous avons enClúte placé des zéros ou des étoiles ;ux
mterfeéhons.
ARMURE,
f.
f.
(en Serrurerie.)
on'donne générale–
ment ce nom
a
tonte la femlre d'une poutre, d'une:
l11achine,
&c.
néce{[aire foit
a
fa coníervation, (oit
a (es u(ages. Ainíi on dit
une poutre 'armée, un aimant
armé,
&c.
ARMURE; ce font
che{
les
PajJementiers,
6-
autres
ouvriers enfoie,
de petites pieces de fer que 1'0n met
aux deux bOlltS de la navette, en faifant de petites
échancrures dans le bois de ladite navette, de fas:on
que ces perites pieces ne la défafleurent pas; l'uCage
de
l'armure ea
de préferver les botlts anguleux dela
navette, lors de fes chlltes,
Yoye{
NAVETTE.
ARMURIER,
f.
m. celui 'lui faifoit autrefois les
armes défeníives dont les gens de guerre fe cou–
vroient, telles que le heaume oule cafque , le gorge"
ron, la cuira{[e, les broífards , les cuiífarts, le
rno~
rion, le hau{[e-col,
&c.
On confond aujourd'hui
l'ar–
murier
avec l'arc¡llebuíier; il
ea
cependant évident
que l'
armurerie
&
l'arquebuCerie font deux profeffions
fort différentes;
&
que l'une-fubíiftoit dans toute fa
vigueur, que I'autre n'étoit pas encore établie. Les
armuriers
s'appelloient auffi
heaumiers
du heaume Olt
ca(que ; leur communauté étoit nombreufe; leurs
premiers ftaluts {ont de 1409, fous le regne de Char–
les VI. ils furent renouvellés en 1562 iDUS Charles
1
X . en voici les principaux artieles.
l.
lis auront 'luatre jurés, dont deux (eront élus
chaque année ; ces jurés veilleront a l'exécution des
reglemens
&
a la confel'vation des priviléges.
2.
Cha–
que maltre ne fera 'lu'un apprenti
a
la fois, qui fera
obligé par-devantNotaire
&
reC;llpar lesjurés. 3. L'ap–
prentifrage Cera de cinq ans; les fils de maltre n'en
femnt pas exempts; ils auront (eulement le droit de
faire a,Pprenti{[age chez leur pere ;
&
les peres , celui
d'avoir un atare apprenti avec leur fils. 4. Le chef–
d'reuvre fera dOIUlé par les jurés ; les fils de maltre
en feront exempts. 5. Les veuves, reftant en viduité,
joiüront des priviléges de leur mari , excepté de ce1ui
de faire des apprentis. 6. Les ouvrages
&
marchan–
diCes des forains (eront vifitées par les jurés. 7. Les
matieres dellinées
a
la fabrication des armures, fer,
acier, fer blanc, cuivre,
&c.
[eront auffi viíitées.
8. Chaque maltre n'aura ql.l'une boutique. 9. Toute
piece de harnois {era marquée d'un poinc;on donné
par les jurés ,
&
dont l'empreinte en plomb (era dans
la chambre du Procurellr du Roi. 10. Les apprentis
de Paris , en
concurrenc~
de boutique avec les COI11-
pagnons étrangers , leur {eront préférés. 11. Les
ar–
muriers
feront tous harnois pour hornmes , comme
corcelets , cuiraífes, hauífes-cols ,
&c.
Les
armltriers
avoient S. George pour parron,
&
leur confrairie étoít a S. Jacques de la Boucherie :
mais les
armures
ayant pa{[é de mode ,la commu–
nauté des
armuriers ea
tombée. La fabrique des corps
de cuira{[e dont on fe fert encore dans quelques ré–
gimens de cavalerie Frans:oi(e eft a Be{anc;on.
.. ARMYDEN
,(Géog.)
ville des Provinces-Unies
des Pays-Bas, d?.J1s l'üe de Valcheren.
Long.
Zl. lO.
lato
jz.
30.
ARNALDISTES,
ou
ARNAUDISTES, f. m. pI.
(Thiol Hij!. eccü¡:)
hérétiques , ainíi nommés d'Ar–
naud de Breífe leur chef. Ils pamrent dans le
XII".
íieele;
&
a I'exemple de leur maltre, ils inveétive–
rent hautement contre les poífeffions légitimes des
biens appartenans ame églifes
&
aux eccléfiaftiques
qu'ils rraitoient d'u(urpation. Ils en{eignerent enfin
des erreurs contre le Bapteme
&
contre l'Euchariíl:ie,
Tttt
íi
















