
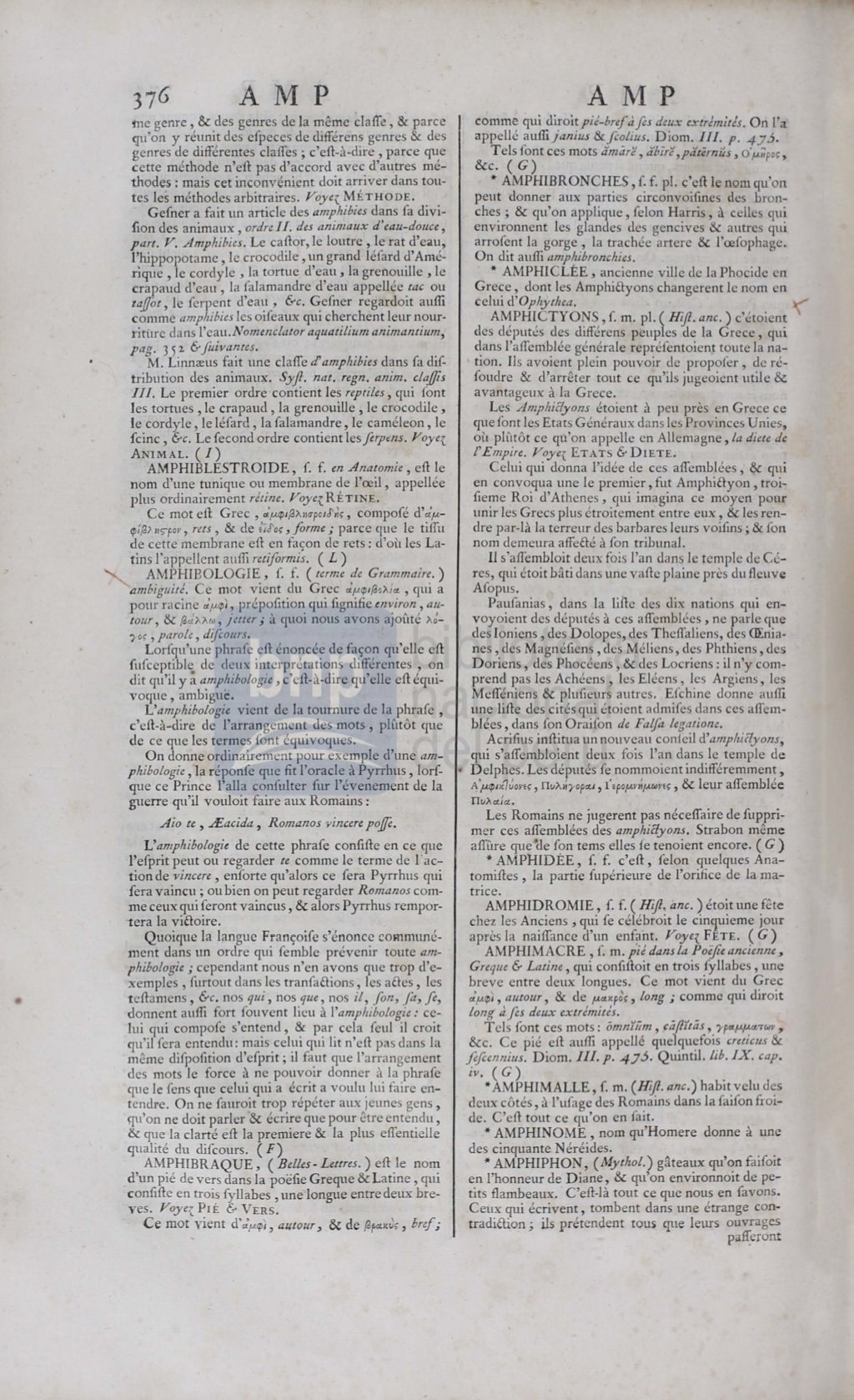
AMP
me genre , & des genres de la meme c1afi"e,
&
paree
qu'on y réunit des efpeees de différens genres
&
des
genres de différentes claífes ; e'efi-a-dire , paree que
eette méthode n'eíl: pas d'accord avec d'autres mé–
thodes : mais cet inconvénient doit arriver dans tou–
tes les méthodes arbittaires.
Voyer.
MÉTHODE.
Gefner a fait un article des
amphibies
dans fa divi–
flon des animaux ,
ordr~
JJ.
dM animaux d'eau-dollce,
parto
v.
Amplzibies.
Le caíl:or, le IOtltre, le rat d'eau,
l'hippopotame, le crocodile, un grand léfard d'Amé–
rique , le cordyle , la tortue d'eau, la grenouille , le
erapaud d'eau, la falamanclre d'eau appellée
cae
ou
taffot,
le ferpent d'eau,
&e.
Gefner regardoit auffi
comme
amphibies
les oifeaux qui cherchent leur nour–
ritilre dans
l'eau.Nomenclator aqllatilium animantillm,
paO'.
352.
&
fuivantes.
M.
Linna:us fait une claífe
ti'
amphibies
dans fa dif–
tribution des animaux.
Syjl. nato regn. animo claJlis
JJJ.
Le premier ordre contient
les repliles,
'luí font
les tortues ,le crapaud , la grenouil1e , le crocodile,
le cordyle, le léfard, la falamandre, le caméleon, le
fcinc,
&e.
Le fecond orclre contient
les.fepens. Yoyer.
ANIMAL.
(1)
AMPHIBLESTROIDE, [ f.
en Anatomie,
eíl: le
nom d'une tunique ou membrane de l'ceil, appellée
plus ordinairement
rétine. Voyer.RÉTINE.
Ce mot eíl: Grec
,.l.~'~A",;pC'J'~~,
compo[é d'el",-
1fJ;~)
»,fCY,
rus,
&
de
;íJ'c~
,forme;
paree que le tiífu
de cette membrane eíl: en facon de rets :
d'o~lles
La–
tins l'appellent auíli
miformi~.
(L)
AMPHIBOLOGIE, f. f.
(terme de Grammaire. )
ambiguité.
Ce mot vient du Grec
.l."'IfJ'~.Aí,,-
,
qui a
pour racine
.l.~),
prépoíition qui íignifie
environ, au–
tour,
&
~
d.AA'.,
jecur;
a
quoí nous avons ajoúté
AÓ–
I'.~
,parole
,
dijeours.
Lorfqu'une phra[e eíl: énoncée de
fa~on
qtl'elle eíl:
[ufceptibl~
de deux interprétations différentes , on
dit qtl'il y a
amphibologie ,
c'efi-a-dire qu'elle efi équi–
voque , ambigue.
L'amphibologie
vient de la tournure de la phrafe ,
c'eíl:-a-dire de l'arrangement des mots, pIlltot qtle
de ce qtle les termes [ont équivoqlles.
On donne ordinairement pour exemple d'une
am–
plzibologie ,
la réponfe que fit l'oracle a Pyrrhus , lorf–
qtle ce Prince 1'alla confuIter [ur l'évenement de la
guerre qu'il vouloít faire aux Romains :
Aio
te
,
./Eaeida, Romanos vineere pofo.
L'amplzibologie
de cette phra[e coníi1l:e en ce qtle
l'efprit peut ou regarder
te
comme le terme de I'ac–
rion de
vincere
,
enforte qu'alors ce [era Pyrrhus qtti
fera vaincu ; ou bien on peut regarder
Romanos
com–
me ceux
qui
[eront vaincus, & alors Pyrrhus rempor–
tera la viéloire.
Quoique la langue
Fran~oife
s'énonce communé–
ment dans un orclre qtlí femble prévenir toute
am–
phibologie;
cependam nous n'en avons qtle trop d'e–
xemples , [urtout dans les tranfailions, les aEtes, les
t efiamens ,
&e.
nos
qlli,
nos
que,
nos
il, fon, fa, fe,
donnent auíli fort fouvent lieu a
l'amphibologie:
ce–
lui qui compofe s'entend,
&
par cela feul il croit
qtl'il [era entendu: mais celui 'luí lit n'eíl: pas dans la
meme difpoíition d'efprit;
il
fau t que l'arrangement
des mots le force
a
ne pouvoir donner a la phrafe
que
le
fens que ceItti qui a écrit a voulu lui faire en–
tendre. On ne [auroit trop répéter aux jetmes gens ,
qu'on ne doit parler & écrire que pour etre entendu,
&
que la clarté efi la premiere
&
la phtS eífentielle
'lualité du difcours.
(F)
AMPHIBRAQUE,
(Belles
-
Lucres.
)
efi le nom
d'un pié de vers dans la poeíie Greqtle & Latine, qui
coníiíle en trois fyllabes , une longue entre deux bre–
yeso
Voyer.
PIÉ
&
VERSo
Ce mot viem
d'el~),
al/tour,
& de
~fa"J~ ,
brtf;
AMP
comme qtli diroit
pié-bref
a
fes derJ.x txtrémit/s.
On I"a
appellé
auffijanius &fcolius.
D iom.
JJI.
p.
4J.5.
Tels font ces mots
ámare, ábire,pátirnus,
o'",íipc~,
&c.
(G)
" AMPHIBRONCHES , f. f. pI. c'eíl: le nom qu'on
pellt donner aux parties circonvoiúnes des bron–
ches; & qu'on applíqtle, felon Harris, a celles 'lui
environnent
les
glandes des gencives
&
mItres quí
arrofent la gorge, la trachée artere
&
I'cefophage.
On dit allíli
ampllibronehies.
" AMPHICLÉE, ancienne ville de la Phocide en
Grece, dont les Amphiélyons changerent le nom en
celui
d'Ophythea.
AMPHICTYONS, f. m. pI.
(Hij!.
ane.)
c'étoient
des déput.!s des différens penples de la Grece, qtli
dans l'aífemblée générale repréfentoíent toute la na–
tion. IIs avoient plein ponvoir de propofer, de ré–
foudrc
&
c!'arreter tout ce qu'ils jugeoient utile &
avantagellx a la Grece.
Les
AmphiByons
étoient
a
peu pres en Grece ce
qtle font les Etats Généraux dans lesProvince Uníes,
011
pllltot ce qu'on appelle en Allemagne,
la diete de
l'Empire. Voye{
ETAT &DIETE.
Celui qui donna I'idée de ces afi"emblées,
&
qtlÍ
en convoqua une le premier, fut Amphiélyon , troi–
íieme Roi d'Athenes, qtÚ imagina ce moyen pOllr
unir les Grecs plusétroitement entre cux ,
&
les ren–
dre par-la la terreur des barbares leurs voifms ;
&
fon
nom demeura affeélé
a
[on tribunal.
Il
s'aífembloit deux fois I'an dans le temple de Cé–
res, qtú étoit bati dans une vafie plaine pres dufleuve
Afopus.
Paufanias, dans la lille des dix nations qui en–
voyoient des députés
a
ces aífemblées , ne parle que
des Ioniens , des Dolopes, des Thefialiens, des <Enia–
nes ,des Magnéíiens ,des Méliens, des Phthiens, des
Doriens, des Phocéens ,
&
des Locriens : il n'y com–
prend pas les Achéens, les Eléens, les Argiens,
les
Meíféniens
&
pluíieurs autres. Efchine donne auffi
une li1l:e des cités quí étoient admires dans ces aífem–
blées, dans fon Oraifon
de FaLfa ltgatione.
Acri/ius inílitua un nouveau confeil
d'amplziélyons,
qui s'aífembloient deux fois I'an dans le temple de
Delphes. Les dépurés fe nommoiem indifféremment,
A·",~,y.1';
...
~,
rIvA.íI'Cp"-',
I'.p.",Y~",.m~
,
&
leur aífemblée
nUAd.:d..
Les Romams ne jugerent pas néceífaire de fUPfri–
mer ces aifemblées des
amplziélyons.
Strabon meme
aíftLre qtle 1:le fon tems elles fe tenoiem encore. (
G)
" AMPHIDÉE, f.
f.
c'eíl:, feIon quelques Ana–
tomilles , la partie fupérieure de 1'orifice de la ma–
trice.
AMPHIDROMIE, f.
f. (
Hij!.
ane.
)
étoit une fete
chez les Anciens , qtú [e célébroit le cinquieme
¡OUT
apres la naiífance d'un enf!lnt.
Voye{
HTE.
(G)
AMPHIMACRE,
f.
m.piédanslaPoijieaneitnne,
Gnque
&
Latine ,
qui conftíl:oit en trois fyllabes , une
breve entre deux longues. Ce mot vient du Grec
.l.",fP'
,
olltollr,
&
de
",,,-y.p¿~ ,
long;
comme qui diroit
long-
a
fes deux extrémités.
Tels fom ces mots:
ómn'tírm, ea(l'üas ,
1'P"-pp.a..,.WY,
&c. Ce pié efi auíli appellé quelquefois
eruicus
&
fifcennius.
Diom.
JJI.
p.
4J.5.
Quintil.
lib.
lX.
cap.
iv.
(G)
"AMPHIMALLE, f. m.
(Ittjl.
ane.)
habitvelu des
deux cotés, a l'ufage des Romains dans la fauon f!Oi–
de. C'efi tout ce qu'on en fait.
" AMPHINOME , nom qu'Homere donne
a
une
des cinquante Néréides.
" AMPHIPHON,
(Mytlzol. )
gateaux qtl'on fai(oit
en l'honnem de Diane,
&
qu'on environnoit de pe–
tits flambeaux. C'efi-la tout ce que nous en [avons.
Ceux qtti écrivent, tombent dans une étrange con–
tradiélion; ils prétendent
tQU5
que leltrs ouvrages
pafferont
















