
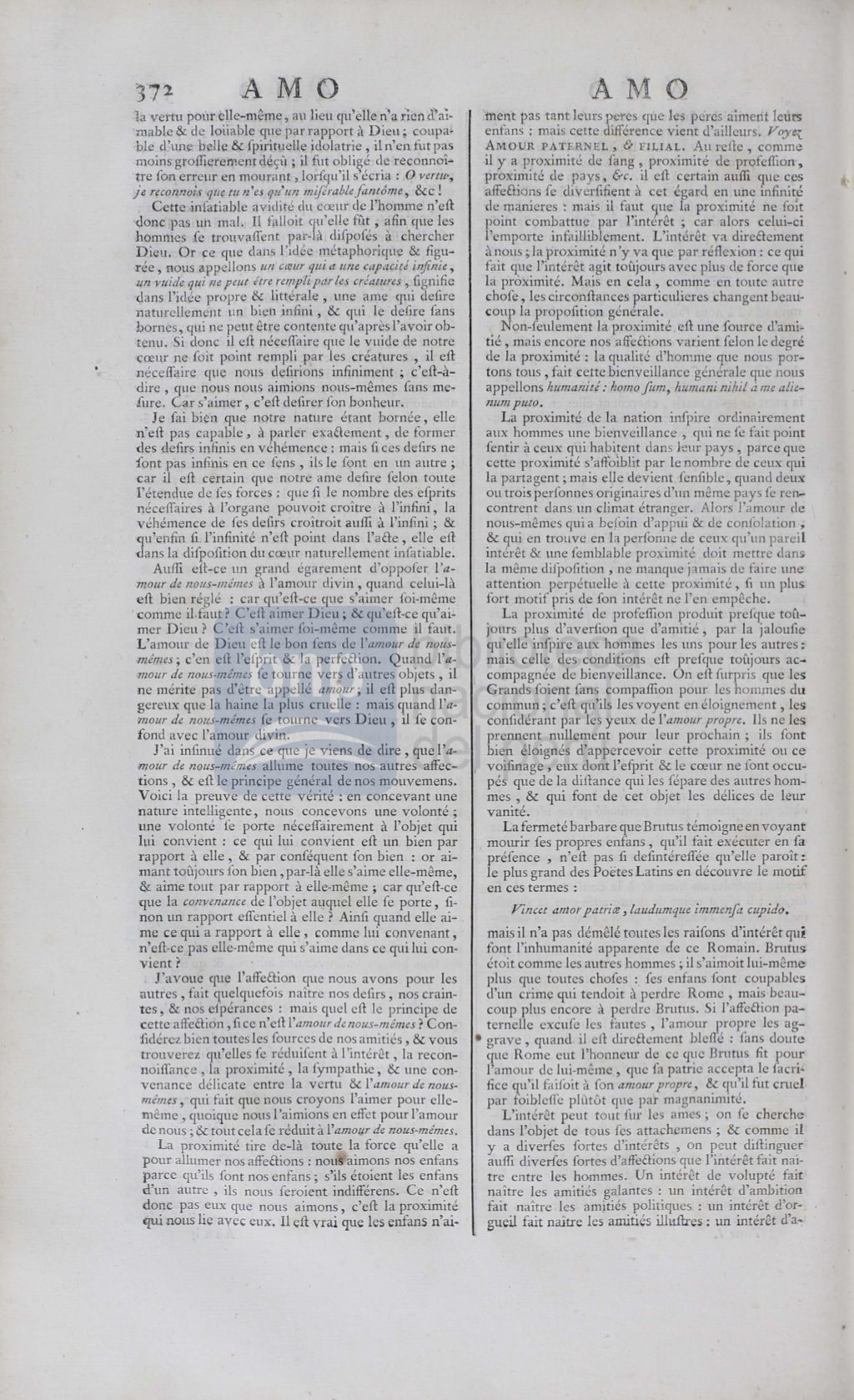
AMO
la vertu pOllt elle-meme, au lieu qu'elle n'a Den d;a1·
mable
&
de loliable que par Tapport a Dieu; coupa–
ble d'tme belle
&
fpirituelle idolatrie, iln'en,[ur pas
moins groílierement dé<;:lL ;
il
fiJt
obli~é
de reconnol–
tre {on erreur en mOUTant ,
lor~9u'il
s écria :
O
yerUt·,
je reconnois que (un'es
qu'Urt
miferablefartlóme,
&c!
Cette .inCatiable avidité du creur de I'homme n'eft
clone pas un mal. II [¡llloit qu'el!e
nü ,
afin que les
hommes fe trouva{[ent par-la difpofés
a
chercher
Dieu. Or ce que dans l'idée métaphoriqLle
&
figu–
rée , nous appellons
un cecur qui a
Ulle
capacitJ
infini~
,
~n
vuide qui
ne
ptltt üre ¡-"llptiparLes créamres,
íignifie
<;Ians I'idée propre
&
littérale , une ame 'lui deíire
naturellemeM un bietl infini ,
&
qui le deúre fans
bornes, qui ne peut etre contente Cjl.l'apres I'avoir ob–
renu. Si donc il eft néce{[aire que le vuide de notre
creHr ne foit point rempli .par les créatures , il eft
néce{[aire que nous deíirions infiniment ; c'eft-a–
dire , que nOU$ nous aimions nous-memes fans me–
{ure. Car s'aimer, c'eft deíirer fon bonheur.
J
e fai bien que notre nature étant bornée, elle
n'eíl: pas capable, a parler exaaement, de former
des defrrs infinis en véhémence: mais íi ces defrrs ne
fonr pas infuús en ce fens , ils le font en un autre ;
car il eíl: certain que notre ame deíil'e felon toute
l'étendue de {es forces: que íi le nombre des efprits
néce{[aires a I'organe pouvoit croltre a l'infini, la
véhémence de fes defrrs croltroir auJIi
a
t'infini;
&
qu'enfin íi l'infinité n'eíl: point dans I'aae, elle eft
l1ans la difpoíition du creur nantrellement infatiable.
AuJIi eft-ce un granel égarement d'oppofer
l'a–
mour de flo/tS-mémes
a
l'amoLlT divin, quand celui-la
eíl: bien réglé : car qu'eíl:-ce que s'aimer foi-meme
''Comme il.faut? C'eft aimer Dieu;
&
qu'eíl:-ce qu'ai–
mer Dieu? C'eíl: s'aimer foi-meme comme il faut.
L'amour de Dieu eíl: le bon fens ele
l'amour de
IlOltS–
-memes;
c'en eíl: l'efprit
&
1<1
perfeaion. Quand l'a–
mour de no/tS-memes
fe totrrne vers d'autres objets , il
ne mérite pas d'etre appellé
amour;
il
eft plus dan–
gerettx que
1<1
haine la plus cruelle : mais quand I'a–
mour de no/tS-nzemes
fe toume vers Dieu, il fe con–
fond avec l'amonr divino
J'ai infinué dans ce que je viens de dire, que l'
a–
mOllr de nous-Ildmes
allume tOtltes nos auo'es affec–
tions ,
&
eft le principe général de nos mouvemens.
Voici la preuve de celte vérité : en concevant une
l1attrre intelligente, nous concevons une volonté ;
ime volonté fe porte néce{[airement
a
l'objet qui
lui convient : ce qui lui convient eíl: un bien par
rapport
a
elle,
&
par conféquent fon bien : or ai–
mant tOtIjours fon bien, par-la elle s'aime elle-meme,
&
aime tout par rapport
a
el1e-m&me ; car qu'eíl:-ce
-que la
convenance
de l'objet auqueJ elle fe porte, fi–
non tUl rapport e{[entieJ a elle? Ainfi c¡uand elle
ai–
me ce qui a rapport a elle, comme lui convenant,
n'eft-ce.pas elle-meme qui s'aime dans ce qui lui con–
vient?
J'avoue que I'affellion que nous avons pOtlT les
~lt1tres
, fait quelquefois naitre nos defirs, nos crain–
tes,
&
nos efpérances : mais quel eíl: le principe de
cette affeaion ,fi ce n'eíl:
l'
amour de nous-Tldmes
?
Con–
fidérez bien toutes les fources de nos amitiés ,
&
vous
l:rouverez eILI'eUes fe réduuent a I'intér&t, la recon–
noi{[ance , la proximité, la fympathie,
&
une con–
venance délicate entre la vertu
&
l'
amour de no/tS–
memes,
qui fait que nous croyons I'aimer pour el1e–
m&me, quoic¡ue nOtlsl'aimions en effet pour l'amour
de nous ;
&
tout cela fe réduit a l'
amoyr de nous-memes.
La proximiré tire de-la toute la force qu'elle a
pour allumer nos affellions : nous aimons nos enfans
parcc qu'ils font nos enfans; s'ils étoient les enfans
d'un auu'c, ils nous [eroient indifférens. Ce n'eíl:
done pas eux que nous aimons, c'eíl: la proxinüté
qui nous líe avee eux. II c:ft vrai que les eruans n'ai·
AMO
ment pas tant leurs petes quc les p rcs aimertt leut!>
enfans : mais cette différence vient d'ailleurs.
royet
AMOUR
PATERNEL, '" FILIAL.
Al! refte , comme
il y a proximité de fang, proximité de profeJIion,
proximité de pays,
&c.
il eft ccrtain auíli que ces
affellions fe diveríifient
a
cer égard en unc infinité
de manicres : mais il faut 9uc la proximité ne foit
point combattue par l'interet ; car alors celtti-ci
l'empone infailliblement. L'intéret va direétement
a
nous ; la proximité n'y va que par réflexion : ce qui
fait que l'intéret agit toujours avec plus de force que
la próximité. Mais en cela, comme en totIte aurre
cho[e, les circoníl:ances particnlieres changent beau–
conp la propoíition générale.
Non-{eulement la proximité.eft une fOtlTce d'ami–
tié , mais encore nos affcélions varíent felon lc dcgré
de la proximité : la qualité d'homme 'jue IlOUS por–
tons tous ,fait cette bienveillance génerale que
1l0US
appelIons
kumanité: homo
jit
m,
humani nihil
ti
me atie–
mtmputo.
La proxinüté de la natÍon iníj)irc ordinairement
aux hommes une bienveilIance , qui ne fe faít point
{entir
a
ceux qui habi.tent elans leur pays , parce que
cette proximité s'affoiblit par le nombre de ceme epi
la partagent; mais elle devient [eníible, quand dettx
on trois perfonnes originaires d'un meme pays fe ren–
contrent dans un climat étranger. Alors l'amour de
nous-memes qui a beioin d'applú
&
de confolation ,
&
qlÚ en trouve en la penonne de ceux c¡u'un pareil
intéret
&
une femblable proximité doit mctlre dans
la meme difpofition , ne manque j'lmais de faire une
attention perpétuelle acetre proximité, fi un plus
fon motif pris de fon intéret ne I'en empeche.
La proximité de profeffion produit prefque toú–
jours plus d'avenion que d'amitié , par la jalouíie
qu'elle infpire am: hommes les uns pour les autres:
mais celle des conditions eíl: prefque tOlljours ac–
compagnée de bienveillance. On en: furpris que les
Grands foient fans compaílion pour les hommes du
commun; c'eíl: qu'ils les voyent en éloignement , les
coníidérant par les yettx de l'
amour propre.
IIs ne les
prennent nullement pour leur prochain; ils font
bien éloignés d'appercevoir cclte proximité on ce
I
voifinage, cux dont I'efprit
&
le creur ne font occu–
pés que de la diftance eILü les fépare des autres hom–
mes,
&
eILú font de cet objet les délices de letrr
vanité.
Lafennetébarbare que Brutus témoigne en voyant
molltir fes propres enfillls, qu'il fait exécuter en {a
préfence , n'eft pas
Ji
deíintére{[ée qu'elle paroit:
le plus grand des Poetes LaUns en découvre le motif
en ces termes :
Plncet amorpatrill! , laudllfllque immenJa cupido.
mais
il
n'a pas démelé toutes les rauons d'intéret
qui
font I'inhumanité apparente de ce Romain. Bmtlls
éroit comme les autTes hommes ;
il
s'aimoit lui-m&me
plus eILle tOlItes chofes : {es enfans [ont coupables
el'un crime qui tendoit
a
perdre Rome , mais beau–
COllp plus encore a perelre BruttlS. Si I'affellion pa–
temelle excufe les faures, l'amour propre les ag–
grave, quand il eft clireaement ble{[é : fans doute
eILle Rome eut l'honneur de ce que BnIttls fit pour
l'amour de lui-meme, quc [a patrie accepta le facri–
{ice qu'il faifoit
a
[on
amourpropre,
&
c¡u'il fut cruel
par foible{[e plurat que par magnanimité.
L'intér&t peut tout [ur les ames; on fe cherche
dans l'objet de tous fcs attachemens ;
&
comme
il
y a divenes fortes d'intérets , on peut diftinguer
auffi divenes fortes d'affeélions quc l'íntéret fait naí–
tre entre les hommes. Un intér&t ele volupté fait
naltre les amitiés galantes: un intéret d'ambition
fait naltre les amitiés politiques : un intéret d'or–
gueil fait mutre les amitiés illtúl:res : un intéret
d'a~
















