
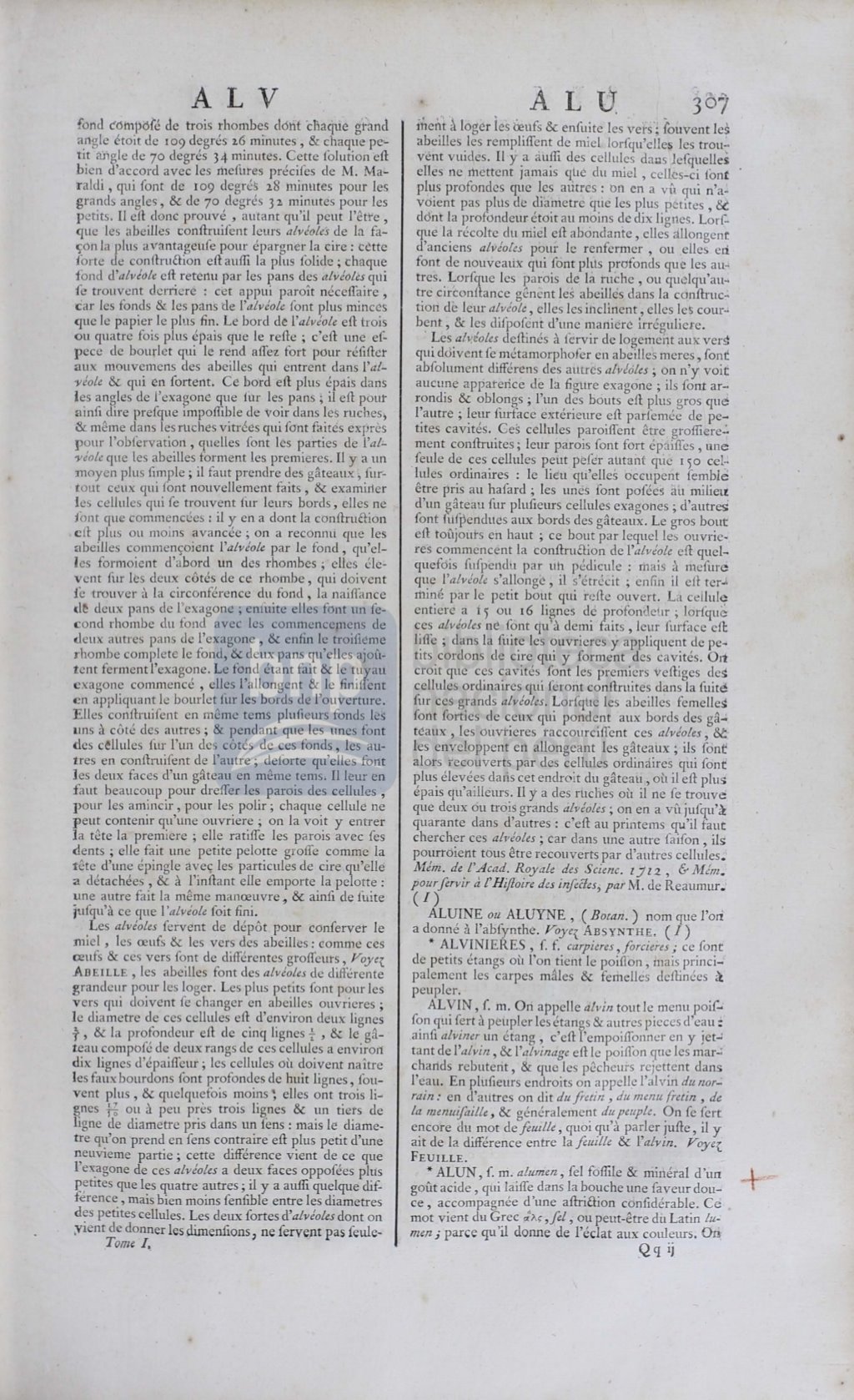
ALV
fond (ótnpólé de trois rhombes clónt cnaque gl'and
artgle étoit de
109
degrés :1.6 minute
,&
chaque
pe~
tit angle de 70 degrés
34
minutes. Cette folution ell:
bien d'accord avec les nlefttres précifes de
M.
Ma~
raldi, qui font de
109
degré~
28
minutes pour les
grands angles,
&
de 70 degrés 32 minutes pour les
petits.
I1
en donc prouvé , autant qu'il peut
I'~tte
,
que les abeilles conll:núfcnt lems
alyéoüs
de la fa–
c;on la plus a,'antagetúe pour épargner la cire: cette
forte de connruéhon eftauffi la plus folide; thaque
fond d'
alv/.ole
ell: retenu par les pans des
«lvéoles
qtl i
fe trouvent dcrriere : cet appui parolt néceífaire ,
car les fonds
&
les pans de
l'alyéole
font plus mincéS
<luC le papier le plus fin. Le bord de
l'alviole
ell: trois
ou
quatre fois plus épais que le refte ; c'ell: une ef–
})ece de bourlet cJUi le rend aífez fort pour réiill:er
aux mouvemens des abeilles qui entrent dans
l'al–
-yéoü
&
qui en fortent. Ce bord ell: plus épais dans
¡es angles de I'exagone que {ur les pans ; il ell: pout
ainii dire prefque impoíftble de voir dans les ruches,
&
m~me
dans lesruchesvitrééS qui font faites expres
J)our I'oblervation , quelles fom les paTries de
l'al–
-yiole
que les abeilles forment les premieres.
I1
y a un
moyen plus iimple ; il faut prendre des gateaux, fur–
tout ceux qui
lont
nouvellement faits ,
&
examilier
les cellules qui fe trouvent
íi.trleurs borels, elles ne
iont que ommencées: il y en a elom la confiruétion
cfi plus ou moins avancée; on a reconnu que les
abeilles commenc;oient
I'alvéole
par le fond, qu'el–
les formoient el'abord un eles rhombes ; elles éle–
vent fur les deme cotés de ce. rhombe, qui doivent
fe trouver a la circonférence du fond , la naiífance
d~
deux pans de l'exagonc ; emltite elles font un fe–
cond rhombe elu fond avec les commencemens de
oeux autres pans de l'exagone ,
&
enfin le troiÍleme
,.hombe complete le fond,
&
deux pans qu'elles ajoft–
tent fermentl'exagone. Le fond étant fait
&
le tuyau
exagone commencé , elles l'allongent
&
le finilrent
en appliquant le bomlet
(ur
les bords de l'ouvernlre.
Elles confintifent en meme tems pluiieurs fonds les
1lllS
a coté des autres;
&
pendant que les unes font
rles cellules fm l'lln des cotés de ces fonds , les au–
tres en con!l:mi(ent de l'autre; eleforte qu'elles fOr1t
les deux faces el'un gftteau en
m~me
tems. Illeur en
faut beauconp pour dreífer les parois des cellules ,
POttr les amincir , pour les polir; chaque
cellule
ne
peut contenÍt qu'une ouvriere ; on la voit y entrer
la tete la premiere ; elle ratiífe les parois avec fes
dents ; elle fait une petite pelorte grolfe comme la
tete d'une épingle avec; les particules ele cire qll'elle
;a
détachées ,
&
a
l'infiant elle emporte la pelotte :
une autre fait la meme manceuvre.
&
ainii ele luite
jufqn'a ce que
I'alviole
foit fini.
Les
alvéoles
fervent de dépot pour con(erver le
miel, les ceufs
&
les vers des abeilles: COJ1U)le ces
amfs
&
ces vers font de diJférentes grolfeurs,
Yoye{
ABEILLE
,les abeilles font des
alveoles
de
difr~rente
grandcur pour les loger. Les plus perits font pom les
vers qui doivent fe changer en abeilles ouvrieres;
le diametre de ces cellules ell: d'environ deux lignes
+,
&
la profondem efi de cinq lignes
+,
&
le ga–
leau compofé de deux rangs de ces cellules a environ
dix lignes d'épaiífeur; les cellules Olt doivent naltre
les faux bourdons font profoneles de huit lignes, fou–
vent plus,
&
quelquefois moins
~
elles ont trois li–
gnes
H
ou a peu pres trois lignes
&
un tiers de
ligne de diametre pris dans un fens : mais le eliame–
tre qu'on prend en fens contraire en plus petit d'une
neuvieme partie; cette différence vient de ce que
l'exagone de ces
alvéoles
a deux faces oppo(ées plus
petites que les Cfllatre alltres;
il Y
a auffi quelque dif–
férence, mais bien moins fenftble entre les diametres
des petites cellules. Les deux fortes
d'alvéoles
dom on
;vient de donner les dimenfions, ne ferve¡lt pas feule-
Tome
l.
A
L
u:
307
ibent
~
loger ies
~ufs
&
enfuite les vet·s·; fouvent leS
abeilles les rempliífent de miel lorfqu'elles
les
trou–
vent vtúdes.
11
y.a an!fi des cellules dags lerquelles
elles ne Ihettent ¡amals c¡lIe du rruel , celles-ci lont
plus profondes Cflle les autres : on en a vi'I qui n'a–
voient pas pltls de diametre que les plus petites ,
tiC
dont
la
profondeur étoit al! moins de elix ligl1es. Lorf–
que la récolte du miel efi abondante, elles <lllongenr.
d'anciens
alvéoles
pour le renfemler , ou elles en
font de nouveatix qui fOnt phts profonds que les au–
tres. Lorfque les parois de la ruche, ou
CfllelCflI'au~
tre circoníl:ance genent
leS
abeillés c1ans la conll:rllc–
tion ele leur
alyéolc,
elles les inclinent, elles les cour–
bent ,
&
les difpofént d'une maniere irréguliere.
. Les
alv,éoles
defiinés
a
fervir de logement aux vers
qlli ddivent fe métamorphofer en abeilles meres, foné
abfolument différens des autres
alvéóles
;
On n'y voit
aucune appaterice de la figure exagone ; ils font ar–
rondis
&
oblongs ; l'un des bouts efi plus gros CflH!!
l'autre ; leur furface extérieme ell: parfemée de pe–
tites cavités. Ces
cellules
paroilfent etre groffiere':
ment confiruites; leur parois (ont fort épaiífes , une
feule de ces cellules peut pefer alttant que
1)0
cel··
lules ordinaires : le lieu qu'elles occupent
(emble
etre pris au hafard ; les unes font pofées au milieu
d'un gatea
1
fm pluiieurs cellules exagones ; d'autreS
font fulpendttes aux bords des gateaux. Le gros bout
efi rOlljours en haut ; ce bout par lequelle, ouvrie–
res commencent la confiruétion de
I'alviole
efi qnel–
quefois fufpend
1
par uh pédicule : mais
a
mefure
que
l'alvJoü
s'allongé, il s'étrécit ; enlln il eH rer..l.
miné par le petit bout qui
n~ll:e
ouvert. La cetlult;:
entiere a
i
5
ou 16 lignes de profondetlr ; lorique
ces
alvJoles
né fónt 'in'a demi faits , leur fmface eH:
liífe ; elans la (uite les ouvrieres y appliquent de pe–
tits cordons ele cire CfllÍ y forment des cavités. Ort
croir Cflte ces cavités font les premiers veniges des
ceHules ordinaires
C¡IÚ
(eront confimites elans la fuité
fur ces grands
alyéoles.
Lorfqlte les abeilles femelles
font forties de cenx qui pondent aux bords des ga":
téaux , les ouvtieres taccourciífent ces
alvéoles,
8t.
les enveloppent en allongeant les gateaux ;
ils
font
alors i'ecouverts par des ceHules ordináires qui font:
plus élevées dal1s cer endroit du gateatt , Olt il efi plus
épais qu'ailleurs.
U
y
a eles ruches
011
il ne fe trouve
que deux ou trois grands
alvéoles;
on en a Vll jufql.l'a:
ql.larante dans d'autres : c'cn au printems qu'il faut
chercher ces
ah,Joles;
car dans une autre faifon , ils
poulToient tous etre recouverts par el'autres cellules.
Mim. de tAcad. Royale des Scienc.
ZJZ2,
&Mém.
pourferYÍr
a
l'
Hifloire des infeaes, par
M.
de Reaumur.
(1)
ALUINE
01t
ALUYNE,
(Botan.)
nom que
1'011
a donné
a
l'abfynthe.
Voye{
ABSYNTHE.
(1)
*
ALVINIERES,
f.
f.
crzrpieres ,jorcieres;
ce (ont
de petits étangs ottl'on tient le poiílon , mais princi–
palement les carpes
m~les
&
femelles defunées
it
peupler.
ALVIN ,
f.
m. On appelle
alvin
tout le menu poif–
fon CflIÍ (ert
a
peupler les étangs
&
autres pieces d'eau:
ainii
alviner
un étang, c'eH l'empoiífOlUler en y
jet~
tant de
l'alyin,
&
l'
alvinage
ell: le poiílon que les mar":
chands rebutent,
&
que
les
p~cheurs
rejettent dans
I'eau. En plulieurs endroits on
apJ1el1~
l'alVln
du
nor–
ra;n:
en el'autres on dit
du fretín
,
du menu (retin, de
la TlJenuifaille,
&
O'énéralement
du
pU/pie.
On fe fert
encore du mot
de°feuitle,
quoi qu'a parler juHe,
il
Y
ait de la différence entre la
fiuille
&
l'
ah,in. Voye{
FEUILLE.
*
ALUN,
f.
m.
alumen,
fel foíftle
&
minéral d'un
t
gOÍlt acide , qtli laiiTe dans la bouche une (aveur dou-
T
ce, accompagnée d'une afiriébon confidérable.
Ce
mot vient du
Cree
¿,,~
,fel
,
ou
peut-~tre
du Latin
lu-
men.j
pan;e qu'il donne de l'édat aux coulems.
Da
ij
















